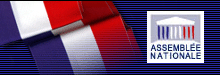Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,
La vigueur de vos interventions témoigne de la place qu'occupe dans
le débat public la question des langues régionales. Si la
représentation nationale s'en est saisie, c'est qu'au-delà du cadre
de nos institutions et des milieux spécialisés, elle intéresse voire
passionne l'ensemble des Français.
Ils sont en droit d'attendre une réponse claire aux interrogations
que certains d'entre vous ont formulées.
Non, Monsieur..., le Gouvernement ne s'engagera pas dans un
processus de révision constitutionnelle pour ratifier la Charte
européenne des langues régionales et minoritaires, et ce, pour
plusieurs raisons.
Pour des raisons de principe, d'abord. Vous vous souvenez sans doute
que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 juin 1999,
avait relevé que la ratification de la Charte supposait l'adhésion
au préambule de ce texte, ainsi qu'aux « dispositions générales » et
à ses «objectifs et principes» (parties I et II) qui ne sont pas
dépourvus de toute portée normative.
La ratification de la Charte implique la reconnaissance - qui n'est
pas seulement symbolique - d'un «droit imprescriptible» de parler
une langue régionale, notamment dans la sphère publique. Ce droit
figure en effet explicitement dans le préambule de la Charte, ce
qui, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel, est contraire à
des principes constitutionnels aussi fondamentaux que
l'indivisibilité de la République, l'égalité devant la loi et
l'unité du peuple français.
Les réserves posées par le Conseil constitutionnel vont donc bien
au-delà de l'articulation de la Charte avec l'article 2 de la
Constitution, aux termes duquel «la langue de la République est le
Français ». Elles engagent ce que je n'hésiterai pas à appeler notre
«noyau dur constitutionnel», qui interdit de conférer des droits
particuliers à des groupes spécifiques - qui plus est sur des
territoires déterminés.
Vous en conviendrez avec moi, Mesdames et Messieurs les Députés, la
République ce n'est pas un puzzle communautaire dont il suffirait
d'assembler les morceaux pour voir s'y dessiner le visage de
Marianne.
Elle est une et indivisible.
Et qui, parmi vous, pourrait aujourd'hui se déclarer partisan d'une
administration nationale et territoriale obligée, dans une région
donnée, de s'exprimer dans la langue déclarée langue de cette
région, avec des fonctionnaires obligés, pour être recrutés, de
maîtriser cette langue, afin de faire « droit » à des revendications
légitimées par la Charte ? Ce serait pourtant l'une des conséquences
inévitables de la logique de ce texte.
Le gouvernement signataire de la Charte en 1999 avait bien
conscience de ce risque, qui avait assorti sa signature d'une
déclaration interprétative.
Mais qui nous assure qu'une autre interprétation ne pourrait pas en
être faite ? Et qui en jugerait ?
Mais, me direz-vous, nos grands voisins européens (l'Allemagne,
l'Espagne, la Grande-Bretagne, notamment) ont bien ratifié la
Charte.
Sans doute, mais convenez que la forme de l'État n'y est pas la même
qu'en France. Ni la place de la - ou des - langue(s) nationale(s).
Chez nous, la question de la langue a toujours revêtu une dimension
particulière dans notre histoire institutionnelle et politique
depuis que l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) a imposé aux
Parlements et aux tribunaux l'usage du français. Il n'est pas
étonnant qu'aujourd'hui la langue de la République occupe une place
symbolique et particulière dans notre socle de références communes.
Et la situation linguistique de notre pays - qui, je l'ai dit, a le
patrimoine le plus riche d'Europe - n'est pas la même qu'outre-Rhin, outre-Manche, voire outre-Pyrénées.
C'est une autre raison pour la France de ne pas ratifier la charte.
Cette ratification supposerait en effet que soient clairement
identifiées les langues auxquelles ce texte a vocation à
s'appliquer.
En 1999, un groupe de travail piloté par les ministères chargés de
l'Éducation nationale et de la Culture s'était appliqué à les
recenser.
Quelque 79 langues avaient alors été identifiées (dont 39
outre-mer), sous la dénomination de «langues de France».
S'agissant de la France métropolitaine, cet ensemble incluait
l'ensemble des langues concernées par la loi Deixonne (basque,
breton, catalan, gallo, langue mosellane, langue régionale d'Alsace
et langue d'oc dans ses différentes variétés), auxquelles
s'ajoutaient notamment le flamand occidental, le franco-provençal et
les langues d'oïl, ainsi que cinq autres langues parlées par des
ressortissants français sur le territoire de la République (berbère,
arabe dialectal, yiddish, romani, arménien occidental).
On mesure donc la difficulté, pour la France, de fixer le périmètre
d'application de la Charte, et cela d'autant plus que celle-ci ne
fournit aucune indication sur les critères d'éligibilité, comme, par
exemple, le nombre minimum de locuteurs.
Le risque de dispersion de l'aide et des moyens serait réel, au
détriment des langues les plus représentatives.
La Charte présente par ailleurs la particularité d'être un texte à
options : les États qui y adhèrent s'engagent à respecter, outre les
principes et objectifs généraux, au moins 35 des 98 mesures qu'elle
propose.
La France a sélectionné, lors de la signature de la charte, une
liste de 39 engagements. Parmi ceux-ci, figurait l'engagement de «rendre accessible, dans les langues régionales ou minoritaires, les
textes législatifs nationaux les plus importants [...] à moins que
ces textes ne soient déjà disponibles autrement». La France
retenait également l'obligation de «permettre et/ou encourager la
publication par des collectivités territoriales des textes officiels
dont elles sont à l'origine dans lesdites langues, ainsi qu'à
l'emploi ou l'adoption des formes traditionnelles de la toponymie
dans ces mêmes langues».
Imaginez-vous le coût budgétaire faramineux pour l'État d'une telle
obligation de traduction (il serait proportionnel au nombre des
langues retenues)? Et cette obligation ne concernerait pas
seulement les textes futurs, mais également notre stock législatif,
avec un travail très subjectif de sélection des textes «les plus
importants» à traduire.
Le coût potentiel pour les collectivités locales serait par ailleurs
loin d'être négligeable. Certes, à la différence de l'État, elles
n'auraient aucune obligation de traduction. Mais le refus de
traduire pourrait vraisemblablement être contesté devant les
tribunaux, sur le fondement de ce « droit imprescriptible » de
parler une langue régionale, que reconnaît - je le répète - le
préambule de la Charte.
Pour conclure : ratifier la Charte serait donc contraire à nos
principes ; l'appliquer serait difficile, coûteux et d'une portée
pratique pour le moins discutable. Elle n'apporterait au mieux
qu'une réponse symbolique à la question posée, qui, elle, est bien
réelle : comment mieux faire vivre les langues régionales dans notre
pays ?
Le constat que je dresse n'est évidemment pas incompatible avec la
promotion et la protection du pluralisme linguistique. Veillons à ne
pas opposer les « langues régionales » à la « langue de la
République ». La singularité française se nourrit aussi de la
richesse de nos territoires. Et les langues régionales font partie
de notre patrimoine commun. Non, le basque n'appartient pas qu'aux
Basques, et le breton qu'aux Bretons. Ces langues appartiennent à
tous les Français.
Reconnaître la diversité linguistique, ce n'est pas nécessairement
reconnaître des droits spécifiques et « imprescriptibles » aux
locuteurs de ces langues dans la sphère publique. C'est d'abord
encourager leur usage, permettre leur enseignement, chaque fois que
les familles le demandent, et favoriser leurs expressions
culturelles et artistiques, sur tous les territoires.
A cet égard, je crois d'abord que nous aurions avantage à y voir
plus clair sur ce qu'autorise le cadre législatif et réglementaire
actuel. Les attendus du Conseil constitutionnel nous montrent la
voie à suivre : en jugeant que « n'était contraire à la
Constitution, eu égard à leur nature, aucun des engagements
souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à
reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre...en faveur des
langues régionales », le Conseil nous ouvre une très large marge de manœuvre.
Ma conviction est qu'elle est insuffisamment exploitée.
Dans les cinq matières énumérées par la Charte (médias, activités et
équipements culturels, échanges transfrontaliers, justice, autorités
administratives et services publics), la plupart des dispositions
législatives nécessaires à la poursuite des objectifs retenus
existent déjà.
S'agissant des domaines de la justice, des autorités administratives
et des services publics, aucune disposition législative ou
constitutionnelle n'interdit, par exemple, à une collectivité locale
de traduire ses propres délibérations ou tout autre texte dans une
langue régionale, dès lors qu'existe une version en français (qui
est la seule, il est vrai, à faire foi).
Mais ne pas interdire ne signifie pas prescrire ou imposer : la
nuance est d'importance.
De même, rien ne nous empêche de mettre en valeur les bonnes
pratiques, et de conforter, s'il y a lieu, les « territorialisations
» existantes, dans le respect de nos valeurs républicaines. Je ne
citerai qu'un exemple : le principe de la demande des familles étant
clairement posé, nous pourrions développer les conventions avec les
collectivités locales et les associations, à l'image de celles qui
régissent l'enseignement et la promotion de la langue basque dans
les Pyrénées-Atlantiques, où a été mis en place un très remarquable
Office public de la langue basque.
Mais si les dispositions légales et réglementaires existent pour
favoriser l'apprentissage ou l'usage des langues régionales dans
notre pays, il ne serait pas inutile d'en faire l'inventaire afin de
mieux « sécuriser » l'emploi de ces langues, ainsi que le président
de la République en exprimait le voeu pendant sa campagne
électorale. L'état du droit en la matière est insuffisamment connu,
et un effort de clarification s'impose.
Les textes qui régissent l'enseignement des langues régionales,
depuis la loi Deixonne de 1951, et plus généralement leur usage dans
la vie sociale, sont nombreux et constituent un véritable maquis où
le citoyen peut facilement se perdre.
Cette absence de clarté motive, à juste titre, certaines
revendications.
Nous devons normaliser et organiser l'apprentissage et l'emploi des
langues régionales dans notre société, par une forme de
codification.
Nous avons besoins de textes auxquels nous puissions nous référer,
avec le moins d'ambiguïté possible, sans avoir à exhumer des
circulaires annulées parfois par d'autres circulaires....
Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un cadre de référence -
je crois que nous pouvons tous nous mettre d'accord sur ce point et
c'est ainsi que j'interprète la demande que vous formulez, Monsieur
le député Marc Le Fur.
Ce cadre de référence - dont la mise en place permettrait, chemin
faisant, de relancer l'effort de promotion - prendra la forme d'un
projet de loi, ainsi que le président de la République en avait émis
l'idée lors de la campagne électorale.
Voilà, Mesdames et Messieurs les Députés, l'approche qui sera la
nôtre pour accroître la place des langues régionales sur notre
territoire et garantir à terme leur vitalité. Elle doit
s'accompagner d'un soutien résolu apporté, au niveau territorial, à
leur pratique, dans de nombreux domaines de la vie culturelle et
sociale.
Il s'agit de permettre et non pas de contraindre, d'inciter et non
pas d'imposer. Il s'agit - tout en rappelant la primauté du français
dans notre société - d'ouvrir un espace d'expression plus large à
d'autres langues historiquement parlées sur notre territoire, et non
pas de reconnaître des droits spécifiques et « imprescriptibles »
aux locuteurs de ces langues.
Bref, il s'agit de favoriser l'exercice d'une liberté d'expression
et non pas de créer des obligations nouvelles pour l'État.
Cette liberté, nous la garantirons avec le souci de respecter les
principes de nos textes fondamentaux, et le rôle primordial du
français, notamment en matière d'apprentissage. Le premier ministre
l'a rappelé dans le rapport au Parlement sur l'emploi de la langue
française : notre langue commune est « au plus profond, le lien qui
nous rassemble autour des valeurs de la République ». Sur le statut
du français, nous ne transigerons pas.
Mais en donnant une forme institutionnelle à la notion de patrimoine
linguistique, en « instituant » en quelque sorte la diversité
linguistique interne, nous conforterons la bataille que nous menons,
en Europe et dans le monde, pour favoriser le multilinguisme et la
diversité culturelle.
Je vous remercie.
Source: http://www.culture.gouv.fr, le 14 mai 2008
|