 |
Neuchâtel(Confédération suisse) |
|
République et canton de Neuchâtel |
 |
Neuchâtel(Confédération suisse) |
|
République et canton de Neuchâtel |
|
Le canton de Neuchâtel (NE: voir la carte au sigle NE pour Neuchâtel) fait partie des quatre cantons francophones unilingues (avec Vaud, Genève et le Jura) de la Confédération suisse. Il est situé à l'ouest de la Suisse près de la frontière française. Au sud se trouve le canton de Vaud; au nord-est, le canton du Jura et le canton de Berne; au sud-est, le canton est bordé par le lac de Neuchâtel. Au nord-ouest, la vallée du Doubs marque la limite avec la France. De l'autre côté de la frontière suisse, on trouve les départements français du Doubs, du territoire de Belfort (région Franche-Comté) et du Haut-Rhin (région Alsace). Neuchâtel est un petit canton de 803 km² par comparaison au canton de Berne (5959 km²) ou du canton de Vaud (3212 km²). La capitale du canton est Neuchâtel. Voir la carte au sigle BE pour Berne. |
1.1 L'appellation Jura pour des entités distinctes
Le Jura est d'abord une chaîne de montagnes qui s'étend en France, en Suisse et en Allemagne (le «Jura souabe») et qui a donné son nom à la deuxième période du Mésozoïque ou «ère secondaire» : le Jurassique. Voir la carte des frontières des deux pays avec le massif du Jura. Sur le plan administratif, l'appellation «Jura» peut désigner trois entités différentes: un district bernois, un canton suisse et un département français.
 |
|
 |
En Suisse, le massif du Jura s'étend sur plus de 360 km le long de sa crête principale entre Voreppe (Isère, en France) et Dielsdorf (Zurich, en Suisse). Divisé par la frontière entre la France et la Suisse, le massif du Jura est traditionnellement séparé en deux entités: le «Jura français» et le «Jura suisse». En Suisse, le Jura constitue l'une des trois grandes régions géographiques avec le Plateau suisse et les Alpes. |
1.2 Les régions administratives
|
Le canton compte quatre régions: Le Littoral, Montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz et Val-de-Travers et 30 communes.
Depuis le 1er janvier 2018, le canton de Neuchâtel ne comprend plus de districts. Il était divisé auparavant en six districts : Boudry, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. |
|
C'est la région du Littoral qui compte le plus fort pourcentage de la population, représentant 53,6 % du canton, dont Neuchâtel avec 44 400 habitants. Suivent les Montagnes (28,8%), dont La Chaux-de-Fonds avec 37 700 habitants, puis Val-de-Ruz avec 9,8%, dont le chef-lieu (10 500 hab.). Bref, les communes ne comptent en général que de faibles populations à l'exception des suivantes: Neuchâtel (44 400), La Chaux-de-Fonds (37 700), Le Locle (10 700), Val-de-Ruz (17 370) et Val-de-Travers (10 500). |
| TOTAL (2000) |
Français | Allemand | Italien | Romanche | Espagnol | Portugais | Albanais | Serbo-croate | Turc | Autres langues |
| 167 949 | 143 190 | 6849 | 5407 | 95 | 1860 | 4230 | 723 | 956 | 546 | 4092 |
| 100 % | 85,2 % | 4,0 % | 3,2 % | 0,06 % | 1,1 % | 2,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,4 % |
Dans les siècles passés, les Neuchâtelois parlaient couramment le «patois neuchâtelois», une variété du franco-provençal propre au canton de Neuchâtel, qui était située à la limite nord-est de l'aire franco-provençale, laquelle comprenait alors toute la Suisse romande (à l'exception du Jura), une partie du Jura français, le Lyonnais, le Forez, la Bresse, le Dauphiné, la Savoie et la Vallée d'Aoste (Italie). À l'instar de tous ces parlers, le patois neuchâtelois était parlé différemment d'un village ou d'une vallée à l'autre, sans difficulté majeure de compréhension. Les derniers locuteurs du neuchâtelois seraient disparus dans les années 1920, mais le Centre de dialectologie de l’Université de Neuchâtel est toujours resté très actif en matière de recherche sur les parlers franco-provençaux. Nous reproduisons ici un extrait d'un récit en «patois de Boudry», rédigé par L. Favre, président du Comité du patois de la Société cantonale d'histoire et d'archéologie:
|
Le renâ à Dâvid Ronnet Aë-vo jamai ohyi contâ l'istoire du renâ que Dâvid Ronnet a tioua dé s'n otau, à Bouidry ? Vo peuté la craëre, è l'é la pura veurtâ. Dâvid Ronnet êtaë én' écofi, on pou couédet, qu'anmâve grô lé dzeneuillè; el é d-avaë mé d'èna dozân-na, avoué on poui que tsantâve dé viadze à la miné, mâ adé à la lévaye du solet. Quaë subiet de la métsance! mé z-ami ! E réveillive to l'otau, to lo vesenau; nion ne povaë restâ u llie quan le poui à Dâvid se boétàve à rélâ. Ç'tu poui étaë s'n orgoû. Le gran mataë, devan de s'assetâ su sa sulta por tapa son coëur & teri le l'nieu, l'écofi lévâve la tsatire du dzeneuilli por bouèta feur sé dzeneuillé & lé vaër cor dè le néveau. E tsampâve à sé bêté dé gran-nè, de la queurtse, du pan goma dè du lassé, dé cartofiè coûtè, & s'amouésâve à lé vaër medzi, se roba lé pieu bé bocon, s'énoussa por pieu vite s'épyi le dzaifre. E ne reubiâve pâ d'alâ boûtâ dè le ni, apré lé z-oeu, & farfoueilli dè tu lé care por n'è rè lassi. (Le patois neuchâtelois, p. 196). |
Le renard de David Ronnet Avez-vous jamais entendu raconter l'histoire du renard que David Ronnet a tué dans sa maison, à Boudry? Vous pouvez la croire, c'est la pure vérité. David Bonnet était un cordonnier, un peu coudet, qui aimait beaucoup les poules; il en avait plus d'une douzaine, avec un coq qui chantait quelquefois à minuit, mais régulièrement au lever du soleil. Quel sifflet diabolique, mes amis ! Il réveillait toute la maison, tout le voisinage; personne ne pouvait rester au lit quand le coq de David se mettait à crier. Ce coq était son orgueil. Le grand matin, avant de s'asseoir sur sa petite chaise pour battre son cuir & tirer le ligneul, le cordonnier levait la chatière du poulailler pour mettre dehors ses poules & les voir courir dans le porche. Il jetait à ses bêtes des graines, du son, du pain trempé dans du lait, des pommes de terre cuites, & s'amusait à les voir manger, se prendre les plus beaux morceaux, s'engouer pour plus vite se remplir l'estomac. Il n'oubliait pas d'aller regarder dans le nid, après les oeufs, & fouiller dans tous les coins pour n'en rien laisser. |
On peut aussi consulter le texte traduit en français par M. Manuel Meune de «La parabole de l’enfant prodigue», en cliquant ICI, s.v.p.
Depuis la Réforme, le canton de Neuchâtel est devenu très majoritairement protestant (Église réformée évangélique). Depuis les années 1970, le pluralisme religieux et confessionnel s'est fortement accentué parmi les habitants du canton. Par exemple, depuis quelques années, en plus des religions chrétiennes majoritaires et juives, implantées de longue date, sont apparus l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme.
Les rives du lac de Neuchâtel furent habitées dès la plus haute antiquité, soit entre -3800 et -3500. On ne sait pas grand-chose sur l'histoire ancienne de la région. Il faut attendre la période préromaine, alors que des tribus gauloises s'installèrent dans la région vers le Ve siècle avant notre ère, notamment les Helvètes (voir la carte).
3.1 La romanisation
Après la conquête des Gaules par Jules César, entre 58 et 51 avant notre ère, ce sont les Romains qui s'implantèrent dans la région et latinisèrent la population locale. À partir du IIIe siècle, la langue latine parlée par les habitants commença à subir des changements importants en raison de l'affaiblissement du pouvoir romain et des menaces provenant de la part des peuples germaniques. Au milieu du IVe siècle, soit vers 353-354, puis en 378 les Alamans, un peuples germanique, profitèrent des luttes entre l'empereur légal Constant et l'usurpateur du pouvoir, Magnence, pour effacer définitivement la présence romaine dans les campagnes neuchâteloises.
3.2 Le royaume de Bourgogne
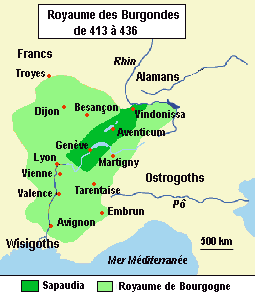 |
En 443, les Burgondes, un autre peuple germanique, se fixèrent dans la région et fondèrent la Sapaudia, qui correspond aujourd'hui aux cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Le terme de Sapaudia signifierait «pays des sapins», ce qui donnera «Savoie». Comme les envahisseurs étaient minoritaires, ils n'ont pu imposer leur langue germanique, mais ils ont grandement influencé le latin parlé par les habitants. Puis une nouvelle vague de transformations linguistiques aboutit à la disparition graduelle du latin parlé pour devenir les parlers franco-provençaux qu'on désignera par le terme de «patois». Cette transformation linguistique s'étala du Ve siècle au IXe siècle. Durant tout le Moyen Âge, les patois romands s'implantèrent partout dans toute la Suisse romande sous la forme d'un parler d'oïl dans le Jura (patois jurassien) et sous la forme de parlers franco-provençaux ailleurs en Suisse romande, notamment à Neuchâtel. Cependant, ces patois ne furent jamais écrits: on employait seulement le latin. En même temps, toute la région s'était christianisée.
En 998, des moines de Cluny fondèrent l’abbaye de Bevaix. Dès sa fondation, Bevaix forma une seigneurie sous l'administration du prieur et de ses avoués (998-1549), puis plus tard des sires de Colombier (1549-1564) et finalement des comtes, des princes et des autorités de la république de Neuchâtel (1564 à nos jours). Ses habitants s'administraient eux-mêmes en commune. |
La région fit partie de l'empire de Charlemagne, puis passa à la Lotharingie, mais celle-ci disparut vers l'an 1000. Dans le sud de la France s’implanta le royaume de Bourgogne où prit naissance Neuchâtel. L'année 1011 vit la première apparition écrite du nom de Neuchâtel dans un acte de donation du roi de Bourgogne, Rodolphe III, qui offrait à son épouse Irmengarde cet endroit fortifié.
3.3 La seigneurie de Neuchâtel
Le premier noble à porter le titre de «seigneur de Neuchâtel» fut Mangold de Fenis, vers 1150. Le territoire passa tout à tour sous la juridiction des Bourguignons, puis des Combourgeois et enfin du Saint Empire romain germanique. Le comté de Neuchâtel se soumit à l'influence franc-comtoise, puis bourguignonne lorsque les comtes de Neuchâtel devinrent les vassaux des Chalon-Arlay (1288).
Après l’occupation du comté par les Douze Cantons suisses (1512-1529), Neuchâtel devint une possession des princes français, les Orléans-Longueville, qui achetèrent la seigneurie de Valangin et la rattachent au comté (1592). Durant tout le Moyen Âge, les patois neuchâtelois restèrent le véhicule de la communication orale quotidienne dans toutes les régions ainsi que dans tous les milieux sociaux.
3.4 La Réforme protestante
En 1529, le réformiste français Guillaume Farel (1489-1565) fit une première incursion dans le comté de Neuchâtel. L'année suivante, il réussit à obtenir des bourgeois un vote légèrement majoritaire en faveur de la Réforme. Par la suite, le comté devient protestant. Après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, un vague de réfugiés huguenots vint trouver refuge à Neuchâtel afin de fuir les exactions entreprises par le roi de France. Le nord du comté commença à se peupler de nouveaux immigrants parlant le français.
Dans la région du lac de Neuchâtel, les réformistes utilisaient le français comme langue véhiculaire. Dans l'ensemble, tout le pays de Neuchâtel devint de religion protestante, bien que le prince régnant soit demeuré fidèle à la religion catholique. Après la Réforme, Neuchâtel vit arriver de nombreux réfugiés huguenots, qui jouèrent un rôle important dans le développement de ses industries, lesquelles attirèrent d’autres immigrants alémaniques, italiens, alsaciens, etc. Tout ce monde contribua à l’essor économique et à l’enrichissement intellectuel neuchâtelois.
Vers la fin du XVIIIe siècle, la pratique des patois commença à fléchir dans la ville de Neuchâtel, puis à La Chaux-de-Fonds, mais depuis près d'un siècle le français servait déjà de langue véhiculaire dans la bonne société. À l'époque du siècle des Lumières, la population du comté de Neuchâtel se rapprocha de la France et des idées libérales; les milieux horlogers furent les premiers à réclamer la fin de l'Ancien Régime et des coutumes féodales.
3.5 La Révolution française
 |
En 1798, la France annexa Genève, Neuchâtel, Bienne, le Jura qui était le territoire du prince-évêque de Bâle et Mulhouse (Alsace), sans parler de l'invasion du pays de Vaud, de Berne et du Valais. En fait, la région de Neuchâtel était alors une principauté prussienne et ne faisait pas partie de la Confédération helvétique. Cependant, en 1806, le souverain de Neuchâtel, Frédéric-Guillaume III de Hohenzollern, roi de Prusse, céda la région de Neuchâtel à Napoléon en échange du Hanovre en Basse-Saxe. Napoléon maintint le statut de principauté, sous la souveraineté du maréchal Louis-Alexandre Berthier (1753-1815), qui devient prince et duc de Neuchâtel.
En même temps, des réfugiés politiques français, appartenant principalement à l'aristocratie ou au clergé et affluèrent affluèrent en Suisse romande. Ces «émigrés» s'installèrent pour des raisons linguistiques dans les pays de Vaud et du Valais, ainsi que dans les régions de Neuchâtel et de Fribourg où un recensement en dénombrait près de 4000. La politique de répression linguistique à l'égard des langues régionales et des «patois», pratiquée lors de la Révolution française en France, fut rapidement imitée par les milieux intellectuels de la Suisse romande, notamment dans la ville protestante de Neuchâtel. La régression des patois neuchâtelois s'accentua avec l'avènement de Napoléon, car le français acquit encore plus de prestige. |
3.6 Un canton suisse
Après la chute de Napoléon, le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse réaffirma ses droits en proposant de rattacher Neuchâtel aux autres cantons suisses, dans le but d'exercer une plus grande influence sur chacun d'eux. En septembre 1814, Neuchâtel devint la capitale du 21e canton, tout en demeurant une principauté prussienne. Il fallut une révolution sans effusion de sang dans les décennies suivantes pour que Neuchâtel se débarrasse de son passé prussien et se proclame en mars 1848 «République et canton de Neuchâtel». La Prusse finit par céder ses prétentions sur le canton après la crise de Neuchâtel de 1856-1857.
Un demi-siècle plus tard, des enquêteurs interrogèrent les derniers locuteurs des patois neuchâtelois, tous septuagénaires ou octogénaires. On estime que, vers 1910-1920, les patois avaient pratiquement tous disparu. Aujourd'hui, 85 % de la population parle le français comme langue maternelle, les autres parlent le suisse alémanique ou une langue immigrante.
 |
Dans le canton de Neuchâtel, comme ailleurs en Suisse romande, on observe l'usage d'anglicismes qui peuvent se manifester sous différentes formes: anglicismes lexicaux (emprunt de mots anglais), sémantiques (utilisation d'un sens anglais pour un mot français) ou syntaxiques (calques de tournures anglaises). On peut entendre des mots comme "break" pour pause, "tip" pour pourboire, ou "switcher" pour remplacer/échanger, "low cost" pour bas prix, "meeting" pour réunion, etc., bien qu'il existe des équivalents français. Mais ce qui semble susciter le plus de controverse, c'est l'emploi du mot "sale" au lieu de «solde», mais prononcé [sal] comme l'adjectif «sale». Il suffit de regarder les vitrines des magasins où, selon la saison, les articles d'été ou d'hiver sont offerts à des prix plus accessibles. Bien sûr, dans une ville où 95% des citoyens sont francophones, l'emploi de "sale" ne fait pas plus vendre que «solde». Néanmoins, ces emprunts sont le reflet des mots à la mode dans une période donnée. |
Évidemment, le français parlé à Neuchâtel n’est pas tout à fait le même que celui parlé à Lausanne, à Paris ou à Montréal. Il est imprégné de caractéristiques héritées de son histoire et des langues qu'il a côtoyées. Ces particularités font partie du patrimoine linguistique régional et définissent l'identité de sa population.
Il est possible de résumer la politique linguistique du canton de Neuchâtel par l'article 4 de la Constitution du 24 septembre 2000 (entrée en vigueur: le 1er janvier 2002) déclarant que «la langue officielle du canton est le français». Il existe aussi un article 24 qui se lit comme suit: «La liberté des langues est garantie.» Cela signifie qu'aucune langue n'est juridiquement interdite, mais il faut comprendre aussi que cette disposition ne donne pas davantage de droits aux locuteurs des autres langues.
4.1 La langue de l'État
Le français étant l'unique langue officielle du canton de Neuchâtel, toutes les activités de l'État doivent se dérouler dans cette langue. Il n'existe aucune loi concernant la langue des débats parlementaires, mais seul le français est admis; les lois sont rédigées et promulguées en français.
- La justice
En matière de justice, le français doit être employé dans tout tribunal civil ou pénal. Le Code de procédure civile (1991) impose le français comme langue d'un procès, sinon le tribunal recourt à un interprète:
| Article 81 Langue du procès Le juge et les parties procèdent en langue française. Article 222 Interprète Le juge peut faire appel à un interprète pour traduire les déclarations des parties, témoins et experts qui sont faites dans une autre langue que la langue française. Article 257 Pièces en langue étrangère 1) La partie qui produit une pièce dans une autre langue que le français peut être requise de la faire traduire. 2) Si elle ne s'exécute pas, ou si la traduction présentée donne lieu à contestation, le juge ordonne la traduction officielle. |
L'article 59 du Code de procédure pénale neuchâtelois (2007) précise que «lorsqu'une partie produit un mémoire, une requête ou toute autre pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la traduction». Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète (art. 60).
|
Article 59 Usage de la langue française Lorsqu'une partie produit un mémoire, une requête ou toute autre pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la traduction. Interprète 1) Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète. Article 61 Traducteur 1) Lorsqu'une pièce de procédure doit être traduite en langue française, le juge désigne un traducteur. Les dispositions de l'article 60 sont applicables par analogie. |
Selon l'article 89 du Règlement général concernant la détention (2000), toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure ou d'une omission de la direction, d'une personne au service d'un établissement ou d'un comportement d'un détenu peut déposer plainte, et cette plainte doit être menée en français:
|
Article 89 Inspecteurs
2) Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une postulation publique sera ouverte. |
La Loi sur le notariat (1996-2016) exige que les actes notariés soient rédigés en français, mais le notaire peut recourir à une autre langue pour les documents destinés à l'étranger, ou si celui-ci peut lui-même faire la traduction:
|
Article 65 Article 74 Traduction 1) Si un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait l'objet d'une traduction écrite. |
- L'administration cantonale
Dans l'administration cantonale, un certain nombre de lois confirme que la seule langue employée est le français. Étant donné que le canton est situé en Suisse romande, donc à l'ouest du Röstigraben qui sépare le français des langues germaniques.
L'article 2 du Règlement sur l’état civil (2023) nonce bien que la langue officielle de l'état civil est le français :
| Article 2 Langue officielle La langue officielle des offices de l'état civil (ci-après : offices) est le français. |
La Loi sur le droit de cité neuchâtelois (2017) règle, sous réserve des dispositions fédérales, l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal. L'une des conditions matérielles précise que la personne qui le requiert doit être apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par écrit:
|
Article 17
|
L'article 89 du Règlement d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (2017) impose aux inspecteurs de police d'avoir des connaissances d'une deuxième langue utile à l'exercice de la fonction, la première étant le français :
| Article 89
Inspecteurs
2) Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une postulation publique sera ouverte. |
Il n'existe pas de loi sur la protection du consommateur dans le canton, mais le Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (2006-2022), sans proscrire les noms étrangers, interdit que les enseignes, la publicité, les étiquettes, les factures, etc., induisent les usagers en erreur:
| Article 42
Désignation 1) Les noms et prénoms du ou des pharmaciens responsables figurent en entier sur les portes d'entrée ou à la devanture de la pharmacie publique et sont suivis de la mention, en toutes lettres, de «pharmacien-e-s responsable-s». Ces noms doivent toujours être bien visibles. |
De la même façon, il faut mentionner la Loi sur la police du commerce (2014-2025) qui régit l'exercice des activités commerciales dans le canton, notamment les conditions d'exploitation, les autorisations nécessaires et les contrôles; cette loi vise à assurer la sécurité, la santé et l'ordre public dans le domaine commercial, mais elle ne fait aucune mention de la langue, sauf peut-être de façon très indirecte à l'égard des prestations commerciales qui doivent être identifiable, ce qui pourrait éventuellement inclure le français:
| Article 84 Identification 1) L'entité qui offre des prestations commerciales doit être identifiable de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et les lieux de vente tels que véhicules, stands ou automates. 2) Lorsqu’une entité offre des prestations commerciales en ligne, elle doit être clairement identifiable sur la page d’accueil de la boutique en ligne ou du site internet concerné. |
Cependant, le Règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (2014-2021) apparaît plus contraignant dans la mesure où les directives de travail doivent être remises dans une traduction française si elles sont rédigées dans une autre langue:
| Article 19 Autocontrôle en matière de denrées alimentaires 1) Sont soumis à l'exigence d'un concept d'autocontrôle selon l'article 17, alinéa 2, Loi sur la police du commerce, les établissements qui exercent des activités énumérées à l'article 18, alinéa 1, lettres d à f. 3) La personne responsable et son éventuel suppléant doivent maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène. 4) Les directives de travail doivent être conçues de manière à être comprises par les employés de l'établissement. 5) Le service peut:
Article 65 4) Les directives de travail doivent être rédigées de manière à être comprises par les employés du titulaire de l'autorisation. 5) Le service peut:
|
L'article 3 de la Loi cantonale sur les marchés publics (2023) énonce que la langue de la procédure en matière de marché public est le français:
|
Article 3 AIMP = Accord intercantonal sur les marchés publics |
L'AIMP désigne l'Accord intercantonal sur les marchés publics. Cet accord a pour but l'ouverture du marché des achats publics du canton, des communes et autres entités chargées de tâches cantonales ou communales.
4.2 L'éducation
En Suisse, la scolarisation des élèves est confiée aux cantons, de l’école enfantine à l’université (à l’exception des écoles polytechniques fédérales). Dans le canton de Neuchâtel, c’est le Département de l'instruction publique qui assure l’éducation des enfants et des adolescents. De plus, l'école neuchâteloise est « régionalisée ». Cela signifie que les compétences sont réparties entre les autorités du canton et celles de ses différentes régions ou « cercles scolaires» au nombre de sept :
| (1) École obligatoire de la région de Neuchâtel (2) Cercle scolaire de Colombier et environs (3) Cercle scolaire régional Les Cerisiers (4) Cercle scolaire du Val-de-Travers Jean-Jacques Rousseau (5) Cercle scolaire du Val-de-Ruz (6) Cercle scolaire Le Locle (7) École obligatoire de la Chaux-de-Fonds |
 |
Selon la législation, un cercle scolaire est une entité géographique regroupant les élèves de plusieurs communes pour la scolarité obligatoire. Le cercle scolaire est responsable de l'organisation et du fonctionnement de ses écoles primaires, et des élèves qui y sont rattachés en fonction de leur lieu de domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la direction scolaire.
- L'école primaire obligatoire
La maternelle est aujourd'hui obligatoire et elle est incluse dans le système d'éducation. Ce type d'école gratuite accueille les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet dans l'école de la commune de leur domicile. Il leur est possible de fréquenter l'école d'une autre commune lorsqu'elle est sensiblement plus proche de leur domicile ou lorsque l'organisation des classes le justifie.
L’école primaire, qui dure cinq ans, est gratuite et obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Elle comprend deux cycles:
- Cycle 1: comprend les quatre premières années de scolarité. Il vise à assurer la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire et à entrer dans les apprentissages. L’enseignement se donne en français et le programme d’enseignement comporte les disciplines suivantes: le français, les mathématiques, la géographie, l'histoire, les sciences, les activités créatrices manuelles, le dessin, le chant et la musique, l'éducation physique.
- Cycle 2: comprend les années 5 à 8, alors que les élèves y développent leurs connaissances et compétences, mais l’apprentissage de l’allemand débute en 5e année et celui de l’anglais en 7e.
- Cycle 3: comprend les trois dernières années de scolarité obligatoire (9e, 10e et 11e années).
Degré primaire
Degré secondaire I
1er cycle
2e cycle
3e cycle
1re
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
Afin que chaque élève puisse mettre en évidence ses compétences, notamment afin de mieux s’orienter vers les formations post-obligatoires offertes, le canton de Neuchâtel a opté, comme d’autres cantons, pour une structure avec un enseignement à deux niveaux des disciplines fondamentales, introduit de manière progressive entre les années 9e et 10e. En dernière année du cycle 3, l’élève doit choisir une option afin de préciser son profil en fonction du choix de formation au post-obligatoire.
Le programme général comporte les disciplines suivantes: le français, l'allemand, l'anglais, les mathématiques, la biologie, l'histoire, la géographie, le dessin artistique, l'éducation musicale, les activités manuelles sur textiles, cartonnage, bois, et l'éducation physique.
- Le secondaire
Dans le canton de Neuchâtel, l'école secondaire est composée de deux formations principales : la formation gymnasiale et la formation d'école de culture générale. Les deux types de formation mènent à différents types de formations supérieures après le secondaire. Les deux types de formation mènent à différents types de formations supérieures après le secondaire.
- La formation gymnasiale: prépare aux études universitaires, aux écoles polytechniques fédérales et aux hautes écoles pédagogiques.
- La formation d'école de culture générale: offre une formation plus large, axée sur des domaines spécifiques comme la culture, l'économie ou les sciences sociales; cette formation consiste en un approfondissement de branches générales (français, langues étrangères, mathématiques, sciences humaines et expérimentales, etc.) en vue de l'acquisition de connaissances dans un domaine particulier choisi et au développement de compétences professionnelles de savoir-être.
Dans tous les cas, les élèves doivent maîtriser une langue nationale et acquérir de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales et étrangères; ils doivent être capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendre à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.
Les articles suivants du Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (1995) explicitent le contenu linguistique de la formation:
| Article 9 Disciplines de maturité et autres disciplines obligatoires 1) Les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et le travail de maturité constituent l'ensemble des disciplines de la maturité. 2) Les disciplines fondamentales sont:
3) L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:
Article 12 Article 18 |
La CDIP désigne la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique qui est une conférence intercantonale réunissant l'ensemble des 26 membres des gouvernements cantonaux suisses responsables des secteurs de l'éducation, de la formation, de la culture et des sports dans leurs cantons respectifs.
- Les langues étrangères
Tous les élèves doivent commencer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale et de l'anglais à l'école primaire, au plus tard en 3e et en 5e année scolaire (comptage basé sur neuf années de scolarité obligatoire); en incluant dans la scolarité obligatoire, comme prévu par l'accord intercantonal de 2007 (ou concordat Harmos; voir la liste des cantons participants),
En juin 2008, le canton de Neuchâtel adhérait à l'harmonisation intercantonale (voir la liste des cantons participants) en ce qui a trait à l'enseignement des langues étrangères, pour un total de trois:
| Article 4
Enseignement des langues 1) La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l’article 6. L’une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale, et son enseignement inclut une dimension culturelle ; l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l’école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.2) Une offre appropriée d’enseignement facultatif d’une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire. |
- L'intégration des immigrants
Il existe aussi des classes d'accueil destinées aux élèves en provenance de l’étranger. À l’école primaire, ces élèves sont en général placés dans les classes ordinaires et bénéficient de mesures de soutien. À l’école secondaire, les élèves de langue étrangère dont les connaissances scolaires et notamment linguistiques sont insuffisantes pour leur permettre d’être intégrés directement dans les classes ordinaires ont la possibilité de fréquenter des classes d’accueil. L’enseignement dans les classes d’accueil prévoit un apprentissage aussi rapide que possible du français, la consolidation et la mise à niveau des connaissances scolaires nécessaires à une intégration dans une classe ordinaire correspondant à l’âge et aux possibilités de l’élève. Ces classes d'accueil sont généralement disponibles dans les communes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
La Loi sur l'intégration et la cohésion multiculturelle (1996-2023) vise à favoriser l'intégration des immigrants qui sont de plus en plus nombreux en Suisse, notamment en favorisant l'apprentissage de la langue française, le plurilinguisme et, si nécessaire, le recours à des interprètes et des traducteurs :
| Article 7 Communauté, délégué et service 1. domaines d'activités 1) La communauté, le délégué et le service peuvent agir, en particulier, dans les domaines suivants:
|
En somme, le service de la Cohésion multiculturelle du canton travaille sur l'intégration des étrangers, y compris dans le domaine linguistique
L'Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d’origine dans la scolarité obligatoire (2017) a pour but de définir les cours de langue et de culture d'origine (appelés LCO) et leur reconnaissance par le Département de la formation et des finances (DFFI):
| Article 2 Cours LCO 1) Les cours LCO permettent aux élèves d'étendre les connaissances qu'ils ont de leur langue et de leur culture d'origine. 2) Ces cours comprennent de deux à quatre périodes d’enseignement par semaine et sont facultatifs. 3) L’enseignement des cours LCO s’inscrit dans les finalités et objectifs de l’école publique ainsi que dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Article 3 Accès aux cours LCO L’élève dont la langue d’origine de sa famille est différente du français ou qui a la nationalité d’un pays dont la langue officielle n’est pas le français peut suivre des cours LCO dans la langue concernée. |
- Les études supérieures
Les jeunes Neuchâtelois qui veulent fréquenter une université peuvent s'inscrire à l'Université de Neuchâtel. Cette université compte cinq facultés et plus d'une dizaine d'instituts: lettres et sciences humaines, sciences, droit, sciences économiques et théologie. L'Université est soumise à la Loi sur l'Université (2016) qui impose le français comme langue officielle:
| Article 6 Langue 1) La langue officielle de l’Université est le français. 2) L’Université décide en quelles autres langues des enseignements peuvent être donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein. 3) Elle encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les études bilingues. |
- Les établissements privés
La ville de Neuchâtel compte, outre les cursus publics professionnels ou traditionnels, plusieurs établissements indépendants, dont une école internationale, quelques écoles privées, un centre de perfectionnement horloger, un lycée artistique ainsi qu’une école préuniversitaire anglophone pour étudiantes et étudiants venus du Canada. Ces établissements privés établis sur le territoire communal font de Neuchâtel un véritable campus, où se mêlent de nombreuses nationalités et des centres d'intérêt variés.
La Loi sur l'organisation scolaire (1984) prévoit des dérogations pour les élèves dont le français n'est pas la langue maternelle:
| Article 7 L'enseignement privé 1) L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit être équivalent à celui des écoles publiques. 2) Le Département de la formation et des finances peut admettre des dérogations, notamment pour les élèves de langue maternelle étrangère dont le séjour dans le canton est temporaire. Article 10 2) Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités. 3) Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités des élèves. |
Ainsi, le Neuchâtel Junior College, une école indépendante canadienne, fondée à Neuchâtel en 1956 par un enseignant britannique, offre un programme préuniversitaire d’un an à une centaine d’étudiants venus du Canada. L’enseignement est donné en anglais, conforme au système scolaire canadien, mais les élèves doivent suivre également des cours de français. Ils habitent durant cette année dans des familles de la région neuchâteloise.
4.3 Les médias
 |
Le canton de Neuchâtel, comme tout autre canton suisse, n'a pas davantage de politique particulière à l'égard des médias. Outre les journaux francophones de France ou de la Suisse romande tels que La Tribune de Genève, Le Temps, etc., ainsi que l'Arcinfo. Le , les journaux L'Express et L'Impartial ont fusionné, créant ainsi un quotidien unique au nom de Arcinfo diffusé dans l'ensemble du canton de Neuchâtel. Il existe des hebdomadaires régionaux, mais l'Arcinfo demeure principal média écrit à traiter de sujets neuchâtelois. |
Dans les médias électroniques, les Jurassiens disposent de la Radio suisse romande (Lausanne) et de la Télévision suisse romande ou TSR (Genève), de la RFJ (Radio Fréquence Jura) qui émet sur le territoire du canton du Jura ainsi que dans les régions neuchâteloises de Chaux-de-Fonds et du Locle. La TSR diffuse quotidiennement près de 35 heures de programmes sur deux chaînes, TSR 1 et TSR 2. Elle diffuse des informations immédiates, des informations internationales, nationales et régionales, des découverts sur la culture, la science et la société et des émissions pour la jeunesse. Lancée en septembre 1987, la station régionale Canal Alpha est devenue la première télévision cantonale de Suisse, puis en 2001 la première télévision en Suisse à disposer d'une structure de production entièrement numérique.
Il existe plusieurs stations radiophoniques régionales diffusant en français, mais également de nombreuses stations étrangères en français (France, Luxembourg, Belgique, Monaco), en allemand (Suisse et Allemagne), en italien (Suisse et Italie), en anglais (Royaume-Uni, Suisse), etc. Les Jurassiens se laissent tenter par les émissions radiotélévisées en provenance non seulement de Genève (Léman Bleu), mais aussi de France (TF1, France2, France3, TV5 Monde, etc.), du Luxembourg (RTL9) ou de Monaco (Telemontecarlo).
![]()
Le canton de Neuchâtel pratique une politique linguistique d'unilinguisme français. Si ce n'était que de l'éducation, toute la politique se résumerait à la non-intervention. Et en matière d'éducation, le Département de l'instruction publique met à la disposition des nouveaux arrivants des classes d'accueil. Il n'existe aucune politique concernant le «patois neuchâtelois» considéré comme disparu. Cette attitude démontre que les problèmes linguistiques ne semblent pas avoir atteint ce canton suisse officiellement de langue française.
|
| Accueil: ménagement linguistique dans le monde |