 |
Canton du Jura(Confédération suisse) |
|
République et canton du Jura |
 |
Canton du Jura(Confédération suisse) |
|
République et canton du Jura |
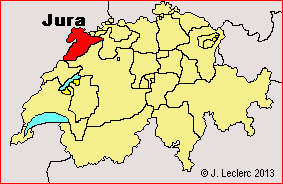 |
Le canton du Jura (JU) — officiellement République et canton du Jura — fait partie des quatre cantons francophones unilingues (avec Vaud, Neuchâtel et Genève) de la Confédération suisse. Il est situé au nord-ouest de la Suisse près de la frontière française. Au sud, se trouvent les cantons de Neuchâtel et de Berne, à l'est ceux de Soleure et de Bâle-Campagne. De l'autre côté de la frontière suisse, on trouve les départements français du Doubs, du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) et du Haut-Rhin (région Alsace). Le Jura est un petit canton de 838 km² par comparaison à celui de Berne (5959 km²) ou de Vaud (3212 km²). La capitale du canton est Delémont. Sa frontière avec la France est longue de 121 kilomètres et de 111 kilomètres avec les cantons voisins de Bâle-Campagne, de Soleure, de Berne et de Neuchâtel. |
1.1 L'appellation de Jura pour des entités distinctes
Le Jura est d'abord une chaîne de montagnes qui s'étend en France, en Suisse et en Allemagne (le «Jura souabe») et qui a donné son nom à la deuxième période du Mésozoïque ou «ère secondaire» : le Jurassique. Voir la carte des frontières des deux pays avec le massif du Jura. Sur le plan administratif l'appellation de Jura peut désigner trois entités différentes: un district bernois, un canton suisse et un département français.
 |
|
 |
En Suisse, le massif du Jura s'étend sur plus de 360 km le long de sa crête principale entre Voreppe (Isère, en France) et Dielsdorf (Zurich, en Suisse). Divisé par la frontière entre la France et la Suisse, le massif du Jura est traditionnellement séparé en deux entités: le «Jura français» et le «Jura suisse». En Suisse, le Jura constitue l'une des trois grandes régions géographiques avec le Plateau suisse et les Alpes. |
1.2 L'organisation territoriale
|
Le canton du Jura est divisé en trois districts :
Il regroupe 50 communes réparties de la façon suivante dans les districts:
|
 |
En 2023, la population du canton du Jura était de 74 53 habitants. Pour les individus âgés de 15 ans et plus, 80 % des Jurassiens avaient en 2023 le français comme langue maternelle, contre 4,4 % pour le suisse allemand, 2,5 % pour l'italien, 2,1 % pour le portugais, 2,0 % pour l'espagnol, 1,8 % pour l'anglais, 1,6 % pour l'allemand standard, 1,6 % pour l'albanais, etc.
| TOTAL | Français | Suisse allemand | Italien | Portugais | Espagnol | Anglais | Allemand | Albanais | Autres langues |
| 70 731 | 56 583 | 3152 | 1779 | 1554 | 1474 | 1331 | 1131 | 1143 | 2584 |
| 100 % | 80,0 % | 4,4 % | 2,5 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,6 % | 3,6 % |
La quasi-totalité de la population du canton du Jura parle le français soit comme langue maternelle (au moins 80%) soit comme langue seconde. De ce fait, le Jura suisse fait partie intégrante de la Suisse romande. On a souvent associé le canton du Jura suisse à la «Suisse française» parce que l'origine de la plupart des Jurassiens francophones relève du franc-comtois, une langue d’oïl (voir la carte), et non du franco-provençal comme les autres cantons francophones suisses.
Aujourd'hui, on croit qu'environ 5% des Jurassiens parlent encore le franc-comtois répartis en trois variantes: l'ajoulot (district de Porrentruy), le taignon (district des Franches-Montagnes) et le vâdais (district de Delémont); mais certains croient que ce patois est disparu. Ces parlers franc-comtois, appelés aussi «patois jurassien», sont demeurés très vivants dans le Jura jusqu'au milieu du XIXe siècle, mais ils sont disparus de l'usage au début dès le début du XXe siècle pour être remplacés par le français. Ces parlers représenteraient en Suisse une originalité linguistique particulière qui a influencé directement la langue française parlée par les habitants et les ressortissants du canton du Jura.
 |
La commune d'Ederswiler (environ 120 habitants) dans le district de Delémont est une petite commune du canton du Jura située au nord près de la frontière française et mitoyenne avec le canton de Bâle-Campagne (BL, en allemand : Basel-Landschaft). Ederswiler fut rattachée en 1815 au canton de Berne, mais le passage de cette partie du canton de Berne le 1er janvier 1979 au canton du Jura nouvellement créé eut pour effet de maintenir le village dans le canton du Jura. Aujourd'hui, c'est l'unique commune germanophone du canton, puisque 85 % de sa population est de langue maternelle suisse allemande. En raison de sa proximité avec la France (à 3,2 km de la frontière), une part importante de la population comprend le français qui est enseigné aux enfants dans la commune voisine de Movelier. |
Au Ve siècle avant notre ère, des tribus gauloises étaient installées dans la région du Jura, notamment des Helvètes, des Rauraques et des Séquanes (voir la carte).
3.1 La romanisation
Après la conquête des Gaules par Jules César, entre 58 et 51 avant notre ère, ce sont les Romains qui s'implantèrent dans la région. Le passage à l’époque romaine n'a vraiment lieu qu'au cours de la première moitié du premier siècle de notre ère, avec la construction des routes romaines. La région de l'Ajoie (Porrentruy) et la vallée de Delémont furent parsemées de villas gallo-romaines, réparties sur tout le territoire.
Pendant quatre siècles, Rome exerça sur la région son influence économique et culturelle, donc linguistique. Les populations celtes se latinisèrent progressivement d'autant plus que les routes favorisèrent la diffusion des idées et de la culture romaines. La population locale abandonna progressivement sa langue celtique pour le latin, symbole de la civilisation prestigieuse des Romains. À partir du IIIe siècle, la langue latine parlée par les habitants commença à subir des changements importants en raison de l'affaiblissement du pouvoir romain et des menaces venant des peuples germaniques plus au sud.
Au milieu du IVe siècle, soit vers 353-354 puis en 378, les Alamans, une nation germanique, profitèrent des luttes entre l'empereur Constant Ier et l'usurpateur du pouvoir, Magnence, pour effacer définitivement la présence romaine dans les campagnes jurassiennes. Seuls quelques villages conservent encore aujourd'hui un toponyme d'origine latine (p. ex., Chevenez, Montignez, Vicques, etc.).
3.2 La Sapaudia
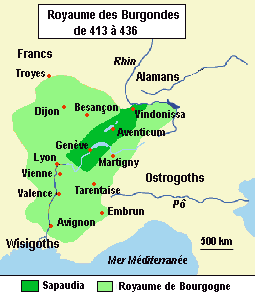 |
Au Ve siècle, les Burgondes, un peuple germanique, envahirent le territoire qui constitue aujourd'hui la Suisse romande. Ils fondèrent la Sapaudia, terme qui signifierait «pays des sapins», ce qui donna la «Savoie». Comme les envahisseurs étaient minoritaires, ils n'ont pu imposer leur langue germanique, mais ils ont grandement influencé le latin parlé par les habitants. D'ailleurs, de nombreux noms de villages du Jura datent de cette époque: tous les noms de villages commençant ou se terminant par -cour(t) ou -cor(t), ainsi que les noms de lieux en -vilier, -velier, -vilard, etc. Le mots latins curtis et villare signifiaient tous deux «domaine, propriété rurale».
Puis une nouvelle vague de transformations linguistiques aboutit à la disparition graduelle du latin parlé pour devenir les parlers d'oïl (comme le français) qu'on désignera par le terme de «patois». Cette transformation linguistique s'étala du Ve siècle au IXe siècle. Durant tout le Moyen Âge, les patois romands s'implantèrent partout dans le Jura ainsi que dans toute la Suisse romande. Cependant, les patois ne furent jamais écrits: on employait le latin. En même temps, toute la région se christianisa. C'est à cette époque que vécurent saint Ursanne, saint Brais, saint Imier, etc. Ce fut également l'âge d'or de l'abbaye de Moutier-Grandval. Le nord du Jura, notamment l'Ajoie, faisait alors partie du diocèse de Besançon (aujourd'hui en France) et appartenait au royaume de Bourgogne (888-1032). Quatre comtés de la Bourgogne, dont devaient naître plus tard la Provence, le Dauphiné, la Savoie et la Franche-Comté, avaient acquis une autonomie croissante. |
3.3 L'évêché de Bâle
 |
L'histoire du canton du Jura commença en 999, lorsque le dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III (de 993 à 1032), légua à l'évêque de Bâle, Adalbéron II (de 999 à 1025), l'abbaye de Moutier-Grandval et ses dépendances. À partir de 1032, l'évêché de Bâle fut rattaché au Saint Empire romain germanique. L'évêque de Bâle avait à sa disposition un véritable État indépendant à l'extérieur de son propre diocèse. Cet acte de donation représente en quelque sorte la naissance du Jura historique dont l'étendue est déterminée en grande partie par les possessions de l'abbaye de Moutier-Grandval.
En 1053, le pape Léon IX confirmera à l'évêque de Bâle cet acte de possession. À la suite de cette donation territoriale, avec tous les droits de propriété et de souveraineté correspondants, l'évêque de Bâle devenait, en plus de sa fonction ecclésiastique à la tête du diocèse de Bâle, le souverain temporel d'un territoire situé sur un autre diocèse (Besançon). Au fil du temps, la principauté épiscopale de Bâle (en allemand : Fürstbistum Basel) acquit de nouveaux territoires: les Franches-Montagnes, le littoral biennois, Porrentruy et l'Ajoie (la pointe suisse au nord). Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le Jura et l'Alsace firent tous deux partie de l'évêché de Bâle, comme en témoignent les villes de Colmar, Rouffach, Enisheim, Thann, Mulhouse et Altkirch. Aujourd'hui, Laufen fait partie du canton de Soleure et Bienne, celui de Berne. |
Avec le temps, le «patois jurassien» (une langue d’oïl) emprunta de nombreux mots à la langue alsacienne, ce qui distinguera ce «patois» des autres parlers, par exemple dans le canton de Fribourg, qui sont d'origine franco-provençale. L'évêché de Bâle utilisait deux langues officielles administratives: le latin et l'allemand. Mais dans la vie quotidienne, les habitants employaient exclusivement le «patois jurassien». De son côté, les prêtres de l'Église catholique recouraient à l'oral au patois jurassien et au suisse alémanique, mais on écrivait en latin.
Le 17 novembre 1384, le prince-évêque Imier de Ramstein (1382-1386) accorda une charte de franchises afin de défricher et de peupler les Franches-Montagnes, une région alors couverte de forêts et encore peu peuplée. Cette franchise fut rédigée en français (l'évêque s'adressait à des colons français), non en latin ni en allemand ni en patois jurassien:
| Nous Imer de Ramstein par la grace de Dieu et du Saint Siège apostolique Evêque de Bâle, savoir faisons a tous et un chacun qui les présentes lettres verront et entendront ; que Nous considérant notre grand et évident profit et avantage, de notre Eglise de Bâle pour nous et nos successeurs, par l'exprèt consentement, volonté et sçu de nos vénérables frères les Prévot, Doyen et Chapitre de l'églïse de Bâle, nous avons fait exempts et libres et par les présentes lettre, faisons libre et exempt de toute tailles et exactions ou impositions tous et singuliers les personnes des deux sexes et leurs héritiers perpétuellement demeurant et habitans par la suite dans la Montagne du faucon et dans les districts retenus dans l'étenduë et limites souscrittes et ici insérés, savoir depuis l'Epine du Montfaucon jusqu'aux limites dittes es dilles de longueur et largeur et depuis les champs de Trameland jusqu'a la rivière ou cours de l'eau du Doub, voulons et promettons par les présentes lettres que toutes et chaque personnes des deux sexes venantes et se transportantes dez les seigneuries et domaines étrangers, pour demeurer et résider dans ledit lieu, dans les limite et étendues préscrittes, qu'eux et leurs heritiers soient et devronts être perpétuellement libres et allibérés de taille et impots comme il est exprimé cidessus. [...]
Donné et fut fait a Bâle l'an de notre Seigneur, mil trois cens quatre vingt quatre le dix septième novembre, qui était le jour de l'octave de la Fête du Bienheureux Martin Evêque. |
Or, les colons qui s'installèrent dans les Franches-Montagnes venaient du Jura français, mais également de la Franche-Comté et de la Bourgogne. Ces nouveaux colons contribuèrent à modifier la composition du patois jurassien. En 1486, les troupes bernoises envahirent l'abbaye de Moutier et agirent en conquérants. C'est à cette époque que les habitants du Jura du Sud s'affirmèrent comme appartenant au canton de Berne. En 1531, les habitants de Moutier adoptèrent la Réforme et pillèrent l'abbaye de Moutier; les chanoines, héritiers des moines, quittèrent la ville de Moutier en 1534 pour la ville voisine de Delémont, en emportant avec eux la célèbre Bible dite d’Alcuin héritée du IXe siècle, et écrite en latin, et décorée d’enluminures par les moines de l’abbaye de Saint-Martin de Tours (France).
Dès lors, dans tout le Sud jurassien, le français remplaça systématiquement le patois jurassien dans l'enseignement des préceptes de la religion réformée; celui-ci perdit tout prestige pour se confiner aux communications informelles. Dans le Nord, le patois franc-comté de France se perpétua, de même que la religion catholique romaine.
Après 1648 et les traités de Westphalie, le Jura, séparé du reste du Saint Empire romain germanique, accrut ses liens avec la Confédération helvétique. La situation se perpétua jusqu'en 1792, alors que le dernier prince-évêque de Bâle fut chassé de sa résidence de Porrentruy au moment de la Révolution française.
3.4 La Révolution française et la francisation
Le 17 décembre 1792, fut proclamée à Porrentruy la «République libre et indépendante de la Rauracie», qui ne dura que quelques mois. Elle comprenait les régions de Porrentruy, Saint-Ursanne, Delémont, Laufen et les Franches-Montagnes. Cette brève période d'indépendance fut à l'origine de la dénomination «République» qui sera adjointe à la création du canton du Jura en 1978 («République et canton du Jura»).
 |
Le 23 mars 1793, la Convention française annexa la nouvelle république autoproclamée et en fit le 87e département français sous le nom de département du Mont-Terrible, avec les districts de Porrentruy, chef-lieu, et de Delémont, siège du commandement militaire. La France devait aussi annexer le département du Simplon (1810) et le département de Léman (1798). Pour la première fois de son histoire, le français devint la langue officielle du Jura. Durant toutes ces années, seul le français fut employé par les autorités françaises. Les patois périclitèrent davantage, mais réussirent néanmoins à survivre. |
3.5 L'intégration dans le canton de Berne
| Après la défaite napoléonienne, le Congrès de Vienne de 1815 annexa le Jura à la Suisse en l'attribuant au canton de Berne. Très tôt, des tensions se manifestèrent entre les francophones et les germanophones du canton de Berne. En 1830, des Jurassiens s'organisèrent pour résister à l'érosion progressive de leur autonomie. L'agitation populaire se répandit, pendant qu'un bataillon bernois était envoyé dans l'Ajoie. Certains Jurassiens militèrent pour faire avancer un projet visant à séparer l'ancien Jura du canton de Berne. Les autorités bernoises ordonnèrent aux préfets de dénoncer les instigateurs de cette proposition, puis dépêchèrent en 1836 une douzaine de bataillons d'infanterie dans le Jura en faisant arrêter les préfets et les notables. Deux ans plus tard, les députés jurassiens demandèrent le maintien de la législation française dans le Jura. En 1839, les députés jurassiens réunis à Glovelier (village situé à l'est de Delémont) réclamèrent l'autonomie du Jura. |
- Les mouvements migratoires
L'arrivée de l'horlogerie en Suisse entraîna d'importants mouvements migratoires. Les populations du Jura du Nord, du Jura du Sud et d'une partie du canton de Neuchâtel se mélangèrent, tandis que la population augmentait considérablement; de nombreux paysans vinrent de l'Oberland bernois ainsi que des cantons de Neuchâtel et de Vaud. Ces grands brassages de population contribuèrent largement à l'extinction du patois jurassien au profit du français. De plus, l'industrialisation provoqua une immigration massive dans le Jura du Sud, dont la population doubla entre 1818 et 1900. Un tel brassage de la population entraîna la disparition rapide des patois traditionnels en l'espace de deux à trois générations. Rappelons que le patois jurassien constitue une variété des langues d’oïl et qu'il n'a jamais été unifié, voire plus ou moins différent d'un village à l'autre; il n'a pu s'opposer au rouleau compresseur du français hautement normalisé.
Dès la seconde moitié du XIXe siècle, le Jura bernois présentait un éventail linguistique passablement modifié. Plus du tiers de la population, notamment à Moutier et à Delémont, parlait le suisse alémanique. Jusqu'en 1900, l'agglomération de Delémont était considérée comme une ville bilingue au point de vue démographique! Il s'agissait déjà d'un bilinguisme français-alémanique. De ce rapport de forces, c'est le français qui allait tirer davantage ses marrons du feu.
- Les mouvements sécessionnistes
Dès lors, les rivalités entre les francophones du Jura du Nord et les germanophones du Sud s'aggravèrent. Les autorités bernoises tentèrent de germaniser le nom de certaines agglomérations: par exemple, La Scheulte et l'Elay devinrent respectivement Schelten et Seehof. En 1917, un mouvement sécessionniste vit le jour, mais la population ne manifesta pas immédiatement son adhésion. Néanmoins, le Jura francophone résista aux velléités centralisatrices de Berne et réussit à préserver la langue française et sa culture, tandis que l'Ours bernois (cf. le drapeau de Berne) continuait d'administrer les Jurassiens par la force.
 |
Un mouvement sécessionniste jurassien se constitua en 1949 lors de la création du Rassemblement jurassien (à l'origine du drapeau du Jura) en 1951, dont le but était est la formation d'un futur canton du Jura. Un hebdomadaire vit le jour, Le Jura libre, suivi d'une fête annuelle: la Fête du peuple jurassien. En 1962 naissait un nouveau mouvement sécessionniste: le Groupe Bélier. Les militants autonomistes menèrent une lutte pacifiste qui aboutit en 1978 à un vote populaire historique. En effet, tous les citoyens suisses furent appelés à se prononcer sur la création d'un nouveau canton, le 26e de la Confédération suisse. Le nouveau canton devait regrouper toutes les communes francophones jurassiennes alors administrées par le canton de Berne. |
3.6 La formation du canton du Jura
 |
Lors d'un de ces référendums dont la Suisse a le secret, la population suisse approuva majoritairement la création du nouveau canton. Cependant, certaines communes du Jura bernois, pourtant francophones, refusèrent d'entrer dans le nouveau canton et préférèrent rester dans le canton de Berne, prospère et surtout protestant comme elles; ce n'est pas tant l'appât du gain que la religion qui les a retenus. À la suite d'une procédure unique (consultation du 23 juin 1974), le Jura fut en 1975 divisé en deux: la moitié septentrionale (districts de Delémont, de Porrentruy et des Franches-Montagnes) obtint le statut de «canton autonome», alors que la moitié méridionale demeura rattachée au canton de Berne (districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville) sous le nom de Jura bernois. Le 20 mars 1977, le peuple jurassien approuva la Constitution par plus de 80 % des votants. La Constituante l'avait elle-même approuvée à l'unanimité, le 3 février 1977 dans la collégiale catholique romaine de Saint-Ursanne (un monastère du XIe siècle). Le 24 septembre 1978, la population suisse et tous les cantons acceptèrent la création officielle de la «République et canton du Jura» au sein de la Confédération suisse. Le nouveau canton fut créé le 1er janvier 1979 et fut constitué de trois districts: Delémont, Porrentruy et Franches-Montagnes. |
 |
Toutefois, ce n'était pas tout à fait encore terminé! Après une longue procédure, le district alémanique de Laufen (en jaune sur la carte ci-contre) rejoignit le canton de Bâle-Campagne (BL : Basel-Landschaft en allemand) en 1994 et la commune de Vellerat (ancien nom allemand: Weiler) quitta le canton de Berne le 1er juillet 1996 pour devenir la 83e commune jurassienne. En 1996, on trouvait 77 électeurs dans le village d'Ederswiler, dont 35 avaient voté pour la création du canon du Jura (c'étaient les catholiques), tandis que 42, les protestants, avaient voté pour rester bernois et bernoises. Ederswiler dut demeurer dans le canton du Jura parce qu'il n'avait pas de frontière commune avec le canton de Bâle-Campagne. |
De plus, à la suite de l'accord du 25 mars 1994, une Assemblée interjurassienne fut créée entre les cantons de Berne et du Jura ainsi que la Confédération (le Conseil fédéral) afin de «promouvoir le dialogue entre les Jurassiens des deux côtés de la frontière», de proposer une collaboration renforcée entre le canton du Jura et le Jura bernois et d'élaborer les instruments de cette collaboration. L'Assemblée eut pour mandat :
a) de promouvoir, dans divers cercles et milieux du canton du Jura et du Jura bernois, le dialogue entre les Jurassiens des deux côtés de la frontière sur l’avenir de la communauté jurassienne;
b) de proposer une collaboration renforcée entre le canton du Jura et le Jura bernois dans des dossiers déterminés et des projets concrets;
c) de proposer les instruments de la collaboration: conventions ou institutions communes.
En septembre 2004, cette assemblée entama ses travaux afin d'étudier la faisabilité d'une telle entité à six districts. Cette étude eut l'aval du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) qui lança une initiative cantonale en 2004 et qui fut acceptée par la Chambre parlementaire, alors que le gouvernement cantonal en demandait son rejet. En février 2007, l'Assemblée Interjurassienne (AIJ) émit l'idée de deux demi-cantons, l'un composé par la république et canton du Jura et l'autre composé du Jura bernois actuel, tout en continuant l'étude d'une unification. Finalement, le canton du Jura reste composé de trois districts: Delémont, Porrentruy et Franches-Montagnes. Quant au patois jurassien (franc-comtois), bien qu'il ne soit plus réellement parlé, de nombreux partisans tentent de le faire revivre.
3.7 Moutier dans le canton du Jura
En juin 2017, lors d'un référendum, la commune de Moutier a voté pour se séparer du canton de Berne et rejoindre le canton du Jura. Le 17 septembre de la même année, les communes voisines de Belprahon et de Sorvilier ont voté pour rester dans le canton de Berne, ce qui signifie que le vote de Moutier fut ensuite déclaré invalide. En mars 2021, la population de Moutier a voté de nouveau pour se séparer de Berne lors d'un référendum officiellement approuvé. Quant aux citoyens jurassiens, le 24 novembre 2024, ils se sont prononcés sur l'établissement d'un quatrième district au sein de leur canton : le district de Moutier. Constitué uniquement de la commune de Moutier, ce district permettra à la ville de former une nouvelle circonscription électorale pour les élections au Parlement jurassien lors des élections prévues à l'automne 2025.
 |
Puis les Chambres fédérales se sont prononcées en mars 2025 sur l'arrêté relatif à la modification territoriale découlant de ce transfert. Cette étape étant franchie, la commune de Moutier deviendra donc officiellement jurassienne à compter du 1er janvier 2026.
Or, le Jura bernois, historiquement francophone, a longtemps été en conflit avec le canton de Berne, majoritairement alémanique, en raison de différences culturelles, linguistiques, économiques et religieuses. Le changement d’appartenance cantonale d’une commune de l’importance de Moutier (7300 habitants), seule localité de la région ayant le rang de ville, constitue un événement inédit en Suisse. Ce transfert de canton, rappelons-le, ne touche que la commune de Moutier (19,6 km²) et non tout le district de Moutier (216 km²) du Jura bernois. Pour le canton de Berne (5960 km²), c'est une perte de territoire minime. |
Afin d’éviter tout vide juridique, de nombreuses modifications constitutionnelles et législatives auront été nécessaires. Les modifications territoriales auront un impact sur les institutions cantonales. Durant une période transitoire correspondant à une législature, la commune de Moutier formera une circonscription électorale et pourra élire jusqu’à 7 représentants sur 60 au Parlement jurassien. Les services publics (écoles, administration, etc.) devront être transférés ou adaptés pour fonctionner dans le nouveau cadre cantonal.
Toutefois, le transfert de Moutier du canton de Berne vers le canton du Jura ne met pas nécessairement fin à la question jurassienne qui pourrait rebondir. En effet, des communes francophones restées bernoises (Crémines, Corcelles, Eschert, Grandval et Elay) risquent de se sentir «coupées du monde», leur débouché géographique naturel étant Moutier. D'ailleurs, les deux communes de Belprahon (B) et de Sorvilier (S) sont considérées comme des communes-centre de Moutier, ce qui signifie qu'elles sont étroitement liées à la ville sur le plan géographique et administratif. Le gouvernement jurassien a exprimé son souhait que ces deux communes rejoignent Moutier dans le canton du Jura. Rien n'assure que les frontières cantonales ne bougeront pas à nouveau.
Il n'existe qu'une seule loi linguistique dans le canton, ainsi qu'une vingtaine de lois non linguistiques comptant des dispositions concernant la langue française. C'est à partir de ces dispositions qu'on peut élaborer la politique linguistique du canton.
4.1 Le français et le patois jurassien
Ajoutons aussi l'article 3 de la Constitution du 20 mars 1977, qui proclame que «le français est la langue nationale et officielle de la République et canton du Jura». Il s'agit ici de l'unique proclamation officielle concernant le français:
|
Article 3 Langue |
On peut présumer que le canton pratique ainsi une politique d'unilinguisme français.
L'article 42 de la même Constitution demeure l'une des rarissimes dispositions portant sur le «patois jurassien». Le paragraphe 2 mentionne que l'État et les communes «veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois»:
|
Article 42 Activités culturelles 1) L'État et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion. 2) Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois. 3) Ils favorisent l'illustration de la langue française. |
La Loi sur l'encouragement des activités culturelles (1978) fait également allusion au patois jurassien ou franc-comtois. Le paragraphe a) de l'article 4 énonce que le patois fait partie des biens culturels traditionnels au même titre que les découvertes archéologiques, les monuments artistiques et historiques, les collections des musées, bibliothèques et archives, l'art populaire et le folklore:
| Article 4
L'encouragement des activités culturelles par l'État et les communes et l'activité culturelle de l'État et des communes s'étendent
|
Il s'agit bien de folklore, car aucun Jurassien ne parlerait encore le patois local comme langue maternelle.
4.2 La langue de la législation
Étant donné que le français est la langue officielle du Jura, toutes les activités de l'État doivent se dérouler dans cette langue. Selon l'article 51 de la Loi d’organisation du Parlement (2020), les députés doivent s'exprimer en français:
| Article 51 Langue Les députés s’expriment en français. |
Ce type de disposition concernant la langue parlementaire est le seul apparaissant dans un texte juridique de la part d'un canton unilingue francophone (Jura, Neuchâtel, Vaud et Genève).
En Suisse, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral ou des cantons, on fait une distinction subtile entre une loi, un arrêté, un décret, une ordonnance, un règlement ou une directive. À tous les niveaux de gouvernement, on emploie ces termes dans les actes normatifs. Ce que l'on sait encore moins, c'est que ces termes peuvent entraîner des référendums; donc, il faut les employer à bon escient. Pour plus de précisions, on peut consulter une page à ce sujet: Les particularités lexicales dans les distinctions des actes normatifs en Suisse.
4.3 La langue de la justice
Dans le canton du Jura, la justice en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale est rendue par le Tribunal cantonal, le Tribunal de première instance, le Ministère public et le Tribunal des mineurs. À l'exception du Tribunal des mineurs qui se trouve à Delémont, toutes les instances judiciaires siègent à Porrentruy.
Selon l'article 56 de la Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (1978), la procédure administrative doit se dérouler en français et, si c'est nécessaire, l'autorité fait appel à un interprète. Cependant, le paragraphe 5 prévoit que «les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand». On peut penser qu'il s'agit des germanophones jurassiens résidant dans la petite commune majoritairement germanophone d'Ederswiler située au nord du district de Delémont:
| Article 56 1) La procédure administrative se déroule en français. 2) L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement. 3) Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui-ci peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les personnes qui seraient récusables comme experts. 4) Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties (art. 215 et suivants). 5) Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas, elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions et autres actes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'État. |
- La procédure civile
En matière de justice, les articles 120 et 121 du Code de procédure civile (1978-2007) obligent toutes les instances judiciaires à procéder en français, mais un juge peut faire appel à un interprète et demander que les documents produits dans une langue étrangère soient traduits:
|
Article 120 |
- La procédure pénale
L'article 4 de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (2010) exige le français dans les procédures:
| Article 4 Langue de la procédure Les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français. |
Les articles 65 à 67 du Code de procédure pénale (1990-2006) traitent également de la langue. La procédure se déroule en français (art. 65) et, lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge désigne un interprète (art. 66).
|
Article 65 Interprète Article 67 Obligation d'accepter les fonctions d'interprète 1) Toute personne qui remplit les conditions exigées à l'article précédent et qui n'est pas âgée de plus de soixante ans est tenue d'accepter les fonctions d'interprète; le juge, en désignant l'interprète, l'avertit des dispositions pénales concernant la fausse traduction. |
L'emploi du français est encore exigé en vertu de la Loi relative à la justice pénale des mineurs (2010):
| Article 4 Langue de la procédure La procédure se déroule en français. |
- Le droit des étrangers
Selon l'article 4 de la Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (1998), la personne en cause est informée rapidement dans une langue qu'elle comprend de toute décision prise par la cour. Lors de son audition par le juge, un interprète est désigné en cas de besoin.
|
Article 4 |
- Le notariat
Comme c'est généralement le cas, les notaires du canton du Jura sont régis par la Loi sur le notariat et sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur. Ils sont chargés de rédiger et de conserver les actes authentiques, tels que les contrats de vente immobilière, les testaments, et les contrats de mariage. Le Décret concernant l'exécution de la Loi sur le notariat (1978-2012) exige normalement l'usage du français dans les actes notariés, mais le recours à une autre langue est possible si le notaire connaît cette langue, sinon il faut faire appel à un interprète:
| Article 18 Auxiliaires 1) Le notaire peut faire écrire la minute par la main d'une tierce personne. 2) Si une des parties ne connaît pas la langue dans laquelle doit être traitée l'affaire où est rédigé l'acte, on aura recours aux services d'un interprète, à moins que le notaire ne fonctionne lui-même en cette qualité (art. 23 du présent décret). 3) Si une des personnes qui concourent à l'acte est sourde, muette ou sourde-muette, on appellera un expert (conformément à l'art. 21, al. 2 et 3, et à l'art. 22 du présent décret). 4) Les interprètes et les experts devront posséder les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire (art. 40 de la loi). Article 23 2) Si une personne qui doit concourir à la réception de l'acte ne comprend pas la langue dans laquelle il est rédigé, le notaire le lui traduit oralement et y fait mention de cette circonstance. 3) À la demande du notaire ou d'une partie, on peut aussi avoir recours aux services d'un interprète, qui attestera qu'il a traduit fidèlement le contenu de l'acte et la déclaration approbative de la partie; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire, puis signée par l'interprète. |
La Loi sur le notariat (1978) prévoit une procédure spéciale pour les personnes sourdes, muettes ou sourdes-muettes, ou qui ne connaissent pas la langue de la procédure:
| Article 37 Pour le cas où les personnes qui concourent à la réception de l'acte seraient sourdes, muettes ou sourdes-muettes, ou ne connaîtraient pas la langue dans laquelle l'acte est dressé, il sera prévu une procédure spéciale garantissant que ces personnes ont eu parfaite connaissance de la teneur de l'acte et l'ont positivement approuvée. |
4.4 La langue de l'Administration
Le français est l'unique langue employée par l'Administration du Jura, sauf pour les cas d'exception prévue par la législation. Les articles 5 et 6 de la Loi concernant l'usage de la langue française (2010) énoncent clairement que le français est la langue des autorités qui doivent communiquer dans cette langue avec les administrés:
| Article 5
Généralités 1) Le français est la langue des autorités. 2) Celles-ci sont tenues d'en faire un usage correct, compréhensible et de qualité. 3) Elles tiennent compte de ses adaptations régulières à l'évolution de la science et des techniques. Communication 1) Quel que soit le mode employé, les autorités communiquent en français avec les administrés, entre elles et en leur sein. |
En vertu de l'article 9 de cette loi, l'État s'engage à promouvoir le français, ce qui signifie notamment susciter «l'amour de la langue française», la création et les diverses formes d'expression culturelle en langue française, éviter les anglicismes inutiles ou choquants et lancer toute initiative en vue de promouvoir l'usage d'un français de qualité. L'article 10 de la Loi concernant l'usage de la langue française incite l'État à prendre des mesures pour valoriser le patrimoine lié au patois.
Évidemment, il n'est pas aisé d'évaluer par des critères précis «l'amour de la langue française» ainsi que les anglicismes «choquants».
- Le Conseil de la langue française
Le Conseil de la langue française a été institué le 5 septembre 2011 en application de la Loi concernant l'usage de la langue française adoptée par le Parlement le 17 novembre 2010. Le Conseil sert d’organisme consultatif de l’État jurassien pour les questions linguistiques et fournit «soutien et outils» à l’administration et aux collectivités publiques «en vue de développer une réflexion de qualité sur le français et les questions de langue en général».
Le Conseil de la langue française doit reprendre les tâches de l'ancienne commission de rédaction du Parlement. Ainsi une délégation du Conseil, composée des membres désignés par le Bureau du Parlement doivent examiner les projets de loi après leur adoption en première lecture au Parlement; leur examen porte uniquement sur la rédaction. Les propositions de modification de la délégation sont soumises pour approbation à la commission parlementaire chargée d'un projet de loi, puis aux parlementaires.
Comme on pouvait s'y attendre, le Conseil de la langue française doit se prononcer, à la demande du gouvernement ou d'un département, sur toute question relative à la langue, dont les anglicismes. La défense de la langue française a constitué un moteur du combat pour l’indépendance. «Le Jura parle français», un slogan qui figure sur un autocollant vendu deux francs suisses encore aujourd’hui par le Mouvement autonomiste jurassien. S'il s'agissait à l'origine de s’opposer au suisse allemand, aujourd'hui ce sont les anglicismes qui dérangent.
Le Conseil de la langue française doit interpeller les citoyens et les entreprises à la réflexion avant de donner un nom à un bâtiment dans le Jura. Récemment, la gronde d'une partie de la population s’est faite entendre après qu'un restaurateur eut employé une appellation anglaise pour un restaurant. Le Conseil encourage donc les personnes qui viennent de l’extérieur du canton et investissent dans la région à prendre en compte l’attachement des Jurassiens à la langue française lorsqu’elles désignent un lieu.
Les anglicismes sont un peu partout dans le Jura, du "Peanut Medieval Lodge" au "Development Camp NHL Ice Rink Porrentruy", en passant par les innombrables "Sale" sur les vitrines lors des soldes. Cette mode constitue un atout de marketing pour les uns, mais un affront à la langue française pour les autres. De fait, la prolifération des anglicismes a tendance à s’accroître sous l’influence d’Internet et de la publicité. Même si des efforts sont entrepris pour limiter sa propagation, cet usage a tendance à se répandre dans l’administration et dans les institutions parapubliques ou soutenues par l’État.
- L'état civil
L'article 10 du Décret sur le service de l'état civil (2001) mentionne que «la langue officielle de l'état civil cantonal est le français», mais que, «sur requête préalable, les extraits et les communications adressés aux autorités ou aux citoyens de la commune d'Ederswiler sont établis en langue allemande»:
|
Article 10 2) Sur requête préalable, les extraits et les communications adressés aux autorités ou aux citoyens de la commune d'Ederswiler sont établis en langue allemande. |
De plus, la Loi sur la police cantonale (2002), en grande partie abrogée en ce qui concerne la langue, prévoyait des conditions d'admission pour être nommé agent de la police cantonale, dont l'une (art. 26.1-c) consistait à «avoir une bonne connaissance d'une deuxième langue», mais l'alinéa suivant mentionnait que, «en cas de besoin, le Département peut autoriser des exceptions» à la règle en question. Pour la police judiciaire, tout candidat doit «parler couramment une deuxième langue».
L'Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (1998) règle l'application de la Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques ; l'article 11 impose le français dans les cours et examens:
| Article 11 Langue Les cours et les examens se déroulent en français. |
- La commune d'Ederswiler
Les élus municipaux rédigent leurs directives et leurs règlements en allemand. Dans cette petite commune germanophone, le gouvernement jurassien envoie ses messages en allemand aux électeurs concernant les élections cantonales et les référendums. La déclaration d'impôts arrive également en allemand. Ce sont là de petits compromis acceptés par le canton.
4.5 L'éducation
Dans le canton du Jura, l'école primaire est consacrée à l'acquisition des outils fondamentaux du savoir; ses huit années comprennent deux cycles de quatre années et des demi-cycles de deux ans. L'enseignement y est donné par des maîtres généralistes. Quant à l'école secondaire, elle propose une offre d'éducation qui entend répondre autant que possible «aux aptitudes, intérêts et projets de formation» des élèves, dans le cadre d'une orientation continue.
La possibilité d'accomplir une 12e année, voire une 13e année de scolarité est ouverte aux élèves qui, ayant redoublé une année de programme dans leur parcours scolaire, souhaitent achever le programme complet de la scolarité obligatoire.
- L'école obligatoire
Dans le canton, l'école est obligatoire dès l'âge de quatre ans à commencer par la maternelle. Selon la Loi sur l’école obligatoire (1990), l’enseignement des disciplines de base comprend le français, les mathématiques et l’allemand; mais tout enfant devra aussi apprendre des langues étrangères.
|
Article 3
Article 5 2) Une attention particulière est vouée à l’activité langagière des élèves de langue étrangère. Cours à option 4) D’autres disciplines peuvent être dispensées en cours à option séparés. |
L'école primaire dure six années articulées en trois cycles de deux années; elle est consacrée à l'acquisition des outils fondamentaux du savoir. L'enseignement y est pour l'essentiel donné par des maîtres généralistes qui suivent leurs élèves sur un cycle complet. L'enseignement de l'allemand est obligatoire et débute en troisième année du primaire; cette langue est étudiée à l'école primaire durant quatre années à raison de deux leçons hebdomadaires.
Tous les élèves doivent commencer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale et de l'anglais à l'école primaire, au plus tard en 3e et en 5e année scolaire (comptage basé sur neuf années de scolarité obligatoire); en incluant dans la scolarité obligatoire, comme prévu par l'accord intercantonal de 2007 (ou concordat Harmos),
- L'école secondaire
Les élèves admis à l'école secondaire sont répartis en des groupes hétérogènes pour les cours communs (éducation physique, sciences humaines, éducation numérique, éducation musicale, etc.), en groupes de niveaux pour les trois disciplines de base (français, mathématique, allemand) en trois niveaux de compétence (A, B et C), et en des cours à option répartis en quatre groupes caractérisés (latin, sciences, langues modernes et dimension économique, activités créatrices). L'anglais est enseigné (langue 3) dans les options 1, 2 et 3. L'italien est enseigné dans l'option 3 (langue 4). Une offre de cours facultatifs et de devoirs accompagnés est présente dans chaque école, selon les compétences disponibles et les traditions acquises.
Le Lycée cantonal est situé à Porrentruy. Les élèves effectuent une formation de trois ans et décrochent un certificat de maturité gymnasiale. Ce titre permet d'envisager des études universitaires ou d'autres études supérieures en Haute École pédagogique ou en Haute École spécialisée, ceci moyennant d'abord une année d'expérience professionnelle dans la branche. Le Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal (2001) prévoit comme disciplines fondamentales, notamment le français, une deuxième langue nationale à choisir entre l'allemand ou l'italien, une troisième langue à choisir entre l'italien, l'anglais, le latin ou le grec, à l’exclusion de la deuxième langue nationale choisie, ainsi qu'un enseignement bilingue:
|
Article 7 2) Indépendamment de l'enseignement de la langue concernée, la formule d'enseignement bilingue porte, sur les trois années du cursus d'études du Lycée, sur un minimum de 800 leçons dispensées dans la langue concernée et dans les disciplines réparties dans divers domaines. |
Les Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes (1994) reprennent les mêmes dispositions sur les langues étrangères:
| Article 8
Choix des disciplines 1) Les élèves admis au Lycée cantonal choisissent les disciplines figurant à leur programme d'enseignement dans le cadre offert par la grille horaire et selon les conditions de détail suivantes:
2) Les règles relatives aux effectifs requis pour la constitution de groupes peuvent limiter les possibilités de choix offertes aux élèves. |
L'Ordonnance sur la maturité professionnelle (2016) résume ainsi la formation:
| Article 7 Apprentissage des langues Un accent particulier est notamment porté sur l'apprentissage des langues. |
L’École de culture générale est un programme de formation à plein temps du secondaire II, reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’Instruction publique. Elle permet d'obtenir un Certificat de culture générale, suivi d'une possible Maturité spécialisée moyennant une année supplémentaire. Cette maturité permet d'accéder à une Haute École spécialisée dans le domaine spécifique.
Le Règlement concernant le cycle de promotion de l’École de culture générale (2000) prévoit des épreuves en français, mathématique, allemand et langue 3:
| Conditions générales 1) Seuls sont admis au cycle de promotion les élèves dont les motivations, les aptitudes et les résultats laissent penser qu'en une année d'études ils rempliront les conditions fixées pour l'admission dans les écoles moyennes et pour les formations conduisant à l'obtention des maturités professionnelles. 2) Sur la base des résultats obtenus à l'examen d'admission, le cycle accueille entre quatorze et quarante élèves. |
L'Ordonnance concernant les filières de formation à l'École de commerce (2023) met l'accent sur l'apprentissage des langues étrangères, notamment l'allemand et l'anglais:
|
Article 19
2) Dans les branches complémentaires d'italien et d'espagnol, le niveau de référence est défini conformément au Cadre européen des langues, soit le niveau B-1. |
- Les élèves allophones
Depuis quelques décennies, le nombre d'immigrants a beaucoup augmenté en Suisse, et le canton du Jura ne fait pas exception. L'Ordonnance portant exécution de la Loi scolaire (Ordonnance scolaire) (2024) énonce que l'enfant issue de l'immigration a droit à un enseignement d'appui de français lorsque sa langue maternelle n'est pas le français, mais en fin de compte il devra apprendre aussi l'allemand:
| Article 3
Insertion des immigrants 1) ) L'enfant d'âge scolaire arrivant dans le canton est inséré dans le diplôme scolaire correspondant à son âge et, à l'école secondaire, dans le niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de sa scolarité antérieure. Article 3a Article 4 Maintien de la culture d'origine Article 41 Cours séparés 1) L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique est dispensé en cours à trois niveaux. Cours à options
2) L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3. Article 51 Dixième année linguistique 1) L'élève qui atteint sa scolarité obligatoire et souhaite perfectionner ses connaissances linguistiques dans une langue étrangère peut, dans la mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans une classe du degré 9 dans une école d'un autre canton. |
Les Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires (1985) prescrivent un équipement audiovisuel et des laboratoires de langues:
| Article 13 Équipement audiovisuel 1) L'équipement technique des écoles doit être conçu de telle manière que les enseignants puissent, sans contrainte particulière, utiliser des moyens tels que le rétroprojecteur, le projecteur de diapositives, le magnétophone, le magnétoscope, la télévision, le projecteur 16 mm. L'équipement des écoles s'effectue en fonction du nombre de classes. 2) Pour l'enseignement des langues, la mise à disposition d'un magnétophone et d'un projecteur de diapositives reliés entre eux et commandés à distance est obligatoire. 3) La Section de la documentation et des moyens audiovisuels de l'Institut pédagogique peut être consultée avant l'achat de tout équipement audiovisuel. SECTION 7 : Laboratoire de langues Article 50 Généralités Un laboratoire de langues ne peut être aménagé que dans la mesure où l'établissement comporte au moins dix classes enseignant une ou plusieurs langues étrangères. Article 51 Conception 1) Le laboratoire de langues a les dimensions d'une unité de base. Il comporte un local annexe d'environ 16 mètres carrés destiné à servir de studio pour l'enregistrement, la copie et le stockage de matériel ou de cassettes. 2) Une attention particulière est accordée aux problèmes d'acoustique. |
- L'école privée
L’État aide les quelques écoles privées qui le demandent et qui remplissent les conditions en la matière (principalement basées sur la reconnaissance d’utilité publique, l’autorisation d’enseignement et l‘arrêté de subventionnement). L’aide consiste dans l’allocation d’une subvention par élève sur les bases d’un pourcentage du coût d’un élève du degré correspondant à l’école publique. La subvention peut être réduite selon plusieurs critères reconnus par la loi (qualification des enseignants, élèves en provenance d’autres cantons, effectifs par classe, etc.) et ne peut, dans tous les cas, excéder le découvert du compte d’exploitation de l’école requérante.
La Loi sur l’enseignement privé (1984) impose, entre autres, le français comme langue d'enseignement:
| Article 9b
Autorisation
2) Sous réserve d’une autorisation délivrée sur la base de l’article 9a, alinéa 3, l’autorisation est délivrée pour la rentrée scolaire qui suit le dépôt de la demande. |
4.6 Les médias
 |
Le Jura n'a pas de politique particulière à l'égard des médias. Outre les journaux francophones de France ou de la Suisse romande tels que La Tribune de Genève, Le Temps, etc., le Jura dispose du Quotidien jurassien, un journal régional d’information. Il existe aussi Le Journal du Jura, un quotidien francophone suisse fondé en 1871 à Bienne dans le canton de Berne; ce journal sert de quotidien de référence pour la population francophone du canton de Berne, mais il est disponible dans le Jura. |
Dans les médias électroniques, les Jurassiens disposent de la Radio suisse romande (Lausanne) et de la Télévision suisse romande ou TSR (Genève), de la RFJ (Radio Fréquence Jura) qui émet sur le territoire du canton du Jura ainsi que dans les régions de Moutier, de Chaux-de-Fonds et du Locle. La TSR diffuse quotidiennement près de 35 heures de programmes sur deux chaînes, TSR 1 et TSR 2. Elle diffuse des informations immédiates, des informations internationales, nationales et régionales, des découvertes sur la culture, la science et la société et des émissions pour la jeunesse.
Il existe plusieurs stations radiophoniques régionales diffusant en français, mais également de nombreuses stations étrangères en français (France, Luxembourg, Belgique, Monaco), en allemand (Suisse et Allemagne), en italien (Suisse et Italie), en anglais (Royaume-Uni, Suisse), etc. Les Jurassiens se laissent tenter par les émissions radio-télévisées en provenance non seulement de Genève (Léman Bleu), mais aussi de France (TF1, France2, France3, TV5 Monde, etc.), du Luxembourg (RTL9) ou de Monaco (Telemontecarlo).
![]()
La politique linguistique du canton du Jura est une politique d'unilinguisme français, comme dans toute la Suisse romande (Genève, Neuchâtel, Vaud), mais les nombreuses dispositions linguistiques adoptées témoignent d'une certaine difficulté d'application, surtout au moment de la création du canton en 1977. Depuis les années 1990, toute la politique linguistique se résume à prévoir des classes d'accueil destinées aux élèves étrangers. Il n'existe aucune réelle politique concernant le patois jurassien considéré aujourd'hui comme disparu. Cette attitude démontre que le canton du Jura ne connaît que fort peu de problème linguistique.
|
| Accueil: ménagement linguistique dans le monde |