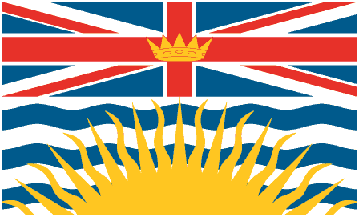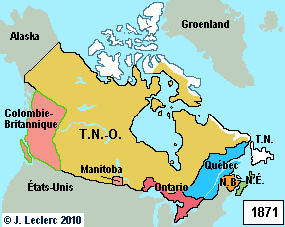Au cours de son histoire passée, la Colombie-Britannique n'a pas connu
de conflits linguistiques. L'anglais fut considéré comme la langue officielle, sans qu'il n'ait
été nécessaire de légiférer à ce sujet. Les francophones furent oubliés, de même
que les nombreux immigrants asiatiques et les autochtones. Il n'existait pas
d'obligation constitutionnelle d'offrir des services judiciaires en français en
Colombie-Britannique. Il n'y a pas eu non plus de législation reconnaissant le
droit à l'usage de la langue française dans les tribunaux. D'ailleurs, une
disposition générale des Règles de procédure de cette province
prescrivait que tous les documents devaient être rédigés en anglais. Cette
disposition ne s'appliquerait pas aux cours de juridiction criminelle
puisqu'elle contrevenait aux dispositions du
Code criminel canadien,
mais les dispositions relatives au Code criminel ne sont entrées en
vigueur qu'en 1990. Durant plus d'un siècle, la minorité francophone a dû
fréquenter les écoles anglaises pour assurer son instruction. L'enseignement en
français a été offert pour la première fois en Colombie-Britannique à la fin des
années 1960, sous la forme de programmes bilingues. Quant aux autochtones, ils
furent complètement ignorés.
3.4 Les résistances au français
Après la promulgation de la
Loi
constitutionnelle de 1982 qui inscrivait dans la Constitution canadienne
le bilinguisme anglais-français dans les institutions fédérales et, par la
Charte canadienne des droits et libertés, obligeait les provinces à assurer une
instruction dans la langue des minorités de langue officielle, la
Colombie-Britannique accorda une première école publique aux francophones en
1983.
L’article 23 de la Charte reconnaît
officiellement le droit des parents appartenant à la minorité linguistique de
langue officielle de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et
secondaire, dans leur langue. Toutefois, ce même texte demeurait relativement
évasif sur les modalités de l’application de ces prescriptions, ce qui laissait
à chacune des provinces une certaine latitude. Un tel ce
flou juridique allait susciter des conflits quant à l'interprétation à donner au
contenu de l'article 23. Dans presque toutes les provinces, il fallut de longues
batailles judiciaires pour que les tribunaux en viennent à fixer
l'interprétation réelle à donner au texte constitutionnel de 1982. En
Colombie-Britannique, le gouvernement adopta en 1989 la School Act (Loi
scolaire) reconnaissant aux parents le droits d'envoyer leurs enfants dans
des écoles françaises. Mais il y avait loin de la coupe aux lèvres, car plus
rien n'avança par la suite.
Devant l’inaction provinciale dans la mise en
application effective des droits scolaires, l'Association des parents
francophones de la Colombie-Britannique se mobilisa et déposa une action en
justice. Après plusieurs promesses suivies de nombreuses rétractations, le
gouvernement finit par adopter, en novembre 1995, un règlement (Francophone
Education Regulation) dont les dispositions se révélèrent très restrictives
à l'égard de l'accès aux écoles en français. Les négociations qui s'ensuivirent
avec la province échouèrent de telle sorte que l'affaire s'est finalement portée
devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le verdict de la Cour suprême
de la Colombie-Britannique fut rendu le 21 août 1996. Le juge David Vickers a
alors déclaré: «Le gouvernement de la Colombie-Britannique a échoué à répondre,
conformément à la Constitution fédérale, au devoir de garantir une éducation en
langue française.» Le tribunal accorda au gouvernement provincial jusqu’à la fin
de la session législative pour promulguer une loi protégeant les droits à
l’éducation en langue française.
À cette occasion, Jim Abbott, député de la
circonscription Kootenay-Est au Parlement fédéral et membre du Parti réformiste,
hostile au bilinguisme et au biculturalisme au Canada, déclara que l’argent du
gouvernement de la province dépensé dans l’éducation en langue française devrait
plutôt être utilisé pour l’enseignement de l’anglais comme langue seconde. Il
reprochait au tribunal d'avoir commis une «insigne erreur» et d'avoir accordé à
la minorité francophone un contrôle considérable sur l’instruction en français; il
invitait même le gouvernement à résister au jugement de la Cour.
Il fallut attendre en 1996 pour que
l'Assemblée législative de la province adopte un projet de loi modifiant la
Loi scolaire de 1989 pour celle de 1996 (voir
le texte de 1996). Dans cette loi, la province reconnaît de façon
permanente le droit à recevoir une instruction en français. En donnant gain de cause à la
communauté francophone de la Colombie-Britannique, le juge Vickers a ouvert la
voie à l’établissement d’un système scolaire francophone complètement autonome
par rapport au système scolaire anglais. Jusqu'en 1999, la gestion de
l’éducation en français était toujours restée à la discrétion des conseils
scolaires anglophones. Le Conseil scolaire francophone obtint ainsi la juridiction du
programme francophone dans toute la province.
Néanmoins, il n'est pas facile d'être
francophone dans l'Ouest. En 2010,
le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique et la
Fédération des parents francophones de cette province
ont intenté une action judiciaire pour obliger le gouvernement provincial à
reconnaître ses devoirs constitutionnels et à lui donner les moyens de remplir
ses obligations. Les deux associations estimaient que «dans plusieurs régions de
la province les espaces pour offrir l’éducation en français sont inadéquats et
la situation est alarmante». Cette situation empêcherait le CSF de desservir
toute la population scolaire et d’offrir des services éducatifs de la plus haute
qualité et équivalant à ceux offerts aux anglophones. Cette situation aurait
pour résultat une assimilation galopante des jeunes francophones en
Colombie-Britannique. Selon le CSF, le gouvernement provincial doit donner aux
francophones les moyens de gérer la forte croissance dans leurs écoles et
d’offrir à leurs enfants des écoles sécuritaires et adéquates.
En juillet 2013 (Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2013 CSC
42), la Cour suprême du Canada a statué que la loi britannique de 1731, qui a
été abrogée en Angleterre, demeurait malgré tout en vigueur en
Colombie-Britannique et qu'en conséquence les juges britanno-colombiens
ne sont pas tenus d'accepter en preuve des documents dans une autre langue que
l'anglais. Aux termes de l’article 2 de la
Law
and Equity Act de 1996, «les lois civiles et criminelles de l’Angleterre
en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie-Britannique, à condition
de ne pas être rendues inapplicables par la situation dans cette province»
(traduction). De plus, à cette époque, la province était gouvernée en langue
anglaise. Étant donné que les immigrants, attirés par la ruée vers l’or dans le
canyon du Fraser, venaient en grande partie des États-Unis, l’anglais était la
langue commune des colons. La loi de 1731 n’a pas été modifiée en ce qui
concerne le déroulement des instances civiles en Colombie-Britannique. Au final,
la législature de la Colombie-Britannique ne l’a pas ni abrogée ni modifiée. De toute façon, l’article 22-3 de la
Loi sur
les règlements de la cour (2009) prescrit l’emploi de l’anglais pour toute
pièce jointe à un affidavit qui est déposé au tribunal.
Pour sa part, la Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique croit qu'un jugement en faveur de l'usage du français
aurait pu faire jurisprudence dans la province, mais aussi en Alberta, en
Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et à Terre-Neuve. L'organisme estime que la
Cour suprême a raté l'occasion de «pérenniser l'utilisation du français dans
les cours provinciales» et juge qu'il faut une politique gouvernementale sur
les services en français en Colombie-Britannique. Une consolation, les perdants dans cette cause, le Conseil scolaire
francophone (CSF) et la Fédération des parents, ont obtenu le remboursement de
leurs frais judiciaires, car ils ont soulevé une question nouvelle, qui avait
une portée générale fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés.
4
L'absence de statut du français
Au gouvernement provincial de la Colombie-Britannique,
le français ne possède aucun statut officiel, pas plus que
l'anglais d'ailleurs. En effet, la province n'a jamais légiféré
en matière de langue et aucune loi n'a été effectivement
adoptée, sauf que des dispositions ponctuelles d'ordre linguistique peuvent
avoir été adoptées dans certaines lois. Cependant, même si l'anglais n'est pas reconnu juridiquement
comme langue officielle, il a acquis, comme dans la plupart des provinces
anglaises, ce statut dans les faits.
4.1 Les services fédéraux
Ce n'est donc que sur le plan des structures
relevant du gouvernement fédéral que la langue française
jouit d'un statut dans la province. La Colombie-Britannique n'est pas soumise
aux dispositions de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867
pour ce qui touche le Parlement provincial et les tribunaux. D'ailleurs,
en 1986, la Cour d'appel de la province a même statué sur
cette question en ce qui concerne la Loi constitutionnelle de 1982;
selon la Cour, les articles 16 à 22 de la Charte canadienne (relatifs
à la langue des débats et de la rédaction des lois)
ne s'appliquent pas à cette province, ce qui signifie que l'on ne
peut exiger d'utiliser le français dans les débats du Parlement
et dans la rédaction des lois. Cependant, un député
francophone peut employer le français s'il y tient, mais aucun service
de traduction simultanée ne lui sera fourni. En Colombie-Britannique, certains bureaux fédéraux doivent
fournir des services en français. Les centres de Service Canada offrent des
services en français et en anglais dans les villes suivantes:
Abbotsford, Chilliwack, Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George,
Vancouver et Victoria. Partout ailleurs, ces services ne sont dispensés qu'en
anglais.4.2 L'enseignement en français
La Colombie-Britannique est néanmoins
liée à l'article 23 de la Charte des droits et libertés
de 1982, qui accorde le droit à l'enseignement en français
partout au Canada
«là où le nombre le justifie». La
Loi sur les langues
officielles (1988) du gouvernement canadien protège
également les francophones, qui peuvent bénéficier
en principe de services bilingues quand ils font affaire avec des organismes
du gouvernement fédéral. Dans la réalité, les
services fédéraux bilingues ne sont pas offerts sur demande
pour la simple raison que la demande pour ces services est à peu
près nulle, les francophones ayant pris l'habitude de toujours communiquer
en anglais.
4.3 Les
services provinciaux
En ce qui a trait aux services provinciaux
en français, ils demeurent symboliques.
La province n’a, pour sa part,
aucune obligation de donner des services en français. Seul le Bureau des
affaires francophones du gouvernement de la Colombie-Britannique peut offrir des
informations concernant la santé, le développement économique, la justice et les
services sociaux. Même les représentants
de l'Inter-Cultural Association of Greater Victoria estiment que le gouvernement
de la province fait peu pour les francophones: «Je ne connais personne
qui parle français au sein de ce gouvernement. Si un Québécois
s'adresse à l'assurance-maladie ou quelque autre service, on l'envoie
à notre association.» De plus, la Fédération des francophones de
la Colombie-Britannique donne un certain nombre de renseignements en ce qui
concerne le gouvernement provincial, mais ce n'est pas elle qui offre les
services. Quoi qu'il en soit, la documentation n'est offerte
qu'en anglais; il n'y a même pas de procédure prévue
pour les services de traduction, qui sont à peine existants.
Une
enquête CROP (1983) révélait que moins de 3 % des francophones
ont ou obtenir des services en français dans cette province; aucun
changement n'est survenu depuis. Par exemple, l'Insurance
Corporation of British Columbia (ICBC),
l'équivalent de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ),
émet
ses documents uniquement en anglais, mais
donne néanmoins des renseignement en
"Simplified
Chinese", en "Traditional Chinese" et en "Pujabi",
rien du tout en français. Lorsqu'un francophone obtient son permis de conduire,
par exemple de «classe 7» pour débutant, il se fait dire en français qu'il
recevra un exemplaire du Tuning up for drivers. De toute façon, il n'existe aucun soutien pour inciter
les francophones à demander des services en français. Ils se feront répondre: «Don't
rock the boat» (ne faites pas de vagues). Pour les
soins de santé, la situation est identique. Mais le
BC HealthGuide Handbook (Guide-Santé de la
C.-B.) est publié en anglais, en français, en chinois et en panjabi; il est
disponible sur Internet, sauf celui en français.
Il n'y a pas plus d'espace francophone sur le plan du travail. Les seules
possibilités de travailler en partie en français en Colombi
e-Britannique
demeurent les suivantes: moins de 200 postes dits bilingues dans la fonction
publique fédérale, une cinquantaine de postes à Radio-Canada, et quelques autres
emplois bilingues dans deux Caisses populaires, quatre librairies et à
l'hebdomadaire régional Le Soleil de Colombie, qui tire à 3600 exemplaires.
La grande majorité de ces postes sont occupés par des anglophones
bilingues.
4.4 Les Jeux olympiques d'hiver de 2010
La ville de Vancouver
fut l'hôte des Jeux olympiques d'hiver
en 2010. Or, l'absence du français en Colombie-Britannique, plus spécialement à
Vancouver, est généralisée, Jeux olympiques ou pas. Au centre d'information
touristique de Vancouver, il est possible de trouver des dépliants bilingues:
anglais et mandarin. À l'aéroport international de Vancouver, il n'y a
jamais d'appel en français, même pas pour les vols vers Montréal. Bref,
transformer Vancouver en une ville bilingue pendant quelques semaines semblait
défier toute logique politique et démographique, et ce, dans un pays
officiellement bilingue et pour un seul événement, les Jeux olympiques, dont la
langue officielle est le français.
Pourtant, le gouvernement fédéral a réagi en
dégageant sept millions de dollars pour la traduction et l'affichage en français
sur les lieux de compétition des Jeux et dans les événements culturels connexes. C'est que, pour le gouvernement fédéral, les
Jeux olympiques de Vancouver
devenaient aussi une sorte de test pour la qualité du bilinguisme au Canada. Le
commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, a commandé une enquête pour
s'assurer que le français avait sa juste place aux Jeux olympiques d'hiver de
2010 à Vancouver. Pour sa part, la Fédération canadienne des contribuables est
d'avis que cette dépense était un «gaspillage de fonds publics». Quant au ministre
du Patrimoine canadien, James Moore, il s'est dit «déçu» de la faible
représentation de la langue française lors d'une entrevue sur la chaîne
canadienne-anglaise CBC Television, diffusée le 14 février 2010: «Je pense que
les cérémonies d'ouverture étaient géniales, mais il aurait dû y avoir davantage
de français, un point c'est tout.» Quant au commissaire aux langues officielles,
il a déclaré : «Il y a des moments que je sens que le français à Vancouver est
un peu comme la neige: tout le monde à Vancouver souhaite la voir, mais elle est
parfois difficile à trouver.»
Un an après les Jeux olympiques de Vancouver, l'ancien président
du COVAN, le comité organisateur des Jeux de Vancouver,
John Furlong, rejetait toute responsabilité concernant la très faible présence
de la langue française lors des Jeux olympiques. M. Furlong accusa aussi de tous
les maux le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, ainsi que le
premier ministre du Québec, Jean Charest et
les journalistes du Québec, sans oublier le Bloc québécois, le parti
indépendantiste à Ottawa.
En fait, John Furlong n'a jamais voulu reconnaître qu'il avait échoué à
organiser des Jeux olympiques qui respectaient le droit des francophones
canadiens de s'exprimer et de vivre dans leur langue.
4.5 La décision de la Cour suprême en faveur du Conseil
scolaire francophone
Le 12 juin 2010, la Cour suprême du Canada rejetait les efforts
soutenus du ministère de l’Éducation de la province pour priver les francophones
des ressources nécessaires pour assurer une instruction en français de qualité,
et simplement répondre à la demande. Ce jugement fera sans doute jurisprudence,
car il statue clairement qu’un petit nombre d'élèves ne leur justifie pas un
traitement inégal. La cour établit une hiérarchie des droits selon laquelle il
n’y a pas beaucoup de motifs valables pour refuser les services scolaires aux
minorités francophones et encore moins des raisons comptables. En 2020, le
Conseil scolaire francophone comptait 6200 élèves et 43 écoles.
Depuis des années, le gouvernement de la Colombie-Britannique a toujours refusé
presque toutes les demandes pour construire de nouvelles écoles ou pour les
agrandir. Ces demandes se sont répétées au moins 15 fois pour la construction ou
l’agrandissement d’écoles. Par conséquent, le Conseil scolaire a dû dépenser des
sommes folles en transport scolaire afin de réunir les enfants dans les autres
écoles. La décision de la Cour suprême témoigne des exemples d’inégalités de
traitement tels les trajets en autobus deux fois plus longs, des écoles sans
bibliothèque ou sans gymnase, ou encore avec des gymnases trop petits pour
certains sports, et d’autres mal chauffés où les enfants font de l’exercice avec
leurs manteaux d'hiver, ainsi que des programmes scolaires offerts ailleurs,
mais inexistants dans leurs écoles. Ce faisant, la province a violé leur droit à
l’instruction dans la langue de la minorité garanti par l’article 23 de la
Charte. Devant le manque de collaboration du ministère de l’Éducation, le
Conseil scolaire et les parents francophones ont entamé une poursuite en 2010.
L’affaire a pris rapidement des proportions gigantesques, car le gouvernement
contestait toutes les demandes et montait toutes les barricades possibles.
Finalement, la Cour a donné raisons aux francophones et a ajouté
une pénalité de 7,1 millions de dollars que l’État doit verser en raison des
agissements de ses fonctionnaires. Plus précisément, elle a ordonné à la
province de payer six millions parce qu’elle n’a pas financé le transport par
autobus scolaires et 1,1 million parce qu’elle n’a pas donné assez d’argent au
Conseil scolaire pour les écoles en milieu rural. C'est la première fois qu'un
tribunal statue que le nier des droits fondamentaux a des conséquences
financières pour les gouvernements. Avec sa décision partagée (sept juges contre
deux), le plus haut tribunal du pays a mis fin à une saga judiciaire qui a duré
plus de dix ans. La Cour suprême a ainsi confirmé le droit à une éducation
équivalente, de la même qualité que celle offerte à la majorité linguistique, et
non pas juste une éducation «proportionnellement équivalente». Bref, les
communautés francophones de la Colombie-Britannique ont le droit d’obtenir des
écoles francophones, notamment à Victoria, à Vancouver et à Whistler. De plus,
cette décision de la Cour suprême crée une jurisprudence dont pourront se servir
les autres parents francophones du Canada pour exiger une éducation de qualité
en français pour leurs enfants.
5
Les droits effectifs des Franco-Colombiens
Les francophones de la province
n'ont jamais eu quelque droit linguistique que ce soit, sauf depuis l'adoption
des dispositions linguistiques de la Constitution canadienne de 1982.
5.1 La Législature et les tribunaux
Le français n'est utilisé
au Parlement que comme privilège, non comme un droit. Dans les cours de justice de juridiction civile, il est possible tout au plus d'exiger
la présence d'un interprète. Les dispositions relatives au
Code criminel canadien ne sont entrées en vigueur qu'en 1990. En
janvier 1996, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
a publié un rapport critiquant le système de justice pénale
de la Colombie-Britannique. L'étude (L'accès à
la justice en français en Colombie-Britannique: les obstacles institutionnels
et systématiques) concluait que les services en français
n'étaient pas facilement accessibles et que des mesures s'imposaient
dans trois secteurs: sensibilisation du système de justice pénale
aux droits de la minorité linguistique, promotion des droits de
la minorité linguistique et présence de personnel francophone
au sein du système.
Dans le but de permettre un accès égal au système de justice en
Colombie-Britannique, il est possible d'avoir son procès et l'enquête
préliminaire en français en matière criminelle, tel qu'il est prescrit par le
Code criminel du Canada (article 530).
Pour ce faire, le justiciable doit faire sa demande au juge juge devant lequel
il comparaît. La demande peut également être faite par un avocat. Si la demande
est acceptée, le personnel de la cour, le procureur de la Couronne, le juge et
les membres du jury pouvant s'exprimer en français doivent être disponibles lors
du procès. Mais il s'agit alors d'un «procès bilingue» devant un juge et un
jury, normalement tenu dans la municipalité de New Westminster. Le justiciable,
l'avocat et les témoins ont le droit aux services d'un interprète lors de la
procédure. Les documents écrits préparés pour l'enquête préliminaire ou le
procès pourront être rédigés en français ou anglais.
Dans la
Loi sur les jurés
(1996), un francophone unilingue ou un Amérindien qui ne comprendrait pas
l'anglais ne peut servir de juré dans un procès:
|
Article 4
[traduction]
Inaptitude
provenant de difficultés linguistiques
Une personne est inapte à servir de juré lors d'une instruction
lorsque la langue dans laquelle cette instruction se déroulera ne
peut être comprise, parlée ou lue par cette personne.
Article 5
Interprètes et
dispositifs d'interprétation
L'article 4 ne s'applique pas à une personne qui :
(a) serait
incapable, sans une aide quelconque, de voir ou d'entendre de
façon appropriée aux fins de servir de juré, et
(b) recevra en qualité de juré l'aide d'une personne ou d'un
dispositif que la cour estime suffisant pour permettre au juré
de servir en tant que tel.
|
En juillet 2013, la Cour suprême du Canada a statué que la
loi britannique de 1731 prévoyant que l'anglais était la langue des
«instances» judiciaires et la langue d'usage dans les documents déposés
en preuve, au civil, dans la province et que cette loi était encore en
vigueur. Ainsi, la
Loi sur l'équité
et
la législation
est valide en Colombie-Britannique:
Article
2
[traduction]
Application de
la loi anglaise
en
Colombie-Britannique
Sous réserve
de l'article 3, les
lois civiles et criminelles de l’Angleterre en vigueur le 19
novembre 1858 s’appliquent en Colombie-Britannique, à la
condition de ne pas être rendues inapplicables par la situation
dans cette province,
mais
ces lois
peuvent
être amenées à être changées et modifiées
par
toute législation
ayant
force de loi
en
Colombie-Britannique
ou dans toute
ancienne colonie
comprise dans
ses limites
géographiques. |
De plus, selon la Cour, même si on concluait que la loi de 1731 ne
s’appliquait pas en Colombie-Britannique, l’article 22-3 de la
Loi
sur les règlements de la cour de 2009 prescrit l’emploi de l’anglais
pour toute pièce jointe à un affidavit (déclaration sous serment) qui est
déposé au tribunal.
|
Article 1er
[traduction]
2) Documents
À moins que la
nature du document le rende inapplicable, tous les documents
préparés pour être utilisés au tribunal doivent être en langue
anglaise, lisiblement imprimés, dactylographiés, rédigés ou
reproduit sur du papier blanc durable de 8½ pouces par 11
pouces, ou sur du papier recyclé blanc cassé. |
Sur la question de la Charte, la Cour a statué qu'«il n'est pas
contraire aux valeurs de la Charte que la législature de la
Colombie-Britannique décide que les instances judiciaires se déroulent
uniquement en langue anglaise».
5.2 Les services publics provinciaux
Au plan des
services gouvernementaux, les
communications dans la langue de la minorité sont inexistants, si
l’on fait exception de certains bureaux du ministère de l’Éducation
de la province. Quant aux services en français provenant du fédéral,
il sont plus que déficients, surtout depuis la privatisation de
plusieurs services aux mains d’entreprises peu soucieuses de la langue
de la minorité. La province n’a, pour sa part, aucune obligation de
donner des services en français. Cependant, le Bureau des affaires francophones
du gouvernement de la Colombie-Britannique travaille en partenariat avec la
communauté pour améliorer et promouvoir la vitalité de la communauté
franco-colombienne et offrir des services de en français dans les domaines-clés
comme la santé, le développement économique, la justice et les services sociaux.
Dans les faits, le gouvernement de la Colombie-Britannique offre plus
souvent des brochures en mandarin, en pendjabi
et en filipino qu'en français!
D'ailleurs, la
Loi sur le
multilinguisme (1996) est significative à cet
égard. Les objectifs de cette loi témoignent que le français fait partie du
patrimoine au même titre que les autres langues immigrantes:
Article 2
[traduction]
Objectifs de la loi
Les objectifs de la présente loi sont les suivants :
(a) reconnaître que la
diversité de la Colombie-Britannique en matière de race, de
patrimoine culturel, de religion, d'ethnicité, d'origine et de
lieu de naissance est une caractéristique fondamentale de la
société britanno-colombienne, qui enrichit la vie de tous les
Britanno-Colombiens;
(b) favoriser le respect du
patrimoine multiculturel de la Colombie-Britannique;
(c) favoriser l'harmonie
raciale, la compréhension et le respect interculturels et le
développement d'une collectivité unie et en paix avec elle-même;
(d) favoriser en
Colombie-Britannique la création d'une société où il n'existe
aucun obstacle à la participation pleine et entière de tous les
Britanno-Colombiens à la vie économique, sociale, culturelle et
politique de la province.
|
La politique du gouvernement est de reconnaître et favoriser
la compréhension de la réalité que le multiculturalisme reflète la diversité
raciale et culturelle de la Colombie-Britannique, ce qui signifie favoriser
la compréhension et le respect entre les cultures, les attitudes et les
perceptions qui engendrent l'harmonie entre les Britanno-Colombiens de toute
race, religion, origine ethnique, ascendance, héritage culturel et lieu de
naissance.
5.3 L'éducation
En fait, les seuls droits réels
accordés aux francophones se limitent à l'éducation.
L'enseignement du français est permis au primaire; au secondaire,
il est très difficile, sinon impossible, de réunir des élèves
en nombre suffisant pour donner en français. Depuis 1979, le gouvernement
provincial permet l'enseignement du français de la maternelle à
la septième année. En vertu de
l'article 23 de la Charte des droits et
libertés, tous les
districts scolaires sont tenus
d'offrir un enseignement en français là où se trouvent
10 enfants francophones ou plus.
En 1986, on comptait moins de 500 élèves
dans les classes françaises réparties en trois écoles.
Cet enseignement n'est offert qu'aux seuls francophones ayant leur citoyenneté
canadienne, mais il est ouvert aux anglophones qui veulent apprendre le
français. Les cours destinés aux francophones connaissent
un succès phénoménal auprès des anglophones:
il y a 40 fois plus d'élèves anglophones inscrits que de
francophones. En 1989, on comptait 21 000 enfants de la Colombie-Britannique
inscrits en immersion française dont 2000 francophones. En 1992,
il n'existait encore aucune conseil scolaire francophone, mais le gouvernement
provincial a manifesté son intention de remédier à
ce problème dans un avenir rapproché. Le quotidien The
Province a demandé à ses lecteurs si le gouvernement
devait accorder le contrôle des écoles françaises à
des francophones; selon ce sondage non scientifique, 75 % ont alors répondu
NON.
Heureusement, un rapport du ministère
de l'Éducation (1992) proposait une nouvelle loi scolaire et la
création de trois conseils scolaires pour 1994: un à Vancouver,
un autre à Nanaïmo et un troisième à Prince George.
Toutefois, à l'automne 1994, le gouvernement de la Colombie-Britannique
refusa de permettre aux francophones d'exercer le droit de gestion de leurs
écoles conféré par la Charte canadienne des droits
et libertés, forçant ainsi les parents francophones à
se porter devant les tribunaux pour obtenir gain de cause. En 1996, la
Cour suprême de la Colombie-Britannique a assermenté les premiers
conseillers du Conseil scolaire francophone (CSF), formé en juillet
1995 en vertu d'un règlement d'exécution de la loi scolaire.
Mais, le 14 août de la même année, la cour a invalidé
le règlement qui établissait le Conseil scolaire francophone.
Dans son jugement, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré
que le gouvernement provincial avait dérogé à l'article
23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a donné
au gouvernement un délai pour légiférer en vue de
l'établissement d'une structure de gestion scolaire conforme aux
exigences établies. Le gouvernement avait prétendu détenir
la compétence voulue pour adopter le Règlement sur l'éducation francophone (Francophone Education Regulation)
et avait invoqué l'article 5 de la loi intitulée School
Act, qui prévoit dans son paragraphe introductif que chaque
élève a le droit de recevoir une éducation en langue
anglaise. Voici l'article 5 (le seul) de la
Loi scolaire de 1996 concernant
la langue d'enseignement :
| Article
5 (traduction)
Langue d'enseignement
1) Chaque élève a droit de recevoir un programme éducatif
dispensé en langue anglaise.
2) Les élèves dont les parents ont le droit,
selon l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire
instruire leurs enfants dans une autre langue que l'anglais ont droit de recevoir cette instruction.
3) Soumis à l'approbation du ministre, un conseil
scolaire peut permettre à un programme éducatif d'être fourni dans
une autre langue que celle prévue aux paragraphes 1 et 2.
4) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut prévoir des règlements:
(a) en respectant les dispositions
sur les programmes éducatifs en d'autres langues que l'anglais,
(b) en donnant effet à l'article 23 de la
Charte canadienne des droits et libertés, et
(c) en déterminant la façon par laquelle
le pouvoir, le devoir ou la fonction d'un conseil scolaire peut être exécuté ou exercé
selon cette loi en ce qui concerne les élèves mentionnés dans le
paragraphe 2.
5) Pour les buts visés au
paragraphe 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir des règlements différents
en fonction des diverses circonstances. |
En 1996, le ministère de l’Éducation
publiait la circulaire no 96-12 relative au programme d’immersion
en français. Le gouvernement provincial estime que le programme
d'immersion en français favorise le développement social
et intellectuel des élèves et leur fournit un atout sur le
plan de l'avancement professionnel. L’objectif est de donner à
des élèves non francophones l'occasion de devenir bilingues,
c'est-à-dire de pouvoir communiquer efficacement en français
et en anglais. Pour former des élèves bilingues, l'enseignement
du programme d'études de base doit être dispensé entièrement
en français durant les premières années de la scolarité.
Une fois que les élèves possèdent de solides connaissances
en français, le programme English Language Arts est introduit
et, au fil des années, l'enseignement en anglais est accru. Les
élèves continuent de recevoir un enseignement en français
pour certaines matières de sorte qu'au terme de leur 12e année,
ils possèdent des compétences linguistiques dans les deux
langues. Un beau programme pour les petits anglophones!
![]()