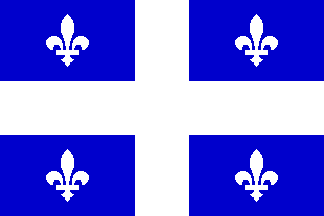Source: Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (2020)
Depuis 1966, certaines régions administratives ont changé de nom. Ainsi, la région des Cantons-de-l'Est (1966-1981) est devenue la région administrative de l'Estrie, mais les deux appellations sont restées courantes tout en ne recouvrant pas la même réalité géographique, la première désignant la région touristique, la seconde la région administrative. Cependant, en 2023 Estrie et Cantons-de-l'Est recouvrent les mêmes frontières.
Le Nouveau-Québec (1966-1987) est devenu la région administrative Nord-du-Québec.
La région de Québec est devenue, le 15 décembre 1999, la région administrative de la Capitale-Nationale.
Depuis le recensement de 2006, seules les régions du Bas-Saint-Laurant, de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont perdu des citoyens.
On peut constater que les régions administratives les plus densément peuplées, Montréal avec 4124 hab./km², et Laval avec 1787 hab./km², sont aussi les régions les plus «petites» en terme de superficie. Ces régions administratives sont suivies de loin par la Montérégie avec 142 hab./km², puis la Capitale-Nationale avec 40 hab./km² et Lanaudière avec 42 hab./km².
1.3 Les municipalités
Par ailleurs, le Québec ne compte
que peu de grandes villes, car seulement dix municipalités comptent
plus de 100 000 habitants:
| Rang | Municipalités | Population (2021) | Densité km² | Région administrative |
|
1 |
Montréal |
1 800 055 |
4 923 | Montréal |
| 2 | Québec | 566 066 | 1 246 | Capitale-Nationale |
| 3 | Laval | 446 369 | 1 807 | Laval |
| 4 | Gatineau | 292 281 | 855 | Outaouais |
| 5 | Longueuil | 253 629 | 2 186 | Montérégie |
| 6 | Sherbrooke | 175 114 | 478 | Estrie |
| 8 | Lévis | 154 091 | 344 | Chaudière-Appalaches |
| 7 | Saguenay | 147 952 | 130 | Saguenay-Lac-Saint-Jean |
| 9 | Trois-Rivières | 142 598 | 494 | Mauricie |
|
10 |
Terrebonne | 122 098 | 792 | Lanaudière |
|
11 |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 188 | 428 | Montérégie |
Les autres villes,
comptant 50 000 habitants et plus, sont les suivantes:
|
Brossard Repentigny Saint-Jérôme Drummondville Granby Mirabel |
91 693 88 088 82 061 81 551 70 823 64 032 |
Montérégie Lanaudière Laurentides Centre-du-Québec Estrie Laurentides |
|
Blainville Saint-Hyacinthe Mascouche Châteauguay Shawinigan Rimouski |
62 643 58 732 53 009 51 614 51 508 50 036 |
Laurentides Montérégie Lanaudière Montérégie Mauricie Bas-Saint-Laurent |
Il existe environ 1000 villes au Québec, la plupart n'ont qu'une faible population. En fait, les villes secondaires les plus populeuses sont situées près de Montréal en Montérégie, dans les Laurentides et dans Lanaudière.