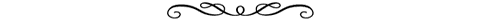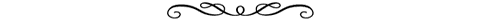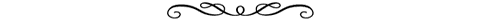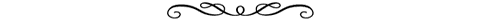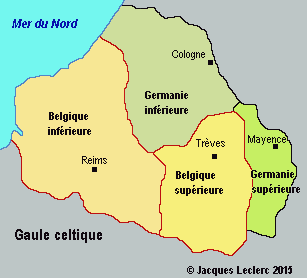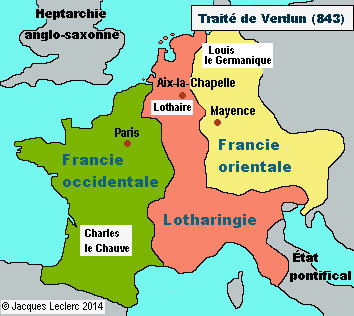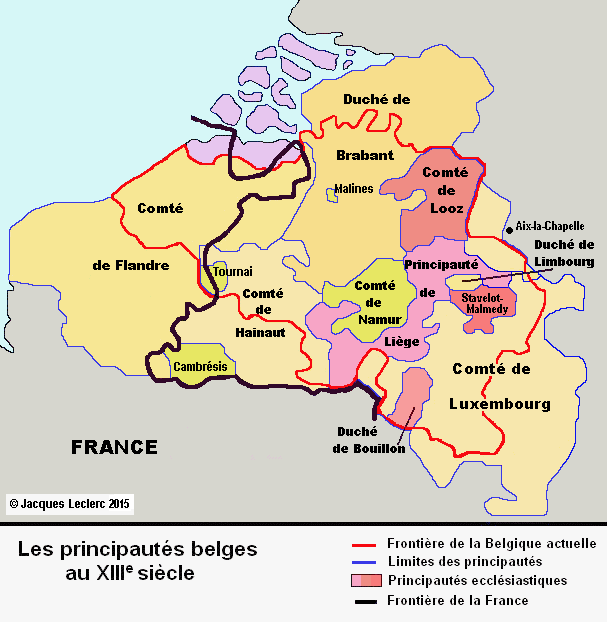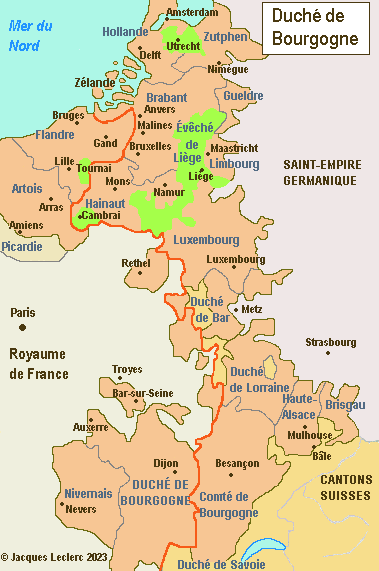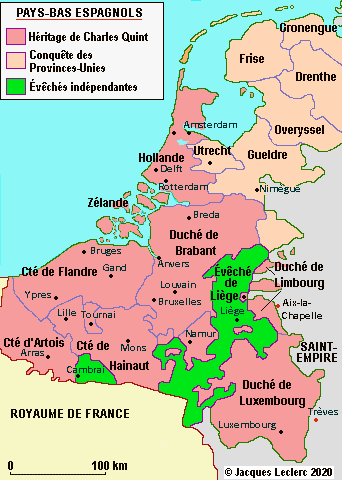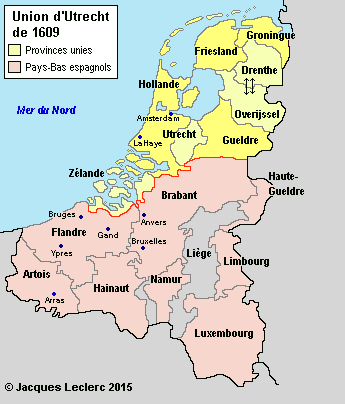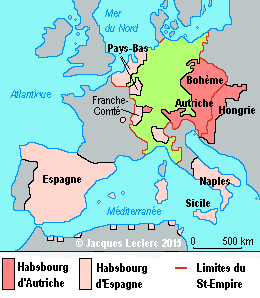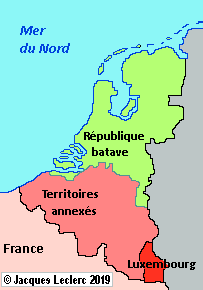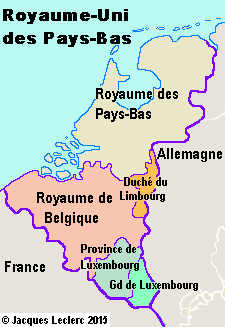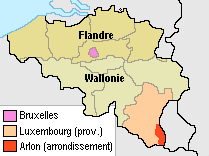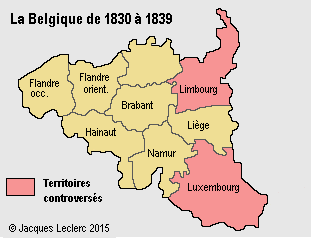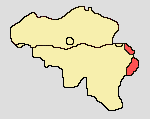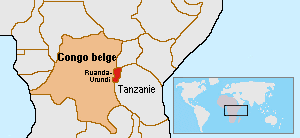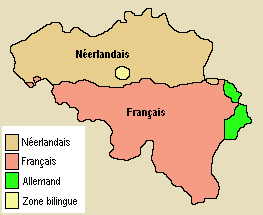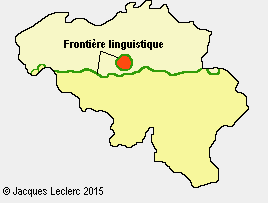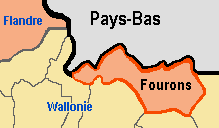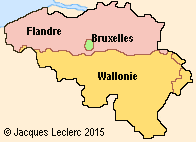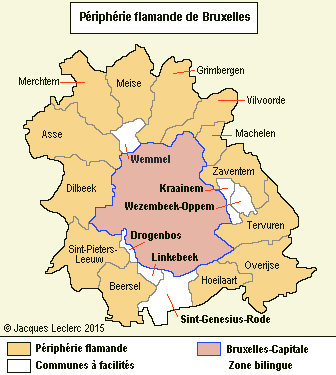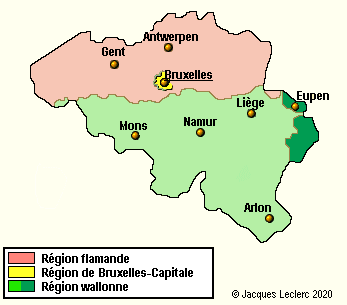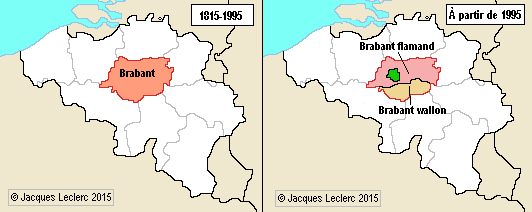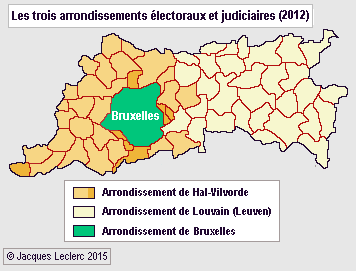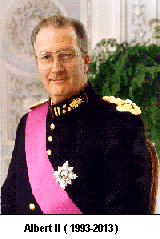|

|
3)
Histoire de la Belgique
et ses conséquences linguistiques
|
Belgique
- België - Belgien |
|
Nous remercions M. Albert Stassen d'avoir accepté d'assurer une
relecture commentée des différents chapitres consacrés à la Belgique
et à ses composantes. |
Plan de l'article
Vers 800 avant notre ère, au moment de la transition entre
l'âge du bronze et l'âge du fer, les premiers peuples installés sur le territoire de la Belgique furent sans
doute des Indo-Européens. Les archéologues ont trouvé des traces de
populations tant celtiques (à l’ouest) que germaniques (au nord). Si l’on
tient compte des fouilles archéologiques, on peut conclure que le territoire
actuel de la Belgique, de même que le nord de la France, a pu être une zone de
transition entre les cultures celtique et germanique. Par ailleurs, les écrits
d’Hécatée de Milet (vers 550 à vers 480) et d’Hérodote (-484 à -425) nous apprennent également que les Celtes
habitaient originairement une région qui s’étendait de l’ouest de la
France jusqu’au sud-est de l’Allemagne, mais qui pourrait exclure le nord de
la Belgique. Constitués en tribus autonomes et rivales, ces peuples étaient unis
par la religion druidique et la langue celtique.
1.1 La romanisation et les Belges
C'est avec la conquête de Rome que les Belges entrèrent
dans l'histoire. Mais les historiens
ne s'accordent pas sur l'origine exacte du mot «belge». Ce terme passé au latin
en Belgæ pourrait provenir du celte bhelgh signifiant «se gonfler» ou
«être furieux». On retrouve l'étymologie dans le vieil irlandais bolg qui
désigne, un «soufflet» ou un «ventre». Autrement dit, le Belge ne serait qu'un
vantard, toujours prêt à se gonfler comme une outre. D'autres sources avancent
une filiation avec le terme indo-européen bh(e)legh signifiant «briller».
Le mot «Belge» se rattacherait directement à la divinité celte Belenos
(dieu de la lumière, de l'harmonie et de la beauté). Comme on le constate, les
possibilités d'interprétation sont nombreuses, bien qu'aucune ne se révèle
déterminante.
En 57 avant notre ère, Jules César, dans le tome I de
La guerre des
Gaules, fit pénétrer ses légions dans la «Gaule belge». Dès cette époque, César faisait la distinction
entre les Celtes (ou Gaulois), les Aquitains et les Belges.
|
Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae,
aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli
appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. |
[La Gaule tout entière
est divisée en trois parties : les Belges habitent l'une, les
Aquitains l'autre et ceux qui s'appellent Celtes dans leur propre
langue et que nous appelons Gaulois dans la nôtre occupent la
troisième. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les
institutions et les lois.] |
César croyait que
les peuples belges étaient issus des Germains. Il a même fait une
énumération de ces Belges qui, sous le nom de Germani («qui uno nomine
Germani appellantur»), sont énumérés ainsi : Suessiones (Suessions), Nervii
(Nerviens), Atrabates (Abrates), Ambiani (Ambiens), Morini
(Morines), Menapii (Ménapiens), Caletes (Calètes), Veliocasses
(Véliocasses), Viromandui (Viromanduens), Aduatici (Aduaticiens),
Condrusi, (Condrusiens), Ebuones (Éburons), Caeroeses (Cérosiens)
et Paemanes (Pémaniens).
Cette assimilation des Belges aux Germains n’a
pas empêché Jules César de considérer les Belges comme des Gaulois (un peuple
celte). En réalité, certains peuples belges
étaient originaires des régions germaniques à l’est du Rhin, mais furent
vraisemblablement soumis à de fortes influences celtiques, alors que d’autres
peuples étaient d’origine celte. Il semble impossible
d'établir une séparation bien nette entre les différents
clans.
Parmi les nombreuses tribus du territoire de
la «Gaule belge» qui résistèrent à l’occupation romaine, César tenait les Belgae
(les Belges) pour les plus braves de tous les peuples de la Gaule. Dans
l'introduction de son livre De Bello Gallico (La guerre des Gaules), César
parle des Belges en ces mots: «Horum omnium fortissimi sunt Belgae.» Autrement
dit en français : «De tous, les Belges sont les plus valeureux.»
En réalité, pour César, fortissimi signifiait
les guerriers les plus «violents» ou les plus «sauvages», et ce, parce qu'ils
aimaient la bagarre et qu'ils étaient les plus éloignés de Rome, alors le centre de la
civilisation occidentale. C'est en Belgique, donc en Gaule belge, que César essuya sa plus sanglante défaite. Ambiorix, le chef
des Éburons, avait surpris les Romains dans la vallée du Geer (localisation
présumée) et avait
exterminé entièrement deux légions (6000 soldats). Arrivé trop tard en
renfort avec le reste de son armée pour éviter le massacre de ses légions, César poursuivit Ambiorix qui se réfugia dans la forêt ardennaise
où il ne parviendra jamais à le surprendre.
Mais certains historiens laissent croire que les peuples belges s’étaient
déjà formés dès le IVe siècle avant notre ère, alors que d’autres
situent cette mixité plutôt vers le IIe siècle. À l’époque de
la conquête des Gaules, en 57 avant notre ère, la Gaule belge s’étendait
entre la mer du Nord, la Seine et la Marne (voir la carte ci-dessous), et comptait quelque 500 000
habitants répartis en une quinzaine de tribus. Les Belgae parlaient des
idiomes germaniques, fortement influencés par les parlers celtiques, mais d’autres
historiens considèrent qu’il s’agissait d’idiomes celtiques fortement influencés
par des apports germaniques.
Vers 200 avant notre ère, des Belges franchirent la Manche pour émigrer dans les
îles Britanniques, principalement dans le sud-est de l'actuelle Angleterre.
1.2 Une province romaine
|
 |
Après la soumission des Nerviens (de 57 à 46), la Gaule belge finit par
devenir officiellement une «province romaine» en 51. La résistance poussa
César au génocide de certaines tribus comme les Éburons et les Aduatiques.
D'autres tribus d'origine germanique vinrent alors repeupler les territoires
disponibles, avec l'assentiment des Romains. La population, appelée
Belgae, les Belges, était ainsi formée d'un mélange de Celtes,
ainsi que des peuples germaniques et non indo-européens déjà
assimilés. Les conquérants supprimèrent la caste
des druides d’influence celtique, mais les Belgae continuèrent à adorer leurs dieux
germaniques, puis celtiques, en plus des nouveaux dieux romains. Ceux
que les Romains appelaient les Germani (les Germains)
correspondaient aux habitants originaires des régions rhénanes. La
première capitale de la Gaule belgique était la ville de Reims.
Cette grande province romaine s'appelait alors la Gallia Belgica (Gaule belgique),
qui s’étendait entre la Manche, la Seine, la Marne et le Rhin.
Cette province était de première importance
pour les Romains, car elle servait de tampon et de défense en raison de la frontière rhénane avec les territoires
germaniques. |
|
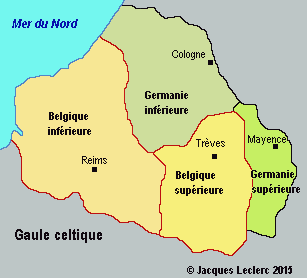 |
À partir du du
IIIe siècle, la
grande province belge fut démantelée en une Germania (Germania prima et
Germania secunda) dans la zone rhénane et une Belgica,
elle-même scindée en deux "provinciæ", la Belgica prima au sud-est et
la Belgica secunda au nord-est. La province appelée Belgica
prima avait Trèves
comme capitale et n’occupait qu’une partie du Luxembourg actuel. Par contre,
la Belgica secunda était beaucoup plus grande et occupait tout le
nord-ouest de la Belgique actuelle avec Reims (actuellement en France) comme
capitale.
La Germania prima (ou Germanie
supérieure) comprenait une grande partie de ce qui est
aujourd'hui la Suisse, le Jura, la Franche-Comté et la Bourgogne).
La capitale de la Germanie supérieure était Mogontiacum appelée aujourd'hui
Mayence. La Germanica secunda
(ou Germanie inférieure) était située au nord-est dans ce qui est
aujourd’hui le sud des Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, une partie
du nord-est de la France (Ardennes), et le nord-ouest de l'Allemagne, avec comme capitale
Cologne. Aucune de ces capitales
n'est aujourd'hui sur le sol belge. |
C'est dans
ce cadre administratif que, peu à peu, le latin se répandit en Belgique,
pendant que les langues celtiques disparaissaient graduellement. Le latin allait
remplacer les langues celtiques et germaniques des peuples belges en commençant
par les villes. Les langues celtiques survécurent dans les campagnes, du moins
jusqu'à l'arrivée du christianisme. Épris de centralisme, les Romains avaient
compris l'importance d'une langue véhiculaire unique dans les domaines
administratif, culturel et commercial.
L'influence
romaine entraîna à la fois la christianisation et la romanisation du territoire,
surtout dans la partie méridionale de l'actuelle Belgique, ce qui correspond à
la Wallonie qui vit se multiplier les villae (grands domaines de la
civilisation romaine). Les régions les plus
éloignées du centre de l'Empire allaient voir se développer des langues issues
du latin, qui deviendront les futures
langues romanes. Parmi celles-ci, il faut mentionner le français, le
picard, le wallon, le champenois, le gaumais (ou lorrain).
Déjà au IIIe
siècle, mais surtout à partir du
IVe siècle, les peuples
germaniques progressèrent vers de l'est vers l'ouest. Les Celtes furent
repoussés vers le Danube et franchirent le Rhin. Attirés par les terres
fertiles, des Germains envahirent l'est de la Belgique (Belgica). Parmi ceux-ci,
les Francs s'installèrent massivement dans tout le
pays. Cependant, l'histoire de l'installation des Francs dans ces régions reste
mal connue. Ils se seraient établis par vagues successives, surtout dans ce qui allait devenir la Flandre (au nord);
ils conservèrent leur
langue germanique, le francique. Au sud
et au sud-est, les Francs durent faire face à des populations gallo-romanes numériquement plus importantes; ils ne purent imposer
leur langue et se fondirent dans l’élément gallo-roman, créant ainsi une sorte
de fusion entre les envahisseurs et les peuples conquis. Toutefois,
l'imprécision des connaissances sur la densité de ces peuples rend aléatoire
toute discussion sur l'origine de la frontière linguistique actuelle. Intégré
dans l'empire franc à partir du
Ve
siècle, l'espace belge demeure une province frontière dans le royaume
mérovingien.
Ce sont les Francs qui auraient donné le nom
de Wallon (de walha, nom
francique d’une tribu celtique de la Gaule narbonnaise, les Volcae,
mais ce nom signifie aussi «étrangers») aux habitants de cette région
du sud de la Belgique. Par la suite, les populations flamandes leur auraient
attribué le même nom (Waal). Lentement, et sans aucune conscience
«nationale», les Wallons du Sud donnèrent naissance à ce qui deviendra beaucoup
plus tard la «Wallonie».
Ainsi, Flamands et Wallons de Belgique ont en fait les
mêmes ancêtres et proviennent en partie des mêmes peuples. C’est donc au Moyen
Âge seulement que se marqua progressivement une sorte de «frontière
linguistique» entre les deux communautés flamande et wallonne de la Belgique
actuelle, avec par ailleurs une large frange mixte tout le long de l’actuelle
frontière linguistique. Cette frange ne se résorba que progressivement au cours
du Moyen Âge. Cependant, la langue administrative et juridique de cette époque
demeurait le latin. Évidemment, le problème des langues vivantes ne se posant
pas.
En 800, Charlemagne devint empereur du Saint-Empire romain germanique et, à
ce titre, l'héritier de la langue lignées des empereurs romains. Charlemagne
fixa sa capitale à Aix-la-Chapelle.
|
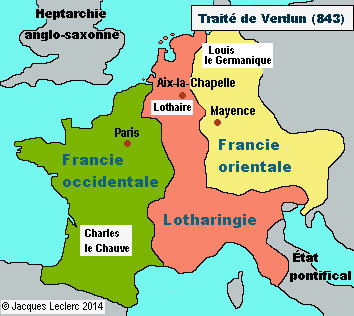
|
À sa mort, son fils Louis le Pieux lui succéda et dut faire
face au partage de l'Empire, selon les termes du traité de Verdun (843),
entre ses fils, c’est-à-dire Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire) de Charlemagne.
La Francie
occidentale, soit les pays
situés à l’ouest de l’Escaut, de la Meuse, de la Sône et du Rhône,
revint à Charles le Chauve; la Francie
orientale, soit les pays à l’est
du Rhin, échouèrent à Louis le Germanique, alors que la Lotharingie
(les pays compris entre la mer du Nord jusqu’au golfe de Tarente, avec
les deux capitales d’Aix-la-Chapelle et de Rome) était attribuée, en
même temps que le titre impérial, à Lothaire.
Les conséquences du traité de Verdun furent
considérables pour la Belgique, puisqu'une frontière politique divisait le
territoire selon un axe nord-sud correspondant en grande partie au fleuve
L'Escaut. Dorénavant, les territoires situés à l'ouest resteront sous la
zone d'influence de la France, tandis que ceux situés à l'est appartiendront
à la Lotharingie. En somme, la Flandre et la France revinrent à Charles le Chauve, tandis que
la Wallonie (le Hainaut et le Brabant) fut intégrée à la Basse-Lorraine, un
duché de la Lotharingie.
|
Comme on s’en doute, cette division territoriale ne
s’est pas faite sur une base linguistique, mais sur une base politique. Le territoire
de la Belgique restée en Lotharingie comportait différente langues dont une majorité de
dialectes romans, mais aussi des territoires à parlers thiois ou flamands. Les autres parties
thioises ou flamandes (constituant le reste de la Flandre actuelle)
furent incorporées à la Basse-Lorraine (l'Empire germanique) comme le reste du
territoire qui constitue maintenant la Wallonie. Bref, cette partie du nord-est
du royaume appartenant à Charles le Chauve comptait une population parlant un
ensemble diverses langues romanes et germaniques. Ainsi, les peuplades
gallo-romaines et germaniques furent amenées à cohabiter, non sans
provoquer des heurts.
En 959, la Lotharingie fut scindée en deux duchés: la Basse-Lotharingie au nord
et la Haute-Lotharingie au sud (la future Lorraine).
|
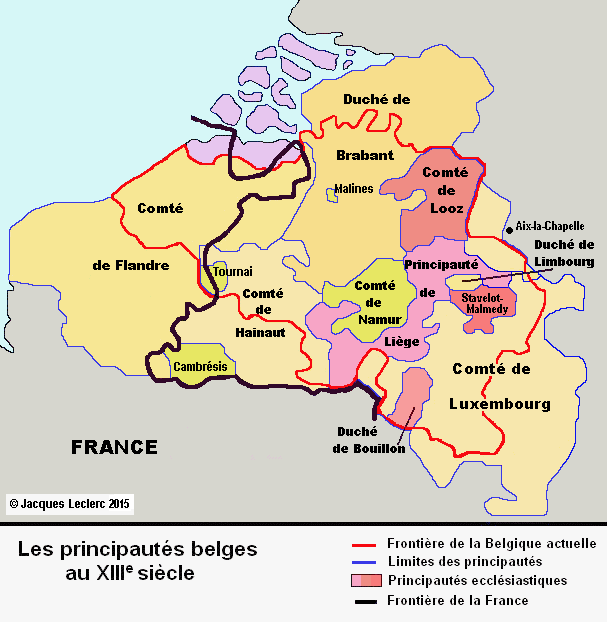 |
Au cours du Moyen Âge, se créèrent de nombreuses principautés
indépendantes (Basse-Lorraine, Liège, Tournai, Cambrai, Malines), de duchés
(Brabant, Luxembourg, Limbourg) et de comtés (Flandre, Hainaut, Namur, Artois,
Louvain, Bruxelles, etc.), qui se multiplièrent au IXe et au Xe
siècles et réussirent à obtenir de plus en plus d’autonomie de la part de
leurs suzerains. On assista à une multiplication de petits territoires
autonomes.
La Flandre constituait un fief du roi de France, mais qui résistait aux
tendances centralisatrices de ce dernier. Régulièrement, la France intervenait militairement dans la région — une soixantaine d’invasions, soit une
par décennie.
Le 11 juillet 1302, eut lieu une
victoire des villes flamandes soutenues par des Namurois (Namur) et des
Hennuyers (Hainaut) à Courtrai. Cette victoire
fut appelée la «bataille des
Éperons d’or» (en raison des quelque 300 éperons des nobles français
retrouvés sur le champ de bataille). Cette bataille a été choisie comme
date de la fête de la Communauté flamande de Belgique (même si cette
victoire de 1302 était aussi l’œuvre des Wallons).
La bataille des Éperons d'or du 11 juillet 1302 est célébrée chaque
année à Courtrai et dans tout le pays flamand avec la participation de
représentants du gouvernement belge, et ce, malgré le caractère anti-français
donné à cette manifestation.
D’ailleurs, la
fête de la Communauté française, le 27 septembre, commémore, les
journées victorieuses de septembre 1830 à
Bruxelles où les Hollandais furent
chassés par des Wallons, des Bruxellois et des Flamands.
La victoire de 1302
fut suivie d’autres batailles jusqu'à la défaite des Flamands en 1328,
lors de la bataille de Cassel. Néanmoins, la victoire française
ne mit pas fin aux aspirations autonomistes de la Flandre.
|
Considérée comme le plus riche fief du royaume de
France, la Flandre réussit à conserver une certaine autonomie en payant des
impôts royaux élevés. En même temps, la Flandre profita de son ouverture
maritime pour développer le commerce avec l'Angleterre et exporter ses
richesses. En 1340, les armées du roi de France furent vaincues
par une coalition anglo-flamande. En 1369, Philippe le Hardi, l’oncle du roi
de France, épousa la fille et héritière du comte de Flandre.
|
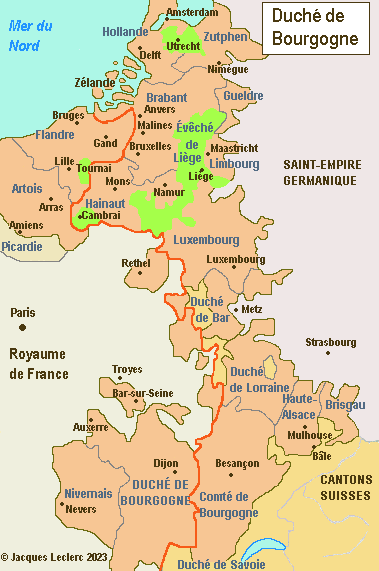 |
Par la suite, plusieurs comtés et duchés (Namur, Brabant, Limbourg,
Hainaut, Luxembourg, Hollande, Gueldre, etc.) passèrent aux mains des ducs de
Bourgogne. Avec la Flandre, le duché de Bourgogne s'étendait de la
Bourgogne proprement dite, avec Dijon comme capitale, jusqu'à la mer du
Nord et, à sa plus grande extension, jusqu'aux îles de la Frise. Les
ducs de Bourgogne instaurèrent des institutions qui eurent pour
conséquence d’unifier un peu plus le pays. Les mariages princiers, les
achats, la diplomatie et les héritages contribuèrent à réunir la plupart
des États. Mais c'est au cours du
règne de
Philippe III le Bon (1419-1467) que toutes les principautés des Pays-Bas
passèrent sous le contrôle de la maison de Bourgogne. Ces territoires,
qui s'étendaient bien au-delà des régions constituant la Belgique
d'aujourd'hui, sauf Liège qui restait un évêché indépendant,
comprenaient également l'Artois français, la rive gauche du Rhin à
l'est, la Zélande, la Hollande, la Gueldre et d'autres terres au nord
formant actuellement les Pays-Bas.
N’oublions pas que les ducs de Bourgogne
cumulaient plusieurs titres. Par exemple, selon les époques (entre 1384 et
1475), le duc de Bourgogne pouvait être à la fois comte de Franche-Comté, comte
d’Artois, comte de Picardie, comte de Flandre, comte de Nevers, comte de
Hainaut, comte de Zélande, comte de Hollande, duc de Luxembourg, duc de Namur,
duc de Limbourg, duc de Brabant, etc. En épousant Maximilien d’Autriche en 1477,
Marie de Bourgogne mit les provinces
belges sous la domination des Habsbourg
(plus tard avec ses deux branches: les Habsbourg d’Autriche et ceux d’Espagne).
Maximilien signa avec Louis XI le traité d’Arras, qui laissait à la France la
Bourgogne ducale et la Picardie.
Selon certains, ce
morcellement politique eut des conséquences au plan linguistique. Il aurait
favorisé la fragmentation dialectale, ce qui contribua à la formation des
idiomes picards, flamands, wallons, champenois, lorrains, luxembourgeois,
limbourgeois, etc. Cependant, l’administration des États et de l’Église se
faisait en latin, tandis que le français n’était parlé encore que par une partie
de la noblesse de France.
Cette thèse de
la fragmentation dialectale à l’époque féodale est cependant contestée, car
d’autres linguistes considèrent que la fragmentation dialectale était acquise
depuis bien plus longtemps et pratiquement depuis les invasions franques,
lesquelles
étaient constituées de groupes divers aux langues déjà différenciées. |
|
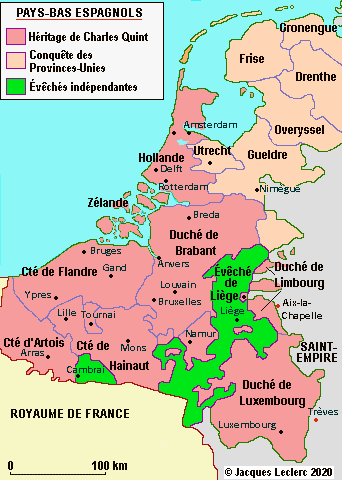 |
En 1493, Philippe le Beau devint le souverain des
Pays-Bas et épousa l’héritière de la maison d’Espagne, Jeanne d'Aragon dite
Jeanne la Folle, la fille du roi Ferdinand II d'Aragon et de la reine
Isabelle Ire de Castille.
Leur fils Charles
(1500-1558), qui fut Charles
Ier en
Espagne, Charles Quint
pour le Saint-Empire romain germanique
et plus familièrement
Keizer Karel
(«l'empereur Charles») aux Pays-Bas, est né à Gand. Il fut d’abord prince bourguignon (de langue
maternelle française), puis, en 1516, prince des Pays-Bas et roi d’Espagne,
enfin en 1519 roi de Sicile et empereur du Saint-Empire romain germanique.
Ce monarque
parlait non
seulement le français, mais aussi le picard, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le latin et
même un peu le flamand (sous sa forme thioise) de sa ville
natale de Gand (Gent en néerlandais). On sait qu'il écrivait en
français à ses frères et sœurs, mais qu'il
employait l'espagnol pour correspondre avec sa femme et ses enfants. C’est d’ailleurs ce même Charles polyglotte qui aurait affirmé: «Je
parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon
cheval.» Son chroniqueur, Pierre de Bourdeille, dit Brantôme (154-1614), écrivit
ce commentaire sur l'importance des langues pour Charles Quint :
|
Aussi qu'entre toutes les langues, ainsin qu'il en
pouvoit juger pour estre prince d'une très heureuse
mémoyre, disoit la francoize tenir plus de la majesté et
que c'estoit la langue des roys et des princes; car il
avoit plusieurs langues familières, prononceant et
répettant fort souvant le proverbe turquesque parmi ses
plus grands favoris, quand il tumboit sur le devis de la
beauté des langues, qui dict : sucadar dil lu cadar
adanis; brave et superbe proverbe turc qui veut dire
qu'autant de langues que le gentilhomme sçait parler
qu'autant de fois est-il homme ; tellement que si une
personne parloit de neuf ou dix sortes de langages, il
l'estimoit autant luy tout seul qu'il heust faict dix
autres hommes, ou plus, de semblable qualité. |
|
Dans une ordonnance, Charles Quint prescrivit
de rédiger les textes officiels aussi bien en français qu'en thiois
(variante flamande),
le néerlandais de l'époque, ou en latin en fonction de la
langue du destinataire ou de la nature de l'acte dans une population
généralement bilingue.
4.1 Le règne de Charles Quint (1515-1555)
|
 |
Charles Quint, était non seulement roi des Pays-Bas, empereur du Saint-
Empire, mais également roi d’Espagne, royaume qu'il avait hérité de sa mère. Il ne s’agissait pas d’une unité
politique entre l’Espagne et les Pays-Bas, mais les deux royaumes étaient
néanmoins sous la souveraineté du même roi.
Charles Quint se trouvait ainsi à la
tête d’un formidable empire encerclant pratiquement la France.
L’époque de Charles Quint
(première moitié du XVIe siècle) fut une
période faste pour l’ensemble des habitants des provinces de l’actuelle Belgique
et des Pays-Bas.
Chaque principauté conservait ses lois, ses usages et sa
constitution; les langues et les dialectes qui y étaient parlés
étaient très diversifiés et étrangers à la langue du souverain.
|
|
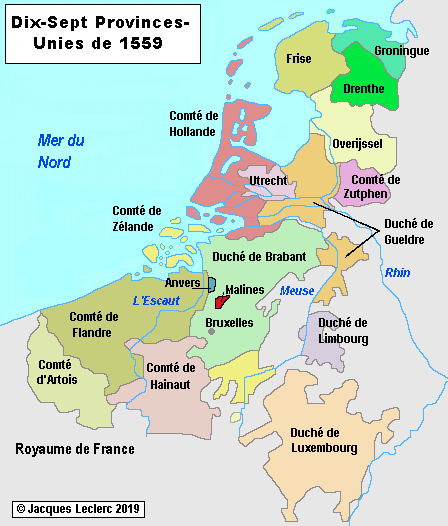 |
En
tant que souverain des Pays-Bas, Charles réussit à rattacher les Dix-Sept
Provinces-Unies
(en néerlandais : Zeventien Verenigde
Provencies) sous son autorité, aussi bien les provinces de langue germanique du Nord
(Flandre, Anvers, Limbourg, Luxembourg, Frise ou Friesland, Overijssel,
Hollande, Utrecht, Gueldre, Zélande, etc.) que les provinces romanes du Sud
(Artois, Namur, Brabant, Hainaut, etc.). Juridiquement, les Pays-Bas formaient
avec les autres principautés allemandes le Saint-Empire romain germanique. Cette
appellation des «Dix-Sept Provinces» se répandit après que Charles
Quint eut ajouté aux Pays-Bas bourguignons le duché de Gueldre, le
comté de Zutphen et les seigneuries d'Utrecht, d'Overijssel et de
Groningue. Ce nom de «Dix-Sept Provinces» allait disparaître après
la séparation des provinces du Nord de celles du Sud. Aujourd'hui, tout ce
territoire relève des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, du
département Nord-Pas-de-Calais en France et de quelques portions de
territoires à l'ouest de l'Allemagne.
Le contrôle des
Dix-Sept Provinces était d'un importance primordiale pour la couronne
d'Espagne. Sous le règne de Charles Quint, l'Espagne prélevait annuellement
cinq millions d'or dans ses diverses possessions, dont deux millions
uniquement des Pays-Bas espagnols, soit quatre fois plus que l'or provenant
des Amériques ou d'Espagne.
Le règne de Charles Quint correspond aussi à la naissance de la Réforme et
du luthéranisme en Allemagne du Nord. En tant que défenseur de la foi
catholique, sacré par le pape en 1530, Charles Quint ne pouvait se
soustraire à l'obligation de défendre la religion catholique. C'est lui qui
fut l'instigateur du concile de Trente (1545-1563) en espérant tendre la
perche aux réformés, ce qui ne se produisit pas.
|
Charles Quint
publia alors ses «placards» pour contrer l'influence
grandissante des réformes protestantes; les premiers
protestants furent signalés dès les années 1520. Aux
Pays-Bas, l'empereur fit placarder une série d'édits
très stricts contre «l'hérésie calviniste». Ce fut
l'introduction d'une inquisition sur le modèle de celle
qu'il avait découverte en Espagne.
Toutefois, l'application de ces placards demeura assez souple jusqu'à
l'arrivée de Philippe II, mais la religion allait introduire à jamais une
cassure entre les Pays-Bas du Nord (de confession calviniste) et ses
provinces du Sud (de confession catholique).
4.2 Les problèmes de
Philippe II
 |
C’est avec Philippe II
(1527-1598), le fils de Charles Quint, que les problèmes
commencèrent aux Pays-Bas espagnols. Étant élevé en Espagne (Castille)
—
il est né à Valladolid —,
ignorant tout du flamand et du hollandais (néerlandais), et ne connaissant qu’un peu de
français et de latin, son éducation exclusivement espagnole le fit peu
apprécier aux Pays-Bas espagnols, lesquels lui furent confiés en 1555 après
l’abdication de Charles Quint. Autant celui-ci était un «enfant du pays»,
autant Philippe II était un «souverain «étranger».
C'est effectivement sous le règne de Philippe II que
commença à se faire sentir aux Pays-Bas le poids d'une domination étrangère,
clairement ressentie comme hostile. Le nouveau souverain reprit la politique de son père, mais
d’une façon beaucoup plus étroite, surtout en matière de religion avec l'imposition stricte de l’Inquisition et des «placards» de
Charles Quint.
Les Dix-Sept Provinces des Pays-Bas eurent le sentiment de jouer le rôle de
vache à lait pour un royaume lointain et de plus en plus contraignant.
|
En 1559,
Philippe II confia la gouvernance des Pays-Bas espagnols à sa demi-sœur
Marguerite de Parme (1522-1586), fille naturelle de Charles Quint. Forcée
d'appliquer les «placards» réprimant l'hérésie protestante par des peines
féroces, Marguerite de Parme chercha à adoucir la politique anti-calviniste
de Philippe II au moyen de mesures de compromis afin d'éviter la révolte de
la noblesse et la grogne populaire. Coincée
entre l'intransigeance de son demi-frère et la sympathie grandissante de
l'opinion populaire pour les calvinistes, Marguerite finit par demander sa
démission.
Philippe II nomma alors Ferdinand Alvare de Tolède, duc d'Albe,
comme plénipotentiaire qu'il envoya à Bruxelles, alors la capitale des
Pays-Bas espagnols, avec l'ordre de «pacifier» les provinces du Nord.
Le protestantisme fut alors violemment réprimé, tandis
que la religion catholique demeura la seule autorisée par le nouveau
gouverneur.
Mais les exécutions massives et les atrocités commises par les
troupes espagnoles du duc d'Albe entraînèrent la rébellion de toute la
population des provinces du Nord.
En ce qui concerne les langues, la situation parut
relativement complexe en raison du centralisme politique. Les Espagnols
parlaient leur langue, notamment dans l'entourage du gouverneur. Par contre,
les conseillers utilisaient le français pendant que les fonctionnaires
employaient le flamand. Quant au latin, il demeurait une langue
incontournable en matière religieuse. Enfin, les dialectes germaniques
demeuraient très employés par les populations de l'Est. Ce n'est donc pas
dans le domaine des langues qu'il fallait chercher une quelconque unité dans
les Pays-Bas espagnols, mais plutôt dans le domaine de la religion. Face au
développement du protestantisme, l'Église catholique réussit à s'imposer au
plan religieux.
En 1576 les Espagnols perdirent le contrôle des Pays-Bas. En
1577, le prince d'Orange (en néerlandais: Willem van Oranje),
Guillaume comte de Nassau, appelé également Guillaume le
Taciturne, fit son entrée à Bruxelles à l’invitation de
l’assemblée des États généraux et fut proclamé «ruwaert du
Brabant», c’est-à-dire «protecteur». Par l'Union de Bruxelles du 9 janvier
1577, les Pays-Bas décidèrent de se diriger eux–mêmes. La Zélande et la
Hollande, refuge des calvinistes, firent sécession avec Guillaume d’Orange.
Le 6 janvier 1579, les catholiques des comtés d'Artois, du
Hainaut et du Cambrésis en vinrent à former
l'Union d’Arras afin de combattre les
orangistes et leur politique calviniste. Le 13 janvier suivant, ceux-ci répliquèrent en leur opposant l'Union
d’Utrecht, ce qui donna naissance à la République des
Sept-Pays-Bas-Unis (en néerlandais : Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden):
Hollande, Zélande, Overijssel (avec Drenthe), Friseland, Groningue, Gueldre,
Utrecht. S'y ajoutèrent des territoires connus sous le nom de
«pays de la Généralité» (en néerl.:
Generali-teitslanden): la Flandre des États, le Brabant des
États, le Limbourg des États (avec Maastricht), la
seigneurie de Drenthe, ainsi que les colonies et territoires
d'outre-mer. Contrairement aux sept provinces autonomes,
ces territoires n'avaient pas d’États provinciaux et n'étaient
pas représentés au gouvernement central.
Bref, les anciennes «Dix-Sept Provinces»
créées par
Charles Quint furent scindées
en deux entités, qui n'allaient plus jamais être réunies
politiquement.
|
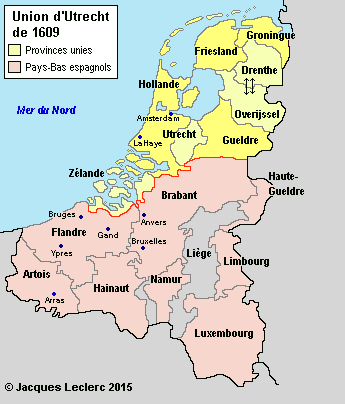 |
Les sept
provinces du Nord (les actuels Pays-Bas), de religion réformée,
adoptèrent le statut de république indépendante, alors que les
provinces du Sud, reconquises par les
armées espagnoles, réintégrèrent l'Église catholique sous
l'autorité de Philippe II d'Espagne, mais la principauté de
Liège put conserver son autonomie, coupant ainsi en deux les
Pays-Bas du Sud, eux-mêmes déjà peu homogènes. La Gueldre
fut elle-même séparée en deux: la Basse-Gueldre au nord et la Haute-Gueldre
au sud, appelée aussi
«Gueldre espagnole». En 1581, le culte catholique
fut aboli dans le Nord, alors que la ville de Bruxelles allait
être gouvernée par les protestants jusqu’en 1585. La défaite de
l'Invincible Armada en 1588 contre l'Angleterre annonça le
déclin de l'Espagne.
Le traité d'Anvers de 1609
reconnut officiellement la scission des Dix-Sept Provinces en
deux entités:
1) Les sept provinces du Nord
prirent leur indépendante sous le nom de «Provinces-Unies»: Hollande,
Zélande, Utrecht, Gueldre, Overijssel, Friesland et Groningue (avec
Drenthe).
2) Les dix provinces du Sud,
appelées parfois appelées «Pays-Bas du Sud» (ou encore «Pays-Bas espagnols»)
allaient former à partir de 1713 les Pays-Bas autrichiens, qui le
resteront jusqu'à l'occupation française en 1795 : Flandre, Artois, Malines,
Anvers, Hainaut, Namur, Brabant, Limbourg, Luxembourg, auxquels se joignit
Cambrai.
|
L'Artois et une partie de la Flandre et du Hainaut allaient être cédées à la
France au cours des XVIIe et
XVIIIe siècles.
Déjà sous le régime espagnol, les cartographes désignaient les
Pays-Bas sous deux appellations: la Belgica Foederata («Belgique
fédérée») pour les provinces du Nord et la Belgica Regia
(«Belgique royale») pour celles du Sud, future Belgique.
4.3 L'unification linguistique
C'est à cette époque que les Pays-Bas-Unis se métamorphosèrent en
une puissance mondiale, la plus dynamique de l'Occident, avec une marine
impressionnante de quelque 10 000 navires en 1600, puis 15 000 en 1670, soit
cinq fois plus que la flotte anglaise. Cette puissance se traduisit par une
extraordinaire activité aux plans artistique, culturel et littéraire. La
littérature fut à l'origine de l'uniformisation de la langue d'où allait naître
le néerlandais qui devint alors la langue de référence commune.
La langue qui se développa au nord à cette
époque fut une variété de néerlandais ayant une forte influence brabançonne
(anversoise). Cette uniformisation linguistique fut
renforcée par une traduction officielle de la Bible en 1637. Toutefois, ce n'est
qu'en 1804 que le gouvernement néerlandais chargera le professeur
Matthias Siegenbeek de mettre au point un système
orthographique uniforme, qui fut généralement appliqué.
Évidemment, les provinces du Sud, c'est-à-dire les
Pays-Bas espagnols, ne participèrent pas à
cette unification linguistique des provinces du Nord, laquelle rendait caduques les dialectes
locaux. Pendant que le néerlandais devenait la référence normale du Nord, le
flamand du Sud ne cessait de se multiplier en une mosaïque de dialectes
régionaux.
Pour la Flandre, cette fragmentation linguistique allait avoir des conséquences
néfastes dans la future Belgique, car elle allait favoriser
le français qui gagnait rapidement du
terrain dans les milieux de l'aristocratie flamande.
Depuis la période bourguignonne, le français était déjà la langue véhiculaire de
la plus grande partie de la noblesse et servait de langue administrative. Le
néerlandais du Nord demeurait plus ou moins inconnu en Flandre, car il n'était parlé par le peuple
que sous diverses formes dialectales; il était associé à une langue de paysans, qui
ne pouvait plus progresser.
Malgré les révoltes et les guerres, le territoire de ce qui sera la Belgique
continua de faire partie des Pays-Bas espagnols jusqu’en 1713. Entre-temps, le
traité de Munster (1648) rendait des parties de la Flandre (la Flandre
zélandaise), le nord du Brabant ainsi que quelques territoires d’outre-Meuse,
aux Provinces-Unies. Comme il s’agissait d’un État confédéral, les
Provinces-Unies conservèrent une certaine autonomie, mais les territoires du
Sud furent administrées directement par les autorités espagnoles.
L'empire des Habsbourg était l'un des plus vastes et des plus peuplés
d'Europe. Il comptait une grand nombre de peuples divers amenés à coexister au
sein de cette vaste structure impériale grâce à des alliances, des héritages,
des guerres et des conquêtes. On y parlait des dizaines de langues et des
centaines de dialectes. Parmi les langues importantes, mentionnons l'allemand,
le français, l'espagnol, l'italien, le hongrois, le flamand, etc. On y
pratiquait aussi plusieurs religions, dont le catholicisme, le protestantisme,
la religion orthodoxe, le judaïsme, l'islam, etc. Les différentes régions de
l'Empire conservaient leurs lois et leurs coutumes auxquelles les habitants
demeuraient très attachés. C'était le cas pour les Pays-Bas qui sont tombés sous
la domination autrichienne après la guerre de Succession d'Espagne. L'empire des
Habsbourg était formé de deux branches: la branche espagnole et la branche
autrichienne. La branche espagnole s'est éteinte pour les descendants mâles en
1700, ce qui déclencha la
guerre de Succession d'Espagne en 1701.
Étant donné que le roi d'Espagne, Charles II, n'avait pas d'héritiers
directs, sa mort posa problème, car deux familles apparentées aux souverains
espagnols prétendirent avoir des droits à l'héritage espagnol, les Bourbon de
France et les Habsbourg d'Autriche. Or, toute l'Europe se sentit menacée par
l'alliance dynastique de la France et de l'Espagne, notamment la
Grande-Bretagne, le Saint-Empire romain germanique et les Pays-Bas. La guerre de
Succession d'Espagne allait durer de 1701 à 1713. À la fin de la guerre, Louis
XIV allait perdre une grande partie des territoires conquis sous son règne, dont
Terre-Neuve, la Baie d'Hudson et l'Acadie péninsulaire (la Nova Scotia), afin de
voir son petit-fils roi d'Espagne, tout en renonçant au trône de France.
|
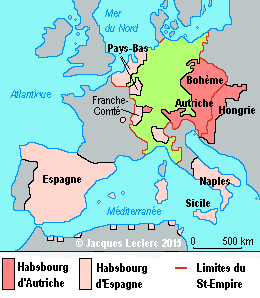 |
Le
traité d'Utrecht de 1713 cédait les Pays-Bas espagnols
à l'Autriche sous le nom de
Pays-Bas
autrichiens (en allemand:
Österreichischen Niederlande).
Les Pays-Bas demeurèrent un État fédéral formé d'une dizaine de provinces semi-autonomes
et dirigés par les Habsbourg d'Autriche, qui
reprirent les institutions centrales de l'Espagne à
Bruxelles.
Pendant ce temps,
en Espagne, la couronne passait aux Bourbons, avec Philippe V d'Espagne,
petit-fils de Louis XIV.
La paix ne revint aux
Pays-Bas qu'au prix de nouvelles amputations.
Des villes wallonnes comme Charleroi, Binche, Ath et Tournai
furent cédées à la France; des cités flamandes comme Furnes, Bergues, Courtrai
et Audenarde, ainsi que Lille et Roubaix, passèrent à la couronne française.
Si le traité d’Utrecht de 1713 avait
donné une partie de la Flandre à la
France,
le traité d’Aix-la-Chapelle de 1748 rendit certaines régions (Nieuport,
Courtrai, Ypres) à l’Autriche. Sous le
règne de
Marie-Thérèse
d'Autriche
(1717-1780), les provinces du Sud bénéficièrent de l'apport des
«Lumières» et d'une politique de renouveau administratif, économique
et culturel.
|
L'Autriche
étendit son emprise et intervint dans la gestion des États tout en favorisant
l'essor des industries charbonnières et métallurgiques, ainsi que l'industrie
textile.
5.1 L'espagnol et l'allemand
Jusqu'en 1740, l'espagnol a été utilisé comme langue véhiculaire au Conseil des Pays-Bas
à Vienne (devenu en 1757 le «Bureau belge»). Mais avec la centralisation
autrichienne l'usage du français devint prépondérant dans l'administration
centrale, au détriment des langues régionales qui restèrent limitées dans les
villes belges. Cependant, les documents officiels locaux furent rédigés en
néerlandais ou en brabançon en Flandre et aux Pays-Bas actuels et en français
dans la Wallonie actuelle.
Plus tard, l'empereur d'Autriche,
Joseph II (1741-1790), en despote éclairé,
entreprit de faire de ses possessions un État moderne, centralisé et germanique.
Jusqu'alors, les Pays-Bas autrichiens avaient conservé une administration rétrograde héritée
des Espagnols. Les privilèges arrachés depuis des siècles ne servaient plus qu'à
favoriser l'esprit de clocher le plus étroit. C'est pourquoi l’administration des Pays-Bas du Sud fut totalement refondue et réorganisée
selon le modèle français. Joseph Il manifesta une certaine ouverture à la liberté
d'expression et fit preuve de tolérance à l'égard de la presse. L'empereur voulut abolir les privilèges des principautés,
instituer son autorité directe et imposer la langue allemande,
non pas dans l’administration interne, mais dans les communications avec Vienne. La fièvre réformatrice toucha tous les domaines, y compris la
longueur des chandelles. Tout se décidait à Vienne, pendant que les réforme sur
le terrain passaient mal. En même temps, le monarque se trouvait à faire fi des
particularismes des principautés belges et du poids des anciennes coutumes.
5.2 Bruxelles et la Révolution brabançonne
Quant à la ville de Bruxelles, elle comptait une
majorité de la population parlant le
brabançon, une langue proche du flamand
et employée déjà dans les plus hautes
sphères de la société, surtout auprès de la noblesse et de la haute bourgeoisie; mais
Bruxelles abritait aussi une minorité de langue française, car il s'agissait de la langue
du pouvoir : les gouverneurs généraux qui résidaient dans la ville s'exprimaient
uniquement dans cette langue. Les pratiques établies par les Autrichiens firent en
sorte que les Flamands de Bruxelles durent apprendre le français s'ils voulaient
entreprendre une carrière administrative.
L'usage des langues fit en sorte qu'une
minorité riche et francophone cohabitait avec une masse flamande pauvre et peu
alphabétisée. Entre ces deux extrêmes, on trouvait une bourgeoisie commerçante
et urbaine, bilingue. Néanmoins, les mesures
tatillonnes prises par les autorités autrichiennes
à l’instigation de Joseph II heurtèrent de
front, on le devine, les particularismes
locaux, les sentiments religieux, les habitudes linguistiques, etc.
Joseph II dut affronter une levée de boucliers générale. Loin de
réduire les réformes, Joseph II redoubla d'activité, ce qui allait provoquer en
1887 la petite révolution brabançonne.
La politique
de Joseph II suscita un phénomène de rejet, sauf au Hainaut et au
Luxembourg, restés plus calmes. Le
mécontentement de la population fit éclater la Révolution brabançonne (d'octobre
à décembre 1789) et les troupes autrichiennes furent chassées du pays jusqu’en
1793. Cependant, les duchés de Limbourg (actuel «pays de Herve»)
et de Luxembourg, situés de l’autre côté de
la principauté épiscopale de Liège, n’avaient
pas participé à la Révolution brabançonne et soutenaient les Autrichiens qui
revinrent à partir de ces contrées. La rébellion fut réprimée par la force par
les troupes autrichiennes, non seulement dans les Pays-Bas, mais aussi dans la
principauté de Liège. Mais une partie des chefs révolutionnaires
professaient des principes démocratiques analogues à ceux qui étaient, au même
moment, appliqués par la Révolution française.
Cependant, les révolutionnaires décidèrent de passer à l'attaque armée avec
l'aide de la population. Au même moment, Joseph II fut confronté à une guerre
contre les Ottomans. Comme l'empereur n'avait ni la force ni les moyens
d'alimenter deux fronts en même temps, il privilégia l'envoi des troupes contre
les Ottomans. Contre toute attente, l'armée brabançonne des va-nu-pieds eut
raison de l'armée autrichienne. Ainsi, en 1790, les révolutionnaires parviennent
à renverser le pouvoir impérial en Belgique et à chasser l'armée autrichienne
La guerre éclata à
nouveau, mais cette fois avec les révolutionnaires
français et, en 1794, les Français écrasèrent les troupes autrichiennes.
Dès le 11 septembre 1794, l’usage du brabançon qui
s’était répandu dans l’administration centrale des Pays-Bas autrichiens (avec le
français) fut interdit dans l’administration, la justice et
l’enseignement. Après avoir mâté les derniers foyers de résistance en Flandre,
les Français annexèrent officiellement en 1795 les Pays-Bas autrichiens
dans leur ensemble, soit les provinces thioises
et les provinces romanes.
Par un décret spécial, la Convention du 9 vendémiaire an IV
(1er
octobre 1795) déclarait que les territoires des Pays-Bas autrichiens ainsi que
la principauté de Liège, le duché de Bouillon et la principauté de Stavelot,
faisaient désormais partie intégrante de la France. Deux ans plus tard, le
traité de Campo-Formio signait la renonciation de Joseph II à ses Pays-Bas
autrichiens.
Rapidement, les nouveaux dirigeants français se distinguèrent par leur
dirigisme administratif et la vigueur de leurs réformes. Les anciens duchés,
principautés, comtés et seigneuries furent abolis et remplacés par des
départements.
6.1 La départementalisation de la Belgique
|
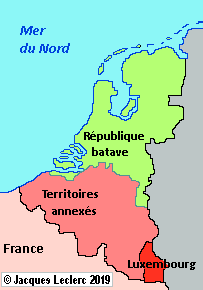 |
Par l'arrêté du 14 fructidor an III (31 août 1795), le Comité de
salut public divisa le territoire des anciens Pays-Bas autrichiens et l'ancienne
principauté de Liège en
neuf départements (voir la carte): la Dyle (Bruxelles), l'Escaut
(Gand), la Lys (Bruges), Jemmapes (Tournai), les Forêts (duché Luxembourg), la Sambre-et-Meuse (Namur), l'Ourthe (Liège), la Meuse-Inférieure (Maastricht) et
les Deux-Nèthes (Anvers). Même si elle ne tenait pas compte des anciennes
principautés, la nouvelle configuration imposée par Paris finit par se mettre en
place. De
plus, par le traité de La Haye (16 mai 1795), on y avait ajouté des
territoires des Provinces-Unies: la Flandre zélandaise (Zeeuws-Vlaanderen), les
pays d’outre-Meuse (de Landen der Overmaze), une partie du Brabant
septentrional, les villes de Maastricht, Montfort, Beersel et Venlo.
En réalité,
les anciennes provinces du Sud furent annexées à la France, tandis que les
provinces du Nord formèrent la «République batave» (Batavie), en théorie
indépendante, mais en réalité sous tutelle
française. Le général Bonaparte avait compris qu'il était devenu impossible de
réunifier les Pays-Bas du Nord (la Bataafse
Republiek) aux Pays-Bas du Sud, tant les habitants étaient
devenus différents par leurs langues et leur religion. La République batave
vécut de 1795 à 1806. Elle fut soutenue par des «patriotes»
hollandais qui avaient appuyé l'intervention française. Rappelons
que le duché de Luxembourg devint le département des Forêts.
La République batave allait être remplacée en
1806 par le royaume de Hollande, dont Louis, le frère de Napoléon,
devint roi. |
6.2 La politique de francisation
Par la loi du 25 octobre
1795, l’Administration française ouvrit une école primaire dans chaque canton
ainsi qu’une école secondaire dans chaque département. Ces établissements
restèrent peu fréquentés en Flandre, car la plupart des élèves étaient des
petits Français ou des fonctionnaires de l’État. L’Université de Louvain fut
abolie le 19 octobre 1797, alors que tous les cours se donnaient en
latin. La francisation des élites flamandes, déjà bien entamée à l’époque
autrichienne, s’accéléra sous le «régime français». Tous les actes publics, dans un délai d'un an,
devaient désormais être rédigés en français. Bonaparte appliqua à la Belgique ce
que le décret du 2
thermidor an II (20 juillet 1794) n'avait pu accomplir: la francisation
massive des couches moyennes dans les «départements du Nord». Comme on peut s’en douter, l’occupation des
forces françaises déplut hautement aux habitants du pays flamand. Dans un
rapport d’un commissaire révolutionnaire français, on pouvait lire: «Tout y
est contre les Français»... surtout en pays flamand où les révoltes
revenaient périodiquement. Les répressions furent terribles en Flandre et des
villages entiers furent massacrés par les Français. Évidemment, la compréhension
du français dans le sud du pays rendit plus simple l'acceptation des des
nouvelles lois et directives des Français, mais ce n'était pas le cas dans le
Nord où le flamand était parlé par l'ensemble de la population.
Par la loi Jourdan-Delbrel du 5 septembre
1798, la France imposa la conscription
dans ses armées dans les territoires conquis. Cette mesure contribua grandement
à la révolte flamande, car elle abolissait l’un des privilèges des Pays-Bas du
Sud, qui prévoyait que Bonaparte ne pouvait recruter des soldats pour l’armée
que par des enrôlements volontaires.
Cette révolte, qui fut appelée «guerre des
paysans», était véritablement une révolte populaire dont les bourgeoisies des
grosses bourgades craignaient elles-mêmes les débordements liés à l’exaspération
des masses paysannes face aux excès du régime français. Les masses refusaient
surtout la conscription, mais aussi l’intolérance religieuse, les impositions et
les véritables spoliations du patrimoine. Cette révolte des paysans fut
particulièrement marquante dans la
Campine (en néerlandais: Kempen),
le Luxembourg et finalement le nord-est de l’actuelle province de Liège (ancien
duché de Limbourg). La révolte était plus marquée dans les cantons thiois ou
germaniques que dans les cantons wallons, mais malgré tout des Wallons firent
partie des insurgés.
6.3 L'hostilité des Flamands
L'hostilité des Flamands pour tout ce qui
était français se développa progressivement. En 1813, le préfet du département de
l’Ourthe, Micoud d’Umons, écrivait dans son rapport que «les peuples qui ne
parlent pas le français sont en général contre nous». Il visait par là les
franges nord-est de son département, à savoir les régions des cantons d’Eupen,
Malmedy, Saint-Vith, Schleiden, Kronenburg, Aubel et Limbourg (y compris les
régions de Montzen-Welkenraedt et des Fourons).
Lorsque Bonaparte devint
premier consul (1800-1804), il obligea tous les
fonctionnaires de la Flandre à être des «citoyens français». Les évêchés subirent des
changements similaires et, graduellement, tout le haut-clergé devint français.
L’archevêque de Malines, Jean-Armand de Roquelaure, eut l’idée d’envoyer
les séminaristes flamands à Lyon et Paris «pour franciser la Belgique en peu
de temps». Cette politique ecclésiastique suscita, on le devine, de nouveaux
mécontentements au sein de la population flamande. Puis Bonaparte devint
Napoléon 1er
(1804-1815). Il transforma la République batave en Royaume de Hollande, dont son
frère Louis devint roi, tandis que les départements du Sud demeurèrent rattachés
à l'empire des Français.
6.4
Intensification de la politique d'assimilation
À partir de 1810, l'empereur Napoléon
appliqua une politique de francisation plus intense. Il voulut arranger des
mariages entre les filles des notables flamands avec des officiers et
fonctionnaires français, puis envoyer les enfants des élites dans les écoles en
France, voire forcer ces familles à s’établir à Paris. Effectivement, la
politique de francisation connut des résultats probants au sein de la
bourgeoisie flamande.
Cette politique ne visait évidemment que les élites wallonnes et
flamandes, et non les gens du
peuple. L'époque française avait duré vingt ans en Belgique; elle avait
favorisé une pénétration plus profonde du français dans la société flamande tout
en amorçant le développement industriel du pays, tant au nord qu'au sud. Par le
fait même, les Français contribuèrent à la formation d'une classe nouvelle,
commune à la Wallonie et à la Flandre, et entièrement francophone: la
bourgeoisie industrielle. C'est cette classe qui allait fonder, quelque vingt
ans plus tard, la Belgique indépendante. Par voie de conséquence, la progression
du français a eu pour effet de rejeter les langues locales, notamment le
flamand, le wallon, le lorrain et le champenois.
En mars 1815, tout le pays fut occupé par les armées de la coalition des
puissances européennes ayant participé au Congrès de Vienne (Russie,
Autriche, Prusse, Grande-Bretagne). Le 22 juin 1815, Napoléon livra la bataille
de Waterloo, alors que les Belges (surtout les Wallons) se battirent tant du
côté français
que du côté des puissances coalisées, mais dans un cas comme dans l'autre ils y
avaient été contraints, la circonscription étant obligatoire. En 1814, Napoléon
fut contraint à l'exil pendant que Louis XVIII montait sur le trône des Bourbons
restauré par les Alliés.
|
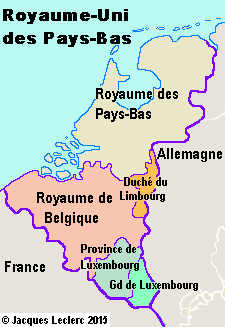 |
Après la défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne (1815) créa le
nouveau Royaume de Belgique connu sous le nom de
«Royaume-Uni des Pays-Bas»
(en néerlandais: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden), c’est-à-dire
la réunion de presque toutes les principautés des Pays-Bas autrichiens, les
Provinces-Unis et les Pays de Généralité (ces derniers administrés par les
Provinces-Unies depuis le traité de Munster). C'était, pour les États européens,
un nouvel État-tampon destiné à faire face à un retour éventuel de
l'expansionnisme français. Les alliés de la Grande-Bretagne créèrent
aussi le Royaume de Sardaigne, qui comprenait le Piémont et la Sardaigne
avec Turin comme capitale, dirigé par la Maison de Savoie, ainsi que le
Royaume de Rhénanie sous tutelle de la Prusse. La France se trouvait
alors contrôlée au nord par la Grande-Bretagne, à l'est par la Prusse et
la Savoie, au sud par la Savoie.
Le royaume
de Belgique fut confié à un roi
hollandais, Guillaume d'Orange, reconnu comme le «roi des Pays-Bas et grand-duc
de Luxembourg». À ce moment-là, le Luxembourg ne faisait pas partie du
royaume, mais constituait un grand-duché membre de la Confédération
germanique. Dès lors, les anciennes provinces belges du Sud firent à nouveau
partie des Pays-Bas unifiés, évidemment sans qu'ils aient été consultés
de quelque manière que ce soit. Les nouveaux sujets de Guillaume Ier d’Orange, surtout la bourgeoisie
francophone, se montrèrent hostiles à la réunion des Pays-Bas du Nord (deux
millions de luthériens) et des
Pays-Bas du Sud (quatre millions de catholiques), alors que le roi voulait faire
du protestantisme la religion d'État. |
Au début, l’Église catholique était favorable à cette union politique, de
même que certains adeptes wallons et flamands de la Révolution française. Mais
les dispositions constitutionnelles reconnaissant l’égalité des religions
choquèrent profondément les évêques catholiques (tous des Français). C’est
surtout au Brabant que le roi pouvait compter sur un nombre assez important
d’adeptes flamands qui étaient fortement influencés par les idées des Lumières.
Bien qu’en général les Flamands n’aimaient pas la Révolution française et ses
excès, ils étaient néanmoins favorables aux idées des grands philosophes
français (Voltaire et les encyclopédistes).
7.1 La concurrence entre le néerlandais et le
français
|
 |
Sur le «front» linguistique, Guillaume Ier
d’Orange, qui parlait le français comme langue maternelle et le
néerlandais comme langue seconde, décida d'intervenir sur la
question linguistique dans les provinces du Sud. En septembre
1819, le roi des Pays-Bas décida d'introduire le néerlandais comme
seule langue officielle des quatre provinces flamandes. En 1822, il
étendit cette politique aux arrondissements de Bruxelles et de
Louvain. de plus, tous les fonctionnaires de
l’administration centrale devaient connaître le néerlandais. Selon
les arrêtés royaux de 1819 et 1822, il était stipulé («[…] qu’il ne
pourrait plus être présenté, pour les places et les emplois publics,
que des personnes ayant la connaissance nécessaire du néerlandais».
Le néerlandais devint donc la langue officielle. Cependant,
la bourgeoisie francisée, l'Église catholique et les Wallons s'y
opposèrent ouvertement. Les francophones
considéraient que leur situation était menacée dans la fonction
publique, alors que, jusqu'alors, seule la connaissance du français
était nécessaire. Quant aux Wallons, ils craignaient d'être
«flamandisés» dans un État néerlandophone. |
Il restait les Flamands, mais même eux éprouvaient des réticences devant le
néerlandais, c’est-à-dire la langue des «Hollandais». En effet, le peuple flamand restait patoisant et illettré; il ignorait le néerlandais
officiel. De plus, les anciens compatriotes hollandais méprisaient cordialement
les Flamands pour leur «façon paysanne» de parler. Bref, la
politique de néerlandisation menée par les fonctionnaires de Guillaume Ier
constituait l'envers de la politique de francisation sous Napoléon! Toutefois,
la mesure orangiste n’excluait point les autres
langues, ni leur emploi dans l’enseignement, dans la justice ou dans l’administration.
N’oublions pas que, comme tous les membres de la Maison royale des Pays-Bas,
Guillaume d’Orange était francophone et que le français restera la langue de
cette famille jusqu’en 1890. L’objectif du souverain était que le néerlandais
devait être employé en Flandre et le français en Wallonie dans l’administration, la
justice et l’éducation. Guillaume d'Orange était convaincu de réussir le
défi d'unir le Nord et le Sud en s'appuyant sur le dynamisme économique,
espérant que la prospérité suffirait.
Cependant, la question linguistique se développa au fil du temps. Le problème
à ce sujet était double dans les provinces du Sud. Il y
avait, d'une part, la concurrence traditionnelle entre le français et le
néerlandais, une conséquence due à la frontière linguistique qui séparait les
langues romanes et les langues germaniques, d'autre part, la nouvelle cassure
entre la multiplicité des dialectes flamands au sud et le néerlandais standard
au nord. En l'absence d'un pouvoir unifié, les différentes langues régionales
continuèrent à prospérer.
Quoi qu'il en soit, le néerlandais devait être inclus dans
l’enseignement dans toutes les écoles du royaume. L’arrêté royal du 15
septembre 1819 prévoyait que le français était la langue officielle de l’administration
et de la justice dans le pays wallon. De fait, sous le règne de Guillaume d’Orange,
les Wallons furent administrés, jugés et instruits en français, alors que la
plupart des Wallons parlaient diverses variétés de wallon, le picard ou le
gaumais (lorrain). Le même
arrêté faisait du néerlandais l’unique langue officielle des provinces de
la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d’Anvers et du Limbourg, mais
le peuple ne parlait que différentes variétés dialectales du néerlandais. La loi
prescrivait une période de transition: du 15 septembre 1819 au 30 décembre
1822, le français pourrait être utilisé au même titre que le néerlandais. En
somme, comparativement à aujourd’hui, nous pourrions considérer la politique
linguistique de Guillaume d’Orange comme très avancée pour son époque.
Entre 1819 et 1822, l’Administration devait adopter le néerlandais
graduellement, mais le français resta la langue dominante, sauf pour la justice
où les changements furent plus marquants. Les écoles flamandes se
développèrent rapidement, mais leur imposition dans les communes mixes de la
frontière linguistique déplut aux francophones. Soulignons que les
frontières provinciales établies par les Français avaient été conservées
intégralement dans leurs limites, mais en leur appliquant les anciens noms
(Brabant, Hainaut, Flandre, Luxembourg, Limbourg), sans se préoccuper du fait
que, par exemple, le chef-lieu de ce dernier se trouvait dans la nouvelle
province de Liège. Dans les communes néerlandophones faisant partie d’une
province francophone ou wallophone (Hainaut et Liège), il était possible de
fonder des écoles néerlandophones à côté des écoles francophones (article 6, no
2, de la loi du 15 septembre 1819).
À partir de 1822, le néerlandais devint
obligatoire pour tous les actes officiels et les débats judiciaires dans toute
l’étendue du royaume, à l’exception des districts wallons. Avec la période
hollandaise, la situation linguistique changea radicalement et le fossé entre le
Nord et le Sud se creusa. Afin de réunir ses deux peuples, Guillaume Ier
voulut imposer l'emploi du néerlandais à tout le pays. Sa décision paraît
d'autant plus surprenante que le souverain parle lui-même couramment le
français, comme la plupart des princes son époque.
Or, sur ce point, la politique royale se heurta à opposition de plus en plus
forte et, contrairement à ce l'on pourrait croire, le rejet ne vint pas
seulement du Sud: en Flandre également, le néerlandais était perçu comme une
langue étrangère, car il était assimilé à un pouvoir lointain et inspirait la
méfiance. De leur côté, très attachés à leurs dialectes locaux, les Flamands
désiraient continuer à les parler, sans oublier que la riche bourgeoisie
flamande préférait employer le français, qui demeurait la véritable langue
internationale de l'époque. Enfin, la ville de Bruxelles était très francisée et
refusait d'adhérer à la politique linguistique du roi de La Haye.
7.2
L'opposition aux politiques centralisatrices
Mais la politique de
Guillaume d'Orange s'accompagna aussi d'une politique de protestantisation. Ce
faisant,
celui-ci se mit à dos tout le clergé catholique et la bourgeoisie flamande
francophile. Les autorités ecclésiastiques (aussi peu
néerlandophones qu’intolérantes face à un roi «hérétique protestant») et les
élites belges (composées de la bourgeoisie francophone, de la caste des
fonctionnaires et des avocats, ainsi que des Flamands francisés) s’opposèrent
aux politiques centralisatrices de Guillaume d’Orange, au surplus un
anticlérical de religion protestante. Ses opposants lui reprochaient surtout son
parti-pris ultralibéral et libre-échangiste, et sa politique linguistique
d’imposition du néerlandais comme seule langue officielle dans les régions
flamandes (incluant Bruxelles). En Belgique flamande, cette langue était appelée
le «hollandais» pour la différencier du flamand dont se revendiquait une
majorité de Flamands qui considéraient la langue néerlandaise comme étrangère.
Seul Jean-François Willems (ou plutôt Jan Frans
Willems, en néerlandais), un homme de lettre considéré comme le père du
mouvement flamand, prôna l’usage du
«néerlandais» officiel de la Hollande. Tout ce beau monde ne voulait en aucun
cas du néerlandais dans les tribunaux, l’administration et les écoles. Qui qu'il
en soit, la tentative de Guillaume d'Orange d'instaurer un État laïc,
néerlandophone et inspiré d'un modernisme calviniste ne pouvait qu'échouer. Le
Révolution belge de 1830 fut en grande partie le résultat d'une alliance de tous
les opposants au roi hollandais.
Ce sont
en partie ces circonstances qui amenèrent la création de la Belgique et qui
furent à l’origine du premier des «compromis» entre les bourgeoisies wallonne et
flamande, c’est-à-dire l’élite catholique conservatrice (noblesse et clergé) et
la bourgeoisie francophone libérale adepte des Lumières. Beaucoup de Flamands du
XIXe siècle, gênés par
l’union catholique-libérale scellée en 1828 appelleront ainsi cette union entre
catholiques et libéraux «het monsterverbond», c’est-à-dire l’«union
monstrueuse». Force est de constater que, pourtant la révolution de
1830 a réussi uniquement parce que le
bas-clergé, tant en Flandre qu’en Wallonie, a soutenu la défiance du haut
clergé, de la bourgeoisie et de la noblesse à l’égard du roi de Hollande. Seuls
les milieux économiques craignaient la séparation par la perte des marchés
qu’elle générerait. Toutes les conditions étaient réunies pour amener une
révolte, mais le roi des »Pays-Bas ne l'a pas vu venir.
7.3 La révolte contre Guillaume Ier
Peu de temps après
l’annonce d’une révolution en France (juillet 1830), mais sans lien réel avec
elle, la «révolte belge» débuta à Bruxelles, le 25 août suivant.
Bruxelles tomba aux mains de la bourgeoisie et de la garde bourgeoise. Puis les
événements de Bruxelles se répandirent à Louvain, à Ath, à Wavre, à Liège, à
Verviers, à Mons, à Gand, à Bruges, à Courtrai et même à Aix-la-Chapelle
(Allemagne). Dans toutes ces régions, ce sont les masses populaires qui se
livrèrent au pillage. L’agitation reprit dans le pays, de Bruxelles à
Liège, Huy, Mons, Namur Louvain et même au Luxembourg. Les états généraux ne
firent que ratifier la victoire des émeutiers, car le roi avait fait masser ses
troupes au parc de Bruxelles. Puis ce furent les «journées de septembre» : des
bandes armées venues de Wallonie (Liège surtout), mais aussi de Flandre avec
souvent les curés à leur tête, voulaient déloger les Hollandais. Les différentes
unités de l’armée hollandaise furent attaquées le long des routes du Brabant
flamand. Chaque ville organisa une garde civile et des renforts de France
arrivèrent dans toutes les provinces tant flamandes que wallonnes. Guillaume
d'Orange dut se replier sur Anvers, avant de se résigner à retourner en Hollande
après avoir constaté que la population anversoise devenait menaçante et que la
garde civile fraternisait avec le peuple.
S'il a paru nécessaire de
reprendre avec certains détails les événements de 1830, c’est pour montrer que
la révolution était bel et bien le fait de tout le pays, et non seulement celui
des Wallons ou des francophones soutenus par la France, du moins tel que
certains Flamands le soutiennent aujourd'hui en affirmant que cette révolution
avait entraîné malgré eux les Flamands dans la tourmente. Ces mêmes Flamands tentent d’expliquer l’absence d’implication des
Flamands dans la révolution. Or, la ville flamande de Gand prit une part active
dans la première phase de la révolution, mais les autorités locales réussirent
mieux que d’autres à encadrer les émeutes populaires qui dégénéraient vite
ailleurs en pillage. Il est dit aussi que la «libération» d'Anvers correspondait
à une «conquête» organisée par des «bandes françaises et wallonnes» perçues
comme «une bande de brigands». Pourtant, c’est la crainte de la population
anversoise, nettement portée pour les révolutionnaires belges, qui incita le
prince d’Orange à quitter la ville. Enfin, des
Flamands affirment que la Flandre a été conquise manu militari, à partir
de Bruxelles, par des «bandes wallonnes dirigées par des généraux français».
Mais les Belges ne
disposaient pas de troupes organisées, ni encore moins de généraux capables de
mener les opérations. C’est la raison pour laquelle ils firent appel à des
troupes expérimentées, dont celle du vicomte de Pontécoulant, plutôt que de
confier la conquête du territoire à des bandes inexpérimentées.
Le 4 octobre 1830, un gouvernement provisoire formé de
catholiques et de libéraux proclama l’indépendance de la Belgique.
Le 4 novembre de la même année, l'Autriche, la France, la
Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie reconnurent le nouvel État (sauf les
Pays-Bas).
|
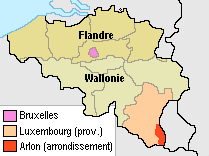 |
Le Traité des XXIV articles (15 novembre 1831) réglait la question des
limites territoriales. Ainsi, la Belgique renonçait définitivement à la Flandre zélandaise
et au Brabant septentrional, mais aussi au Limbourg oriental (en raison de la
position stratégique: contrôle de la Meuse et les bouches de l’Escaut) et la
ville de Maastricht. En retour, le nouvel État recevait la portion wallonne du
grand-duché de Luxembourg et la région germanophone d’Arlon. Les autres
régions germanophones étaient attribuées à Guillaume Ier à titre personnel et
continuaient (avec le Limbourg néerlandais, mais sans la ville de Maastricht)
à faire partie de la Confédération germanique. |
La ville de Baarle restait divisée en une
partie néerlandaise (Baarle-Nassau) et une partie belge (Baarle-Hertog), qui
constitue jusqu’à nos jours une enclave; sur le terrain, il s’agit en fait de 32
enclaves belges dans le territoire néerlandais et de 16 enclaves néerlandaises
parmi les 32 enclaves belges. Le roi Guillaume Ier
a longtemps refusé d’y adhérer.
Ce ne sera qu’en 1839 que le Traité des XXIV articles sera ratifié et entrera en
vigueur. Il est clair que les frontières finales de la Belgique ne furent que le
fruit de la concertation entre les grandes puissances et qu’elles ne
sanctionnaient pas toutes des frontières ethniques ou linguistiques.
|
 |
Léopold Ier
de Saxe-Cobourg-Gotha, un prince allemand protégé par les Russes et devenu
altesse anglaise par son mariage, fut choisi comme souverain pour la
Belgique. Le
21 juillet
1831, Léopold Ier
prêta serment en français en tant que «roi des Belges» et non pas «roi de Belgique». Le 3 février 1831, les Français et les Wallons
avaient bien tenté d'imposer comme souverain le deuxième fils du roi
de France, le duc de Nemours, mais les grandes puissances, surtout
la Grande-Bretagne, s'y étaient opposés fermement.
Le 9 août 1832, il épousa Louise d'Orléans, la fille du «roi des
Français», Louis-Philippe. Bien que le nouveau roi soit de religion
protestante dans un pays catholique, il acceptait d'épouser une
princesse française catholique, ce qui le rendait acceptable pour
les libéraux et les catholiques.
Ce n'est qu'en 1838 que Guillaume
d'Orange finit par reconnaître la Belgique. |
À cette époque, peu
d'observateurs croyaient à l'existence de cette Belgique unitaire mais formée de
deux peuples. Ainsi, le grand négociateur Charles-Maurice de Talleyrand,
qui avait tiré les ficelles du Congrès de Vienne en 1815, doutait en 1832 de la
capacité des Belges de former une nation :
|
Les Belges ? Ils ne dureront pas. Ce n’est pas une nation, deux
cents protocoles n'en feront jamais une nation. Cette Belgique ne
sera jamais un pays, cela ne peut tenir. |
Léopold Ier,
qui prêta le serment constitutionnel le 21 juillet 1831, partageait l'opinion de
la pluparts diplomates de son temps, lesquels estimaient que la nouvelle
Belgique était une construction artificielle. En 1859, le roi allait écrire à
son chef de cabinet Jules Van Praet: «La Belgique n'a pas de nationalité et, vu
le caractère de ses habitants, ne pourra jamais en avoir. En fait, la Belgique
n'a aucune raison politique d'exister.» À son plus jeune fils, Philippe, comte
de Flandre, il écrira que rien ne soude le pays et que cela ne saurait durer.
|
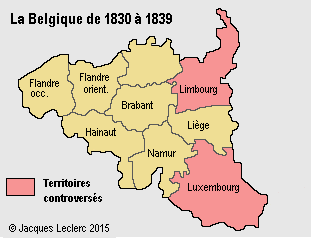 |
Dès sa création jusqu'en 1995, la Belgique a
conservé la structure territoriale héritée des régimes français et
hollandais en neuf provinces : Brabant, Anvers, Flandre-Orientale,
Flandre-Occidentale, Limbourg, Hainaut, Liège, Namur et Luxembourg.
De 1830 à 1839, les anciennes frontières de la Belgique comprenaient
l'actuel grand-duché de Luxembourg et l'actuel Limbourg néerlandais.
Ces provinces, qui ont dans l'Histoire battu pavillon bourguignon,
espagnol, autrichien, français et hollandais, comprennent des
communes qui demeurent un échelon essentiel de la vie politique du
royaume.
Mais le traité des
XXIV
articles de 1839 reconnut l'indépendance du grand-duché du
Luxembourg au sud et accordait le Limbourg aux Pays-Bas. Le traité
faisait aussi de la Belgique un État perpétuellement neutre garanti
par l'Autriche, la France, le Royaume-Uni, la Prusse et la Russie.
|
8.1 La question linguistique
À cette époque, les langues en présence
étaient d'abord les parlers locaux, puis le français et le néerlandais. La
majorité de la population belge avait comme langue maternelle son parler local,
à savoir, d’ouest en est et du nord au sud, le west-flandrien, le flamand, le brabançon,
le limbourgeois, le picard, le wallon, le francique rhéno-mosan (carolingien), le champenois,
le lorrain ou gaumais, ainsi que le francique mosellan luxembourgeois.
|
Pour les parlers
romans (d'est en ouest) |
- les parlers picards au
nord-ouest dans une grande partie du
Hainaut;
- les parlers wallons:
wallo-picard ou wallon de l’Ouest (du nord au sud, en
passant par le Brabant wallon,
le
Hainaut et le
Namur), le wallon
namurois (tout le reste du Namur), le wallon liégois
ou wallon de l’Est (province de
Liège), le
wallon-lorrain ou wallon du Sud (nord de la
province du Luxembourg);
- le champenois au sud-est
du
Namur;
- le gaumais (ou
lorrain) tout au sud de la
province de
province du Luxembourg
(région de Virton);
|
|
Pour les parlers
germaniques (du nord au sud) |
- les parlers limbourgeois-carolingiens
au nord-est dans la
province de Liège (Aubel, Plombières, Welkenraedt, Baelen;
Kelmis, Lontzen, Eupen);
- les parlers (franciques) ripuaires
au nord-est : Raeren,
Bütgenbach et
Büllingen;
-
les
parlers franciques mosellans
(ou luxembourgeois) dans les
provinces de Liège
(Sankt-Vikt; Burg-Reuland) et de
Luxembourg (Beho/Bocholz
et la région d'Arlon);
-
les
parlers flamands: une
minorité de la population au
nord de la province du
Hainaut
(Comines-Warneton et Mouscron);
- le
parler brabançon : une
minorité au nord du
Hainaut
(Enghien).
|
Il faut préciser que la plupart de ces
parlers, tant romans que germaniques, n'étaient pas encore fixés et qu'il
existait de grandes différences phonétiques et lexicales entre les variétés
dialectales locales. Il en allait ainsi pour le wallon en Wallonie et le flamand
en Flandre, fragmentés en de nombreuses variétés locales. De façon générale, ces
parlers étaient méprisés au profit d'une langue véhiculaire nationale
internationale: le français.
En Flandre, parlers régionaux tinrent tête au néerlandais et
profitèrent du fait que ces différents parlers n’étaient pas combattus mais
ignorés. Cela leur permit d’occuper presque entièrement le discours oral, tout
en étant ignoré de la langue écrite qui se développait avec les progrès de
l’instruction, laquelle ne deviendra obligatoire qu’en 1914. Dès lors, les progrès du
néerlandais demeurèrent néanmoins assez lents. Or, seul
le néerlandais écrit pouvait tenir tête au français, mais il était ignoré en
grande partie par la population flamande.
La ville de Bruxelles, quant à elle,
constituait un cas à part, car elle comptait à ce moment-là environ 15 % de
francophones. Il s’agissait, comme dans toutes les autres villes de Flandre, des
classes aisées de la population autochtone et d’une petite minorité de Français
immigrés dans la ville.
- Le néerlandais
Le néerlandais était d'abord la langue des
Pays-Bas et évoquait encore vivement l'ennemi orangiste. Beaucoup de Belges s'opposaient à son emploi, même au
sein des populations flamandes pourtant plus familières avec le néerlandais en
raison de la proximité linguistique des langues. Les Flamands de Belgique ne voulaient pas du «hollandais»,
un terme
courant pour désigner le néerlandais, pour deux raisons principales : d'une part,
cette langue avait été imposée jadis par Guillaume Ier,
d'autre part, c'était la langue des réformés protestants.
En fait, la langue néerlandaise avait subi au XVIIe
siècle des apports brabançons (de marchands fuyant les répressions espagnoles),
mais cet apport restait cantonné à la langue écrite. Même dans les
Provinces-Unies ainsi que dans la République batave, les députés issus des
différentes provinces avaient considéré ce «hollandais» comme le «parler d’Amsterdam».
Durant la période 1815-1830, la langue hollandaise était ressentie par le clergé
belge (le haut et aussi le bas-clergé) comme un vecteur d’expansion du
calvinisme.
En somme, peu d'individus étaient prêts à défendre le néerlandais en
Belgique, sauf Jean-François Willems (1793-1846), considéré aujourd'hui
comme le père du mouvement flamand. Celui-ci œuvra
vraiment pour l’adoption du «néerlandais» (en fait, le «hollandais») comme langue
uniformisée à la place des différents parlers locaux du nord de la Belgique. J.-F.
Willems et le chanoine Jan Baptist David obtinrent du gouvernement en 1839 la
création d’une commission qui aurait pour option, d'une part, de s’aligner sur
la réforme de Siegenbeek, l'un des
auteurs d'un dictionnaire, adopté par les Hollandais, d'autre part, de créer en Flandre,
sur la base des dialectes en usage, une forme de langue autonome. Les deux
instigateurs de la commission obtinrent l’alignement sur la forme
linguistique de Siegebeek. Ce fut un beau tollé! On brandit l’épouvantail de l’orangisme,
mais la cause était entendue, et la nouvelle réforme de l’orthographe fut
adoptée officiellement en 1841 pour la version flamande du Bulletin des lois
et arrêtés et, en1864, pour l’enseignement. Le premier
dictionnaire néerlandais, le Dikke Van Dale
ou plus précisément le
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal
(«Le Grand Dictionnaire Van Dale de langue néerlandaise») date de 1864 (avec
l'orthographe de Matthias de Vries).
- Le français
Au moment de la création de l'État belge en 1830, la première Constitution avait prévu un
État unitaire, sans langue officielle reconnue; elle
prévoyait aussi un État central fort afin de
combattre les particularismes et renforcer l'unité du pays. L'article 23 se lisait
comme suit:
|
Article 23
(1830)
L'emploi des langues est
facultatif en Belgique, il ne peut être réglé que par la loi et seulement
pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. |
Or, le français était perçu, à tort ou à
raison, par les élites dirigeantes comme un facteur d’unité nationale et un
facteur d’indépendance vis-à-vis des Pays-Bas. Le français avait l'avantage
d'être la langue véhiculaire au niveau international et jouissait d’un grand
prestige en tant que «langue des Lumières et de la Civilisation». Quant à
l’élite belge, qui utilisait le français dans toutes les villes du Nord et du
Sud et dont une partie était toute pleine d’admiration pour la France, le choix
du français paraissait comme aller de soi.
Pourtant, le français était loin d'être la langue majoritaire dans le
royaume. Cette langue n'était même pas couramment parlée par le souverain, qui
s'exprimait d'abord en allemand, puis en anglais et ensuite en français! Mais
cette langue était la seule reconnue partout en Belgique : qu'il s'agisse de
l'armée, de la justice ou de l'administration, le français était indispensable
pour mener une carrière en Belgique. En revanche, les citoyens avaient le droit
de s'adresser à l'administration dans leur langue, à la condition que les
fonctionnaires la comprennent.
L'Arrêté du gouvernement provisoire du 16
novembre 1830 précisait que le
bulletin officiel des lois et des actes du gouvernement devait être publié en
français (art. 1er), qu'une traduction
flamande des lois et des actes du gouvernement seraient disponibles dans les
provinces où la langue flamande est en usage parmi les habitants (art. 2), que
les publications par affichage seraient également accompagnées d’une traduction
en langue flamande ou allemande, selon les localités (art. 4), que les citoyens
dans leurs rapports avec l’administration étaient autorisés à se servir
indifféremment de la langue française, flamande ou allemande (art. 5) et qu'il
en était ainsi dans les tribunaux (art. 5).
Autrement dit, l'arrêté de 1830 laissait croire à un certain bilinguisme,
bien que plutôt déséquilibré au profit du français.
Dans les faits, le français fut utilisé comme la
seule langue officielle avec le résultat que le processus de francisation
allait se poursuivre tout au long du XIXe
siècle, notamment dans les grandes villes comme Gand, Anvers et Bruxelles.
Au lendemain de l'indépendance, les
écoles, les administrations gouvernementales et municipales, les tribunaux,
etc., n'utilisèrent que le français dans les actes officiels, et délaissèrent le
néerlandais dès lors déclassé comme «hollandais». La langue française était
celle des classes dominantes, tant chez les Flamands que chez les Wallons.
L'aristocratie et la bourgeoisie parlaient donc français, tandis que le peuple
parlait flamand ou wallon, brabançon ou les divers autres parlers locaux. Avant
l'indépendance, en 1821, le conseil communal de Bruxelles avait même demandé à
Guillaume d'Orange que la rédaction des documents officiels en néerlandais soit
accompagnée d'une version française, car le néerlandais écrit n'était pas
compris en Flandre! Cela n’avait rien de surprenant, puisque la grande majorité
des masses populaires dans le pays thiois comme d’ailleurs dans le pays wallon,
ou dans quelque région que ce soit, avait besoin de traductions dans les parler
locaux pour comprendre les documents administratifs ou judiciaires.
- Les premières revendications flamandes
Dans ces conditions, les défenseurs du flamand, qualifiés de «flamingants,
prirent conscience qu'il leur fallait avant tout unifier leurs variétés
dialectales s'ils voulaient faire respecter le flamand. En 1838, un écrivain
flamand d'origine française, Hendrik Conscience (1812-1883) publia un roman
historique: De Leeuw Van Vlaanderen (en français: Le Lion des Flandres).
Dans l'édition originale, le roman était précédé d'une sorte de rapport ou
d'état des lieux des Flamands au XIXe
siècle. L'œuvre remporta un vif succès et, sous son impulsion, il ne parut plus
ridicule d'écrire en flamand. Malgré tout, il existait de nombreuses réticences
à l'unification linguistique du flamand, au sein même des provinces flamandes.
Nombreux étaient ceux qui s'opposaient à une néerlandisation de la langue.
En 1845, Hendrik Conscience fut fait chevalier de l'ordre de Léopold. Le 6
novembre 1847, un «Manifeste» du mouvement flamand fut publié. Dès les premières
phrases, le constat était ainsi posé :
|
La Belgique se trouve dans une
situation artificielle qui, sans aucun doute, constitue une menace
constante pour l'existence même de la patrie. La majorité de la
nation est dominée par l'autre partie, minoritaire. Bien que cette
domination ne doive pas être considérée comme intentionnelle de la
part de l'autorité et de nos compatriotes wallons, elle est
néanmoins un fait.
En
francisant tout et en éliminant les Flamands des administrations et
même des institutions d'enseignement, les sources vives de la
science et de la civilisation flamandes ont été taries. Dans la
progression des siècles, le peuple flamand a été condamné à rester à
la traîne. |
Bien que le texte soit revendicatif, il ne reflétait pas encore ce que
pensait la majorité de la population en Flandre. La Belgique indépendante
poursuivait le mouvement déjà engagé par la préséance du française en réaction à
l'impopulaire union avec les Pays-Bas. Néanmoins, la longue reconnaissance de
l'identité flamande au sein du royaume de Belgique était désormais en marche et
plus rien ne pouvait l'arrêter. Cette langue maternelle du peuple flamand,
la moedertaal
(«langue maternelle»), allait prendre le devant de la scène politique.
8.2 La Révolution belge
Les militants de la moedertaal
parmi les Flamands comprirent bien vite qu’ils s’étaient
fait avoir (sans que cela ait été volontairement délibéré par qui que ce soit)
lors de la «Révolution belge» et que cette nouvelle Belgique de langue
française les privaient de tous leurs droits linguistiques acquis lors du
régime de Guillaume d’Orange. En fait ils se rendirent compte que, en supprimant
le «hollandais», langue de l’ennemi bouté dehors, ils s’étaient privés d’une
langue, certes non comprise par la grande majorité des habitants du nord du
pays, mais au moins appartenant à la même famille linguistique et avec un
certain nombre de ressemblances permettant une compréhension plus aisée que la
langue française qui n’avait aucune ressemblance avec la moedertaal.
Quant
aux Wallons et aux Picards, qui ne percevaient pas non plus toutes les nuances
du français, ils avaient au moins l'avantage de comprendre plus facilement cette langue,
par l’analogie ou la ressemblance de différents mots wallons ou picards avec les
équivalents français. Même le grand leader du Mouvement wallon,
Jules Destrée, n’avait pas de difficulté à admettre l’injustice commis
envers les Flamands:
|
Sans doute, il n’y avait dans le fait que la
législation fut officiellement française qu’un inconvénient bien léger
pour les Flamands. Mais ce fait correspondait à d’autres, infiniment moins
acceptables: l’enseignement, la justice, l’administration étaient en pays
flamand exclusivement français (Lettre au roi sur la séparation de la
Wallonie et de la Flandre, 1912). |
Il n’est donc pas surprenant que, au fil du
temps et face aux lentes progressions de la cause flamande, la Révolution belge
ait été progressivement considérée jusqu’à nos jours comme une «catastrophe»
dans l’histoire de la Flandre et, au contraire, presque comme un «bienfait» en
Wallonie.
Dans les régions où les
révolutionnaires réussirent à prendre le pouvoir, le néerlandais fut aussitôt
remplacé par le français comme langue écrite.
Dès la création de la
Belgique, Charles Rogier (1800-1885), alors premier ministre, écrivait à son ministre de la
Justice, Jean-Joseph Raikem, en 1832: «Les efforts de notre gouvernement
doivent tendre à la destruction de la langue flamande pour préparer la
fusion de la Belgique avec notre plus grande patrie, la France.» Il
y a lieu de se rappeler que, au moment de la révolution, Charles Rogier
portait l’étiquette de «jacobin» et, comme bon nombre de révolutionnaires
originaires de Liège, il était un francophile avéré.
Et, dans une lettre à Lord Palmerston, Charles Rogier aurait écrit encore :
|
Les premiers principes d’une bonne administration sont basés sur l’emploi
exclusif d’une langue, et il est évident que la seule langue des Belges doit
être le français. Pour arriver à ce résultat, il est nécessaire que toutes
les fonctions civiles et militaires soient confiées à des Wallons et à des
Luxembourgeois; de cette manière, les Flamands, privés temporairement des
avantages attachés à ces emplois, seront contraints d’apprendre le
français, et l’on détruira ainsi à peu l’élément germanique en
Belgique.
|
Mais l'existence même de ces lettres semble incertaine.
La suppression de
l'élément néerlandais de la Belgique était perçue à cette époque comme «une mission
civilisatrice» véhiculée par les élites intellectuelles de tout le pays, wallonnes comme
flamandes, ainsi que par la classe bourgeoise, également dans l’ensemble du pays.
La langue française devait devenir la langue unitaire «patriotique» de la
nouvelle Belgique. Quant au peuple flamand, il n’avait, pas plus que le peuple
wallon, voix au chapitre, car la nouvelle Belgique s’était dotée du suffrage
censitaire (lié à l’impôt payé), ce qui impliquait que seuls les bourgeois
payaient le cens et, comme la bourgeoisie était francisée dans l’ensemble du
pays, cette situation ne lui posait nullement problème, alors que la masse
flamande (comme wallonne) était niée dans son identité. Les militants
flamingants considérèrent par la suite que la Flandre était victime d'une
«colonisation éhontée» par la Belgique
francophone. Elle l’était assurément, non pas par la «Belgique», mais par la
bourgeoisie francophone.
Vers 1860, les «flamingants» relevèrent la tête et
furent soutenus avec vigueur par le poète Guido Gezelle (1830-1899) qui proclama avec une
conviction passionnée la supériorité du west-vlaams (flamand occidental)
sur les autres variétés flamandes. Ce
furent surtout les régions périphériques (la Flandre occidentale et le Limbourg) qui
résistèrent le plus longtemps à l’introduction de la langue uniformisée, car
elle se distinguait nettement de celle qui y était parlée qu’à Gand ou au
Brabant.
8.3 La politique
d'assimilation
Les nouveaux dirigeants pratiquèrent une
politique d’assimilation aux dépens des Flamands, mais elle était surtout le
fait des francophones de Bruxelles constituant l’élite intellectuelle de la
capitale et provenant pour l’essentiel de la bourgeoisie locale francisée depuis
plusieurs générations. Un autre notable, le baron de Stockmar (1787-1863), l’un
des proches du roi Léopold Ier, croyait
nécessaire d’encourager cette politique linguistique dont l'objectif ultime
était l’unité de la nation belge: «Répandre l’usage du français, c’est
consolider la nation belge et renforcer la cohésion interne du pays.»
Évidemment, les tenants du mouvement flamand virent les événements d’un autre
œil. C'est pourquoi l’écrivain flamand H. Meert affirmait de son côté:
|
Après 1830, on a voulu extirper la nationalité
flamande. Notre langue fut proscrite comme langue officielle; elle fut bannie de
l’armée, bannie de la justice, bannie de l’administration, et un régime de
francisation à outrance fut inauguré. Notre instruction, entièrement
francisée, devait faire de nous des… Belges, ce qui n’était autre chose
que des caricatures des Wallons. On commettait un crime contre nature. (Antwoord
, 1912)
|
Il est vrai que, pour l’élite de cette
époque, la langue des Flamands n’avait aucune valeur. Pour cette élite, tant
de la part des villes de Flandre que de Wallonie, le néerlandais était
considéré comme «un patois enfantin et grossier, bon tout au plus à servir de
véhicule aux idées rudimentaires de l’anthropopithèque primitif» (cf. Albert du
Bois, cité dans Antwoord, p. 36).
- La francophilie
Le 5 juin 1832, le roi
Léopold Ier proclama
le franc comme monnaie officielle de la Belgique. Tout jeune État indépendant
des Pays-Bas voisins, la Belgique francophile choisissait ainsi de calquer son
système monétaire sur le système français.
Le
français est devenu la seule langue officielle de l'administration, de la
justice, de l'armée, de l'enseignement moyen et de l'enseignement supérieur.
Les avocats
qui désiraient utiliser le néerlandais dans les tribunaux étaient poursuivis et
condamnés; il en était ainsi des citoyens qui osaient se révolter.
Toutefois, il
y avait dans cette démarche une certaine logique de la part d’une
bourgeoisie francisée dans toutes les villes du pays, laquelle voulait se
démarquer au maximum du «hollandais». Ce mouvement n'existait pas dans les
régions rurales, même wallonnes. Quant au choix du franc et d’autres mesures
prenant l’apparence d’une francophilie, elles étaient influencées par le courant
francophile présent dans l’élite politique au pouvoir où des personnalités
telles Rogier, Gendebien et plusieurs autres étaient ouvertement francophiles,
et ne cachaient pas qu'ils désiraient préparer le pays à un passage «en douceur»
vers la France.
- La
guerre linguistique
En somme, cette situation constitutionnelle
avancée par les francophones de Bruxelles s’est immédiatement révélée inadaptée
aux aspirations du mouvement flamand naissant, du fait qu’on ne prévoyait qu'une
seule langue officielle, le français. Les querelles linguistiques avaient
commencé dès 1831. Les Flamands protestèrent contre l’unilinguisme de l’État
belge et «ceux qui veulent bannir la langue du peuple». Apparurent toutes sortes
d’associations flamandes, souvent très militantes, parfois de tendance orangiste
(pro-néerlandaise). On s’en prenait tantôt aux fonctionnaires unilingues
francophones, tantôt à l’affichage unilingue, tantôt aux écoles... Bref, le
mouvement flamand commençait tôt!
À partir de 1840, on pouvait déjà parler en
Belgique de «guerre linguistique», surtout à cause des écoles. Ce fut le temps
des pétitions, des congrès littéraires néerlandais, l’alignement sur la réforme
de Siegebeek (le «néerlandais de Hollande»), plutôt que la création d’une langue
flamande spécifique. De nos jours les Flamands présentent cette décision de la
commission créée par le gouvernement belge comme la confirmation de l’unité de
la langue, mais à l’époque il s’agissait de choisir entre deux options
fondamentales: opter pour la langue de l’ancien «ennemi» ou en créer une sur la
base des particularités des quatre langues du pays flamand (1844). On peut, par
ailleurs, s’interroger sur l’évolution qu’aurait connue
la Belgique si la commission administrative
avait choisi à l’époque une langue flamande particulière, indépendante de la
langue hollandaise. Pour autant que l’apport entre les quatre langues endogènes
de Flandre ait été équilibré, il est fort probable que les progrès du mouvement
flamand – qui furent très lents au XIXe
siècle – auraient été bien plus rapides, car l’adhésion de la population
dans une langue où elle aurait reconnu bon nombre d’éléments locaux aurait été
plus facile.
Devant pareille option, la bourgeoisie francophone n’aurait
pratiquement pas eu d’autre alternative que de proposer dans chaque province de
Flandre une certaine forme de bilinguisme variable de province à province,
franco-west-flandrien, franco-flamand, franco-brabançon, franco-limbourgeois et,
parallèlement en Wallonie franco-wallonne, franco-francique,
franco-luxembourgeoise, etc. Une telle mesure aurait pu constituer pour les
masses flamandes et wallonnes une forme de reconnaissance de leur parler local,
suffisante pour ne revendiquer ni un flamand uniformisé ni un recours au
néerlandais d’outre-Moerdijk (Hollande). Cela aurait probablement permis un
système assez harmonieux d’équilibre entre les langues réellement parlées à
l’époque, comme au grand-duché de Luxembourg, donc une tournure totalement
différente du contentieux linguistique belge.
-
Incompréhension totale à l'égard du mouvement flamand
En 1845, l’atmosphère devint très lourde et
les critiques visaient surtout les Flamands francisés et francophiles, qui
furent désormais déclarés «les plus grands ennemis du peuple flamand». Pendant
cette période cruciale, l'incompréhension de la bourgeoisie francophone et celle
des Wallons en général à l'égard du mouvement flamand était restée totale. Le
Liégeois Charles-François Soudain de Niederwerth (1802-1858) semble
représentatif de ce courant de pensée (Du flamand, du wallon et du français
en Belgique, 1857):
|
Personne ne parviendra à nous
convaincre qu'une langue qui s'est arrêtée au XVe siècle
convienne à la société actuelle. Elle peut, à la rigueur, suffire à
l'expression des sentiments naïfs, des idées primitives, et à la peinture
des images simples et naturelles qui sont des éléments de la poésie et du
roman; elle peut fournir encore un certain contingent de phrases
familières, de même que le patois wallon, à la composition des chansons,
des ballades, des complaintes et des pièces destinées aux petits théâtres,
parce que que ces gens admettent des dictions vulgaires et triviales que
les convenances et le goût excluent de la littérature sérieuse et de la
bonne société; mais quelle ne sera pas l'insuffisance de cette langue,
lorsqu'il s'agira de la nomenclature immense des mots nécessaires à
l'explication technique des doctrines, des sciences, des arts compliqués,
répandus aujourd'hui dans le monde. |
Pendant ce temps, le mot
«Wallonie» était employé pour la première fois en 1844 par le linguiste belge Charles Marie Joseph Grandgagnage (1812-1878) ;
il fut repris en 1886 par l'écrivain Albert Mockel (1866-1945), qui le donna pour titre à la revue
qu'il fonda alors en réaction contre La Jeune Belgique. Plus tard, le
même Albert Mockel fera figure de pionnier du mouvement wallon lorsqu'il
lancera, en avril 1897, dans un article publié dans Le Mercure de France,
la formule «La Wallonie aux Wallons, la Flandre aux Flamands et Bruxelles aux
Belges.»
Finalement, la loi du 1er juin 1850 sur
l'enseignement moyen imposa l'obligation, dans son article 22 (chapitre II), de
la deuxième langue du pays en Flandre:
|
Article 22
L'étude de la langue
française, ainsi que de la langue flamande ou allemande, pour les parties
du pays où ces deux langues sont en usage. |
C'est le ministre libéral Charles Rogier
qui fit adopter cette loi, alors qu'il n'était pas particulièrement partisan de la cause
flamande. Cela dit, la base de l'enseignement resta le français, du moins si
l'on en croit un rapport de l'inspecteur de l'enseignement en Flandre (1860):
«Certes, il serait difficile, d'après les idées dominantes, de prendre dans nos
provinces flamandes comme cela se pratique en Hollande, la langue néerlandaise
pour base de l'enseignement.» C'est à partir de ce moment que débuta la
réflexion flamande sur la possibilité pour la Belgique d'abriter deux nations et
deux langues!
8.4 La radicalisation
du mouvement
flamand
En Belgique, l'intransigeance de l'establishment
francophone et l'indifférence de l'opinion publique wallonne eurent pour effet
de modifier radicalement l'orientation du mouvement flamand. Ses membres les
plus actifs, ardents patriotes belges jusque là, se considérèrent d'abord comme
flamands avant d'être belges. Sans vouloir mettre fin à l'État belge, les
tenants du mouvement flamand
voulaient néanmoins que cessent les mesures discriminatoires à leur
endroit. Ils demandèrent de rétablir l'égalité entre Wallons et Flamands.
En 1860, on entendit pour la première fois
(et répété jusqu’à nos jours) le cri de «Of België met onze rechten, of onze
rechten zonder België», c’est-à-dire «la Belgique avec des droits pour nous, ou
nos droits sans la Belgique». Il faut dire aussi que la peur de l'annexion de la
Belgique par la France donnait une nouvelle impulsion au mouvement flamand.
Dorénavant, les Flamands allaient réclamer un unilinguisme absolu en Flandre, sans
aucune concession au bilinguisme. Au cours des années 1850, la langue écrite des
Flamands fut enfin uniformisée sur le modèle de l'orthographe hollandaise. Le flamand
écrit devint donc officiellement le néerlandais! Plusieurs accords
réunissant des Flamands et des Hollandais permirent l'établissement d'un
dictionnaire de la langue néerlandaise.
En Belgique, le néerlandais
continua néanmoins d'être une langue de seconde zone. D'après le recensement de 1846, le
néerlandais était parlé par 2,4 millions de citoyens belges (env. 57 %), le français
par seulement 1,8 million (env. 42 %). Le français était donc une langue
numériquement minoritaire, mais fonctionnellement majoritaire puisqu'il était
parlé par les élites intellectuelles de tout le pays et, surtout, par les seuls
qui payaient le cens (ce qui octroyait le droit de vote).
- Les premières lois
linguistiques
|
 |
En 1865, Léopold II
devint le deuxième «roi des Belges» et marqua profondément son époque. Il fut
celui qui fit de son pays la deuxième puissance économique de son temps. Avec un
long règne de 44 ans, il demeure aujourd'hui dans l'histoire de la Belgique
l'une des personnalités les plus controversées, notamment dans la colonisation
du Congo. Ce roi belge, responsable d’un véritable génocide au Congo
belge, est représenté comme un héros par près de 300 monuments en
Belgique.
C'est sous son règne que
s'amplifia le mouvement flamingant. Pendant longtemps, le mot «Flamands» désignait uniquement les
habitants des deux provinces de la Flandre-Occidentale et de la
Flandre-Orientale. Au cours de la décennie de 1860, le terme commença à
représenter les citoyens parlant le flamand. Le mouvement flamingant exigeait sa
reconnaissance, mais il se heurtait à de nombreuses résistances, même au nord de
la Belgique. Au sein même du camp flamingant, plusieurs factions s'opposaient
dans leurs revendications, dont deux réseaux culturels. D'une part, le
Davidsfonds affichait des positions très conservatrices, d'autre part, le
Willemsfonds se montrait beaucoup plus libéral. En même temps, la faiblesse
économique du nord du pays ne favorisait guère l'usage d'une langue qui, par
ailleurs, n'était pas encore codifiée. |
Par étapes successives, les défenseurs du néerlandais
réussirent à imposer l'introduction de leur langue dans la vie officielle du
pays. L'année 1873 constitue une date importante, car elle marque la
reconnaissance, au plan juridique, du bilinguisme dans le royaume de Belgique,
avec la
loi du 17 août 1873.
Cette première loi linguistique votée par le Parlement concerne l'emploi du
néerlandais dans les tribunaux de Flandre. Cette loi de 1873 introduisait le
néerlandais comme langue véhiculaire principale pour la procédure pénale dans
les provinces flamandes, bien que le français pouvait être utilisé avec l’accord
de l’accusé. Auparavant, les juges pouvaient refuser de comprendre le
néerlandais en se référant à la liberté linguistique. Cette loi sera suivie d'une seconde loi
(dite «loi Delaet»),
en 1878, qui réglementera l'usage des langues en matière administrative ainsi
que dans les écoles de Flandre (dite «loi Coremans»).
La loi du 22 mai 1878,
dite Delaet, fut la première loi définissant trois territoires linguistiques au
sein de la Belgique:
1. Les provinces de Flandre occidentale, de
Flandre orientale, d'Anvers, du Limbourg et l'arrondissement de Louvain.
Dans ces territoires, la «langue
flamande» (non le néerlandais) était considérée comme la langue d'usage
administratif, mais le français demeurait possible à la demande des communes
ou des particuliers qui le souhaitaient.
2. L'arrondissement de Bruxelles
La langue administrative devait être le français, mais le flamand était
reconnu à la demande des communes ou des particuliers qui le souhaitaient.
3. Le reste du pays
La langue administrative en usage est et reste uniquement le français.
Voici le texte original de cette
loi du 22 mai 1878 :
|
Article 1er
(aujourd'hui abrogé)
Dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, les avis
et communications que les fonctionnaires de l'État adressent au
public seront rédigés soit en langue flamande, soit en langue
flamande et en langue française.
Les fonctionnaires de l'État correspondront en flamand avec les
communes et les particuliers, à moins que ces communes ou
particuliers ne demandent que la correspondance ait lieu en
français, ou n'aient eux-mêmes fait usage de cette langue dans la
correspondance.
Article 2
(aujourd'hui abrogé)
Dans l'arrondissement de Bruxelles, la correspondance des
fonctionnaires de l'État avec les communes et les particuliers aura
lieu en flamand si les communes ou les particuliers qu'elle concerne
le demandent ou ont fait eux-mêmes usage de cette langue dans la
correspondance. |
Cependant, ces lois étaient encore adoptées uniquement en français,
parce que
seule la version française pouvait avoir une valeur juridique. Il y eut
également des
délais entre l'adoption et l'application des lois.
De plus, la
connaissance du néerlandais se réduisait à un examen quelque peu superficiel. Il
y eut deux types d'examen: un examen «unilingue français» et un «examen bilingue flamand».
On utilisait encore le terme «flamand» plutôt que le terme «néerlandais». La
plupart des
francophones réussissaient généralement l'examen «français» même après l'école primaire.
Ils devaient aussi démonter une connaissance rudimentaire du néerlandais. Par
contre, les Flamands devaient répondre à des exigences beaucoup plus élevées à
la fois en néerlandais et en français s'ils désiraient réussir l'examen
«flamand».
En conséquence, les Flamands obtinrent un taux d'échec élevé,
contrairement aux francophones. Il devint pratiquement impossible pour les
Flamands de combler tous les postes qui leur étaient disponibles. Enfin,
l'obligation de bilinguisme ne concernait que les emplois subalternes, alors que
les postes supérieurs, mieux rémunérés, étaient massivement occupés par des
unilingues francophones. Le néerlandais n'était exigé que pour les postes qui
exigeaient un contact avec le public flamand. Dans les fonctions hiérarchiques,
seul le français continuait d'être utilisé. On était encore loin de l'égalité
des langues. Ce n'est qu'en 1898 que sera promulguée la fameuse loi d'égalité.
Mais, pour les francophones, cette situation paraissait juste, déjà qu'ils
acceptaient un certain bilinguisme pour une langue qu'ils méprisaient
ouvertement. Il ne fallait pas trop leur en demander! Finalement, les Flamands, comme
les
francophones, violèrent systématiquement les lois linguistiques.
Le 15 août 1887, Léopold II prononça sur la Grand-Place de Bruges un discours
à l'occasion de l'inauguration de la statue de Jan Breydel et de Pieter De
Coninck, les héros de l'insurrection flamande de 1302. Dans l'esprit du roi,
l'exaltation de l'histoire flamande revenait à ancrer la Belgique dans un long
héritage:
|
[...] Le lion des Flandres ne doit pas sommeiller. Le noble héritage
dont vous êtes justement fiers subsistera et il ne cessera pas de
s'accroître, en cultivant toujours les sentiments virils, et en
entretenant le feu sacré du patriotisme, dont j'ai sous les yeux de
si généreux modèles.
Toute liberté naît et périt avec l'indépendance. C'est la leçon
écrite à chaque page de notre histoire.
Les grandes causes sont solidaires. Aux jours mémorables où vos
intrépides milices combattaient sous les murs de Courtrai, nobles,
bourgeois, travailleurs se confondaient dans les mêmes rangs,
joignant leurs bras, versant leur sang dans un élan sublime, et
leurs prêtres étaient à côté d'eux pour soutenir les vivants et
bénir les morts.
Élevons nos âmes, Messieurs, à la hauteur de ces grands exemples;
prenons tous ici envers nous-mêmes l'engagement solennel de ne
reculer devant aucun sacrifice pour maintenir en tout temps les
droits de la patrie et lui assurer des destinées dignes de son
glorieux passé. [...] |
Loin de s'atténuer, le mouvement flamand
allait connaître une nouvelle accélération. La combativité des Flamands suscita
même une réaction défensive du côté des francophones qui créèrent de nombreuses
associations de protection du français dans la plupart des grandes villes
flamandes. Puis un mouvement wallon émergea afin de promouvoir une littérature
en wallon, car il n'était pas question de remplacer le français par le wallon.
Tout au cours du XIXe
siècle, la ville de Bruxelles accueillit de nombreux exilés politiques. Parmi
ces derniers, les Français furent les plus nombreux. Ils arrivèrent par vagues
successives, notamment après 1815 (jacobins et bonapartistes), en 1848
(orléanistes et républicains), après le coup d'État du 2 décembre 1851 et après
1871. À chaque changement de régime en France, les anciens réfugiés retournaient
pour la plupart en France et étaient remplacés par de nouveaux arrivants
jusqu’au prochain changement de régime. Le nombre de Français réellement restés
à Bruxelles au fil des générations est minime. D'autres réfugiés parvinrent de
toute l'Europe, surtout de l'Italie, de la Pologne, de l'Allemagne et de Russie.
Ceux-ci restèrent pour la plupart et s’assimilèrent à la bourgeoisie
francophone, ce qui contribua à faire de Bruxelles une ville francophone, bien
sûr aux dépens des Flamands.
Le plus grand apport à l’augmentation de la part
francophone à Bruxelles provient toutefois du pays brabançon et flamand tout
proche, lequel s’assimilait assez rapidement à la bourgeoisie francophone, ne
fût-ce que par l’exercice des métiers subalternes (gens de maisons,
contremaîtres dans les ateliers, etc.) où les Flamands du «Payottenland» («pays
des payottes» dans la région méridionale du Brabant) de l'Ouest brabançon
parlaient rapidement le français pour pouvoir s’élever dans la hiérarchie
sociale urbaine.
Par la suite, les francophones bruxellois
allaient toujours se distinguer des Wallons. Autrement dit, il y avait trois (ou
quatre) types de Belges: les Flamands, les Wallons et les francophones de
Bruxelles, auxquels il faudra ajouter, après 1920, les germanophones de la
région d'Eupen. En 1910, les francophones (Wallons et autres) constitueront plus
de 50 % de la population, contre seulement 30 % en 1830 et 39 % en 1880.
- La bataille de la
flamandisation
En 1880, la ville de Bruxelles comptait 57 % de Flamands et 39 % de
francophones (contre 1 % de germanophones et 3 % d’étrangers), mais ce n'est
qu'en 1883 qu'on accepta le néerlandais — toujours appelé flamand dans les textes
français — dans l'enseignement primaire (peu appliqué) et en 1889 dans les
tribunaux (pour les témoignages oraux seulement). Même si le bilinguisme était
officiellement reconnu en Belgique, la mise en application de la législation fut
retardée, tant la pression sociale en faveur du français était forte.
En 1886, la monnaie belge devint bilingue, puis ce fut le
tour des timbres postaux en 1889, suivis par le journal des débats, Le Moniteur belge
en 1895.
Mais il ne s'agissait là que de symboles. Les élections d'octobre 1894
envoyèrent au Parlement belge des députés flamingants (de vlaamsgezing) résolus à défendre
vigoureusement les droits linguistiques de leur communauté. Ils engagèrent
immédiatement la bataille pour la flamandisation de la vie législative, mais
n'obtinrent gain de cause qu'en 1898, après des manifestations monstres de la
part des masses flamandes. Cette année-là, la loi de Vriendt-Coremans (loi du 18
avril 1898)
donna au néerlandais le rang de «langue officielle» avec le français, mais en Flandre on parla du Gelijkheidswet,
de la «Loi d’égalité». Cette loi consacrait le néerlandais (toujours appelé flamand)
comme seconde langue officielle du Royaume. Les Flamands comptaient 3,5 millions
de locuteurs, dont les quatre cinquièmes étaient unilingues, sur les six
millions de Belges (d'après le recensement de 1890).
Au cours de la dernière décennie du
XIXe siècle, les Flamands
se rendirent compte que le fait de parler flamand n'apportait pas beaucoup
d'avantages dans leur vie publique ou professionnelle. Ils pouvaient envoyer
leurs enfants dans les écoles publiques et les faire instruire en flamand, mais
cette instruction, toute légitime qu'elle soit, demeurait inutile au plan
professionnel parce qu'il n'existait guère de débouchés pour les enfants
scolarisés en flamand. Cette situation ambiguë contribua à radicaliser davantage le
mouvement flamand.
En réalité, le mouvement flamand était porté
par la petite bourgeoisie, et soutenue par le bas-clergé et la paysannerie. Il
s’opposait à la grande bourgeoisie francophone de Flandre (les «fransquillons»)
qui empêchait son ascension sociale. Le mouvement flamand assimilait tous les
francophones à cet «ennemi», même les ouvriers wallons, eux aussi victimes du
même «exploiteur». Le combat linguistique flamand constitua le ciment de la
population flamande contre son élite, tandis qu’en Wallonie la lutte des classes
n’eut pas de composante linguistique.
8.5 Le mouvement wallon
|
 |
Après le long règne de Léopold II (de 1865 à 1909), l'avènement
d'Albert Ier,
duc de Saxe et prince de Saxe-Cobourg-Gotha, fur le premier souverain à prêter
serment en français et en néerlandais. Conscient de l'époque dans laquelle il vivait, le nouveau roi se préoccupa des
questions sociales et linguistiques de son pays. Il fut le premier souverain
belge à prêter serment dans les deux langues officielles. Cependant, ses préoccupations
étaient davantage guidées par la stabilité de la Belgique, donc de son trône,
que par un engagement personnel.
En réaction au flamingantisme, le mouvement wallon prit
aussi de l'ampleur, surtout avec Jules Destrée (1863-1936) qui tenta de faire germer une
conscience wallonne chez ses compatriotes. Devant la crainte que le bilinguisme soit
exigé dans l'ensemble de la fonction publique, les Wallons demandèrent que le
«flamand» soit reconnu comme «dialecte» au même titre que le wallon.
Les représentants wallons exigèrent aussi que les fonctionnaires en
contact direct avec le public aient la connaissance du «dialecte
wallon» en Wallonie, en compensation de l'obligation du flamand en
Flandre. Forcément, il fallait exclure les fonctionnaires flamands
des emplois publics en Wallonie. Pendant que les Flamands
combattaient pour la primauté du citoyen sur l'Administration, les
Wallons revendiquaient le maintien du statut de fonctionnaire des
années 1830. |
Le texte fondateur du véritable mouvement wallon fut la fameuse lettre de Jules
Destrée à Albert Ier: Lettre au roi sur la séparation de la
Wallonie et de la Flandre de 1912. L'une de ses affirmations les plus
célèbres fut celle-ci: «Et maintenant que me voilà introduit auprès de Vous,
grâce à cette sorte de confession, laissez-moi Vous dire la vérité, la grande et
horrifiante vérité : "Il n'y a pas de Belges, mais des Wallons et des
Flamands."» Il y a aussi cette phrase: « Sire [...], Vous régnez sur deux
peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands ; il n'y a pas de
Belges.»
En 1902, était apparu le Catéchisme du Wallon
d'Albert du Bois (1872-1940), qui affirmait l'identité française de la Wallonie. Dans cet
ouvrage, Albert du Bois répondait à la question «Démontrez-moi que les Wallons
possèdent les traits distinctifs de la nationalité française» par «C'est trop
facile : nous parlons le français et nous ne parlons que le français».
L'unilinguisme en français constitua l'une des revendications principales du
mouvement wallon, y compris aux dépens de la langue wallonne et des autres
variétés dialectales de la Belgique romane. Toutefois, contrairement au mouvement flamand qui avait
réussi à galvaniser les masses surtout grâce au bas-clergé, le mouvement wallon
resta un mouvement minoritaire basé essentiellement dans les régions ouvrières
de Liège et du Hainaut sans le moindre impact dans les provinces plus rurales.
- Les
wallingants
L’application de la Loi
d'égalité de 1898 survint en réalité
beaucoup plus tard, car dans les faits le français conserva le premier rôle au
sein de l’État belge. Les activistes défenseurs du néerlandais (dits
flamingants par leurs adversaires) réclamèrent alors la néerlandisation de
l'Université de Gand; la grande bourgeoisie de Flandre, demeurée
francophile (fransquillonne), s'y opposa. C’est à cette époque qu’apparut
également le terme de wallingant, formé sur le modèle de flamingant,
les deux termes, fort dépréciatifs, désignant toute personne qui mène une
politique active inspirée avant tout par des intérêts nationalistes et
régionaux. C'est sous l'impulsion de l'économiste Lodewijk de Raet (1870-1914)
que commença en 1903 le mouvement vers la néerlandisation de l'Université de
Gand. De Raet estimait que le développement économique de la Flandre était
nécessaire pour le renforcement politique et culturel de la région.
Afin de pouvoir rivaliser économiquement avec d'autres régions et d'acquérir une
position suffisamment forte pour être en mesure de préserver leur indépendance
économique, les Flamands se devaient de disposer d'outils intellectuels, comme
une université flamande.
Puis certains francophones de Bruxelles se montrèrent encore plus intolérants à l’égard des Flamands en raison
de leur affiliation «germanique». On entendit de leur part des francophones
extrémistes des slogans
tels que «la Belgique de demain sera latine ou ne sera pas» (la phrase-clé du
Wallon Raymond Colleye) ou «la civilisation latine remportera la victoire
finale». Ou encore ceci sur l’ethnie «belge»:
|
Il n’y a plus ni de
Flamands ni de Wallons. Il n’y a que des Belges, et on a fermement décidé de
renforcer cette intelligence indissoluble par ce rapprochement linguistique qui
leur réunira avec cette alliance magnifique anti-germanique: la langue
française. |
Certains croyaient fermement à la disparition prochaine du
flamand. «Le flamand, dialecte provincial effiloché en patois locaux, est
appelé à disparaître parce qu’il n’est la langue que d’un petit, petit
peuple», déclarait le Wallon Gérard Harry dans le Petit Journal. Le professeur
Cumont, de son côté, donnait des conférences sur la nécessité de
«romaniser la Belgique».
Au début de 1915, les wallingants distribuaient
massivement une brochure intitulé La politique belge dans laquelle on pouvait apprendre qu’on devrait abolir les dernières lois
linguistiques après la guerre, imposer définitivement le français et
répandre cette langue dans toutes les classes de la population. C’est à
partir de cette époque que les francophones bruxellois s’identifièrent
fortement à l’État belge,
alors que les mouvements flamands devinrent davantage anti-belges (et beaucoup le resteront
définitivement), et les mouvements wallons, davantage anti-fédéralistes et pro-régionalistes.
- Wallonie unilingue et Flandre bilingue
En fait, les Wallons
prirent pour acquis que la Wallonie devait rester unilingue française, alors que
la Flandre devait être bilingue. Autrement dit, les Wallons désiraient le
principe de la territorialité pour eux, pas pour les Flamands sous prétexte que
les francophones devaient se sentir «chez soi» partout en Belgique. Cette
revendication, qui peut paraître de l’incohérence, doit se resituer dans le
contexte de l’époque où les francophones qui formulaient pareil raisonnement
trouvaient en Flandre, surtout dans l’élite intellectuelle et urbaine, bon
nombre de «fransquillons» qui partageaient exactement la même idéologie. Cette
attitude eut pour effet de donner des armes
aux Flamands qui étaient prêts à accepter le bilinguisme partout en Belgique,
mais la territorialité préconisée par les Wallons en Wallonie fit en sorte que
les Flamands la revendiquèrent pour eux aussi. Ainsi, ce ne furent pas les
Flamands qui rejetèrent le bilinguisme, mais les Wallons (cf. les lois
linguistiques de 1930-1932).
- Le cas de Bruxelles
Par
ailleurs, la naissance du mouvement wallon introduisit un autre problème de
taille: celui de Bruxelles! Étant donné que Bruxelles se trouvait en territoire
flamand, mais abritait une population majoritairement francophone, ainsi que les
institutions de l'État belge, il fallait conférer un statut bilingue à la ville
au grand dam des Flamands! Cependant, les Wallons ne pourront jamais «récupérer»
Bruxelles dans leur giron! Rappelons que le nationaliste wallon Jules Destrée
avait, en 1923, nommé les Bruxellois «Métis», c'est-à-dire des habitants
caractérisés comme des «hésitants entre Flamands et Wallons», et tirant
partie de cette hésitation, sans se confondre avec ceux de la Région wallonne.
D'ailleurs, il n'y aura jamais dans la Constitution de «communauté bruxelloise»,
mais une «communauté française» et une «communauté flamande». L'évolution des
lois linguistiques tiendra compte de ces facteurs fondamentaux.
8.6 La question des germanophones
|
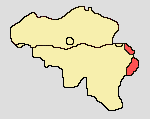 |
Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles
(1919) força la Prusse à céder à la Belgique les cantons germanophones
d'Eupen et de Saint-Vith appelés aussi «Cantons de l'Est», ainsi que le territoire africain du Ruanda-Urundi,
ancienne colonie allemande, qui fut placé sous mandat belge. La population
germanophone allait être consultée en 1920.
Lors d’un simulacre de référendum, la
population des Cantons de l’Est fut invitée à faire savoir si elle s’opposait au
rattachement à la Belgique ou si elle préférait joindre l’Allemagne. Seuls
quelques centaines de fonctionnaires allemands firent la démarche de faire
savoir qu’ils préféraient l’Allemagne, et ce, juste avant de quitter le
territoire. Ainsi, une portion de
territoire prussien (les cantons de l'Est) revint à la Belgique comme une sorte
de compensation à l'invasion allemande.
|
De là naquit l’expression péjorative de
«cantons rédimés», terme qui proviendrait du latin
redimere et signifiant «restituer», afin d'évoquer le retour de ces cantons
dans le giron belge. En réalité il
s’agissait d’une réunification de parties des anciens duchés de Limbourg et de
Luxembourg ainsi que de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, qui
avaient été découpées en 1815 au traité de Vienne.
Les villes de Eupen, de Malmedy, de Saint-Vith et
de Moresnet furent rattachées à la Belgique, avec une population totale de 63 000
habitants. Dès lors, la langue allemande fit partie du patrimoine linguistique
de la Belgique.
8.7 L'armée belge
L'armée belge avait
toujours été un bastion francophone anti-flamand. L'armée était l'institution
belge la plus francisée et la plus anti-flamande. Tous les officiers étaient
francophones ou des Flamands francisés, alors que les soldats étaient flamands,
wallons, picards, west-flandriens, limbourgeois, etc., selon le principe du
tirage au sort qui permettait toutefois au fils de bourgeois de payer son voisin
ouvrier pour faire son service militaire à sa place. Malgré le manque d’emplois
en Flandre à cette époque, les jeunes Flamands ne remplaçaient pas les jeunes
Wallons à l’armée. Par contre, des deux côtés, l’ouvrier effectuait un service
militaire en remplacement d’un fils de bourgeois. L’enseignement ne devint
obligatoire qu’en 1914 et, dans toutes les régions du Nord et du Sud, les
populations des classes les plus pauvres ignoraient souvent le français. S'il
était impossible de devenir caporal sans maîtriser le français, il paraissait
normal de devenir général sans jamais connaître trois mots de la langue parlée
par la majorité des soldats. En 1913, la Chambre des
représentants adopta une loi linguistique (dont l'entrée en vigueur était prévue
pour le 1er janvier 1914) à
l'intention de l'armée afin de redresser quelque peu la situation des Flamands.
Jamais les officiers
francophones n'eurent la moindre intention de respecter la loi. Les soldats
flamands furent régulièrement humiliés parce qu'ils parlaient leur «patois».
Il était même de bon ton, chez des
francophones extrémistes, d’insulter les soldats flamands en leur lançant des
injures du genre «grossier Flamand» ou «cochon flamand» et surtout «boche» ou
«sale flamind-boche». Des soldats flamands
auraient
été fusillés parce qu'ils n'avaient pas bien compris un ordre donné en français!
Bien que ce
soit fort possible, il n'existe aucun élément de preuve permettant d'étayer ces
allégations.
Lorsque les Flamands perdaient la vie, on inscrivait généralement en
français sur leur tombe cette épitaphe: «Mort pour la patrie». De plus, les
Flamands
qui protestaient contre les
infractions à la loi sur l'emploi des langues dans l'armée étaient sévèrement
punis, mais les francophones qui la violaient n'étaient jamais inquiétés. Quant
aux journaux flamands qui osaient accorder de l'importance aux situations
inacceptables dans l'armée, ils s'exposaient à une interdiction de publication.
Dans une
moindre mesure, de nombreux soldats issus de la Wallonie éprouvaient aussi des
difficultés à comprendre les ordres à l’armée, car ils n’avaient pas de
connaissance même élémentaire du français; ils ne connaissaient que le wallon ou
le picard, voire le luxembourgeois ou le francique. Eux aussi subissaient des
vexations de la part d’officiers bornés, mais il n’existait pas en Wallonie de
sentiment d’injustice pour une brimade provoquée par une méconnaissance du
français. Le locuteur du wallon ou du francique, qui se voyait ainsi brimé,
croyait plutôt qu'il avait une intelligence insuffisante, mais ne pensait
sûrement pas qu'il s'agissait d'une brimade à «caractère ethnique».
La mise en évidence de ces brimades à
l’égard des flamands dans l’armée belge suscita, durant la Première Guerre
mondiale au front de l’Yser où près de 80 % des soldats étaient flamands, voire west-flandriens, un mouvement de contestation connu sous le nom de
Frontbeweging (le «Mouvement du front») contre les vexations, les insultes
et le mépris dont faisaient preuve les officiers francophones qui ne parlaient
pas néerlandais. Il est toutefois probable que, s’ils avaient parlé le
néerlandais, les jeunes west-flandriens auraient eu presque autant de
difficultés à comprendre les mêmes ordres, l’analphabétisme dans les campagnes
étant important avant la Première Guerre mondiale et, par conséquent, la
connaissance du néerlandais restait rudimentaire.
- La première Flamenpolitik
|
 |
Au cours de la Première Guerre mondiale, les Allemands instaurèrent en Flandre la
Flamenpolitik (litt. «politique des Flamands»), une
politique pratiquée par les autorités d'occupation
destinée à favoriser la germanisation de la Flandre. Dans l'illustration
ci-contre, le journal De Oorlogskranten présente le général Moritz Ferdinand von
Bissing (1844-1917), un Prussien devenu un marionnettiste, illustrant qu'il
pouvait faire ce qu'il voulait en Flandre.
Dans le cadre de
la Flamenpolitik, von Bissing signa, le 21 mars 1917, un
arrêté de séparation administrative de la Belgique entre la Flandre
et la Wallonie. Il institua une commission dans le but de diviser la
Belgique et d'en faire une zone plus accueillante aux intérêts
allemands.
Afin de donner une idée de
cette idéologie pangermaniste, voici une lettre de 1917 envoyée à l'empereur Guillaume
II d'Allemagne par le gouverneur militaire von
Bissing, laquelle donne un aperçu de la vision allemande de
séparation quant à la Flandre et à la Wallonie: |
|
Conformément
aux indications de Votre Majesté, j'applique toute mon énergie à
développer le plus rapidement possible la politique flamande [Flamenpolitik]
ordonnée par Votre Majesté. Après m’être entendu sur les mesures à
prendre, le 17 du mois passé, avec le représentant du chancelier, le
secrétaire d’état à l’Intérieur, j'ai institué une commission qui
doit préparer la division de l'ancien royaume de Belgique en partie
flamande et partie wallonne. Comme premier pas, j'ai, d'après l'avis
de cette commission, divisé, par ordonnance du 21 écoulé, le
territoire du gouvernement général en deux régions administratives,
une flamande et une wallonne. En prenant pour base la limite
linguistique, ces deux territoires sont bornés par les frontières
des provinces et il n'y a que le Brabant qui sera divisé en deux.
À mesure que l'avancement des travaux
le permettra, les ministères wallons seront transférés à Namur,
tandis que les [ministères] flamands resteront à Bruxelles. Suivant
nos prévisions, on commencera par le déplacement du ministère wallon
de l’Industrie et du Travail à Namur. Dès maintenant, on prend des
mesures pour trouver des locaux à Namur. La séparation des
ministères sera suivie d’autres mesures de séparation. Il convient
de signaler particulièrement l’organisation judiciaire.
Aux mesures de séparation des
autorités belges se joindra la nomination de deux chefs
d'administration allemands, pour la Flandre et la Wallonie, et cette
désignation va même se faire, dès maintenant. Les espérances fondées
sur la création d'une Flandre délivrée de l'influence des Wallons
seront, espérons-le, réalisées et serviront alors certainement les
intérêts allemands.
Je me permets cependant, d’ajouter
qu'il ne serait pas bon d'abandonner à son sort la Flandre délivrée
de là domination de la Wallonie, ou encore de la considérer comme un
objet de marchandage dans les pourparlers de paix qui sont
imminents. Si l'Empire allemand n’y prend garde, le sort de la
Wallonie sera celui d'un ennemi de l'Allemagne, entièrement
francisé. Une Wallonie rendue à l'influence française deviendrait
automatiquement un instrument de domination anglaise et servirait de
prétexte aux visées anglaises sur les côtes de la Flandre.
L'extension de la puissance
allemande et de l'influence allemande en Wallonie ne me paraissent
pas moins importante qu'en Flandre.
Économiquement, la Wallonie vaut
même plus pour l'Allemagne que la Flandre, à cause de son industrie,
en particulier à cause de ses charbonnages que j'ai maintenus en
pleine activité. Assurément, la valeur économique des Flandres
grandira considérablement lorsque les trésors en charbon de la
Campine seront exploités. Il faut montrer, en outre, qu'il y a entre
Flamands et Wallons beaucoup de relations économiques qui doivent
continuer après la séparation, si l'on ne veut pas que tous deux, ou
au moins l'un des deux, ne subissent des dommages. La population
wallonne est plus facile à manier et à diriger que la flamande. Les
Flamands sont naturellement plus lourds et plus enclins à la
résistance. Les Wallons sont plus légers et, s’ils gagnent beaucoup,
s’ils ont quelques avantages sociaux, s'ils peuvent jouir de la vie,
ils sont faciles à gouverner. En conséquence, je considère comme un
devoir envers Votre Majesté et envers la patrie de faire remarquer
qu’il faut avoir soin de conserver une Wallonie bien organisée à
côté d'une Flandre bien organisée. |
Dès le 7 mars 1917, le chancelier Theobald von Bethmann
Hollweg écrivait au maréchal
Paul von Hindenburg :
|
Les intérêts
allemands que nous poursuivons avec cette politique apparaissent
clairement. Le sort de la Belgique dépend du succès final de nos
armes. Quoi qu’il arrive, une Belgique dont l'organisation
intérieure est séparée et dont la majorité flamande est délivrée de
la domination de la minorité wallonne, orientée vers la France, sera
plus aisément rendue utile aux intérêts allemands que l’État belge
dans sa constitution actuelle. |
Dans le cadre de cette politique, les autorités allemandes décidèrent de
libérer tous les miliciens néerlandophones («Flamands»), ainsi que tous
les sous-officiers et sous-officiers de réserve, qui étaient prisonniers de
guerre à la suite de la capitulation de la Belgique. Puis les Allemands
imposèrent la flamandisation de l'Université de Gand, désignée alors comme
l'Université von Bissing, du nom du gouverneur
allemand responsable de l'application de la Flamenpolitik. C'était là la
réalisation de cette université flamande que les intellectuels flamands
désiraient depuis fort longtemps. Mais,
en même temps, ceux-ci se méfiaient des Allemands et de
l'issue probable de cette politique linguistique imposée en cas de victoire possible des
Alliés; ils refusèrent de se faire embaucher comme professeurs. De plus, les
autorités allemandes soutinrent le Conseil de Flandre (en néerlandais Raad
van Vlaanderen) qui proclama l'autonomie de la Flandre. Le chancelier
Theobald von Bethmann Hollweg (1856-1917) encouragea les leaders nationalistes
flamands à déclarer l'indépendance et à intégrer la sphère allemande. Par voie
de conséquence, les forces d'occupation allemandes furent aidées et encouragées
par les mouvement nationalistes wallons et flamands. Quant au gouverneur von
Bissing, il constitua une commission pour préparer la division de la Belgique
et, par un décret le 21 mars 1917, sépara la Belgique en deux régions
administratives : la Flandre (y compris Bruxelles, déjà en voie de francisation)
et la Wallonie.
- L'après-guerre
Après, la guerre (1918), il allait de soi que la partition administrative de
la Belgique serait annulée. Quant à l'Université flamande de Gand, elle fut
immédiatement supprimée, les francophones ayant beau jeu de la dénoncer comme
étant le fruit de la collaboration des Flamands «proboches». La question de
l'université gantoise fut renvoyée aux calendes grecques; il faudra en 1930
l'intervention personnelle du roi Albert Ier
pour que, de francophone, elle devienne néerlandophone.
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les
Flamands ne remettaient pas vraiment en cause l'État belge et reconnaissaient la
nation belge comme une référence pertinente. Bien sûr, les structures
linguistiques de l'État étaient critiquées, mais jamais l'existence de l'État
lui-même. Quant aux
soldats flamands qui faisaient partie de l'armée belge, ils n'étaient commandés
qu'en français. De ces tensions entre soldats flamands et officiers
francophones, naquit le «frontisme». Même dans les tranchées, les inscriptions
n'étaient généralement rédigées qu'en français. Les officiers francophones
avaient tendance à donner leurs ordres en français tout en ajoutant ensuite en
néerlandais: «En voor de vlamingen, hetzelfde!»
(«Et pour les Flamands, la même
chose!». Le frontisme se radicalisa, mais le mouvement permit aux Flamands de
faire entendre leurs revendications bien légitimes. Après la guerre, le roi des
Belges, Albert Ier, promit l'égalité complète
des deux langues du pays, mais cette égalité dut attendre encore une décennie,
le temps que la bourgeoisie francophone puisse se calmer. Entre-temps, la «furia
franskiljonensis» se défoula.
Après la guerre, le
Parlement belge adopta en 1928 une nouvelle loi dans laquelle il était prescrit
que
les ordres devaient désormais être donnés
«dans la langue du soldat». La loi prévoyait même la création de contingents
unilingues au sein de l'armée. Dix ans plus tard, une enquête gouvernementale
révélait que seulement 48 % des officiers avaient une connaissance suffisante du
néerlandais; même dans les unités flamandes, 28 % des officiers avaient encore
une maîtrise insuffisante du néerlandais. La loi du 18 mars 1838 sur l'École
militaire prescrivit qu'il fallait apprendre «les éléments de la langue
flamande», ce qui pouvait correspondre à une heure/semaine. Mais la loi du 30
juillet 1938 imposa la formation complète du soldat dans sa langue maternelle et
exigea le bilinguisme chez les officiers. En 1847, des connaissances plus
approfondies — «moins rudimentaires»
d'après les Flamands — furent exigées
lors de l'examen d'entrée à l'École militaire. Cependant, la connaissance du
néerlandais pouvait être substituée par une connaissance équivalente soit de
l'allemand soit de l'anglais!
Alors que la France et le Portugal revendiquaient une partie des
territoires du Congo, la Conférence de Berlin de 1885 (Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Russie, Suède, Empire ottoman) reconnut la souveraineté du roi
Léopold II de Belgique sur le Congo, qui devint l’État
indépendant du Congo, une possession personnelle du
souverain belge ayant comme capitale la ville de Boma. Peu de temps après la
Conférence de Berlin, plusieurs pays ont signé des traités dans lesquels ils
s’entendaient sur la possession de certains territoires, ce qui déclencha la
course à la possession de territoires africains. La France finit par posséder
tout l’ouest du continent, de la Méditerranée au centre du continent.
L’Angleterre prit alors toute l’Afrique orientale, du Cap au Caire. Au final, la
Belgique, l’Allemagne et l’Italie se partagèrent le reste (voir
la carte d'avant 1914).
9.1 L'État indépendant du Congo
(1885-1908)
|
 |
Léopold II voulait «sauver les Africains de l'oppression
de despotes locaux et du trafic des négriers arabes» pour les
«conduire à la civilisation». Sans jamais avoir posé les pieds au
Congo, grâce à son immense
fortune personnelle, le roi y établit les fondations d’un ordre
colonial qui allait durer 75 ans.
Il créa en 1888 une
Force publique destinée à protéger les travaux du chemin de fer
allant du port de Matadi à
Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa); cette ligne de 400 km de
long fut inaugurée en 1898, ce qui donna le coup d'envoi du
développement de Léopoldville. Le roi déclara que «les terres
vacantes doivent être considérées comme appartenant à l'État».
|
Dans une longue lettre ouverte adressée à
Léopold II (An Open Letter to His Serene Majesty Léopold II, King
of the Belgians and Sovereign of the Independent State of Congo),
George Washington Williams (1849-1891), un pasteur baptiste
afro-américain, condamna l'oppression coloniale que subissaient les
populations congolaises.
Williams rappela aussi au roi que tous les crimes commis
l'étaient en son nom, le rendant ainsi aussi coupable des exactions :
- les villages sont soumis au roi en échange
de caisses de gin;
- les militaires forcent les autochtones à leur fournir des denrées
(poisson, viande, légumes, etc.), les menacent avec leurs fusils et brûlent
leurs maisons s’ils refusaient;
- le système de justice mis en place fait preuve d’une cruauté excessive :
les plus petits délits sont punis par des peines d’enchaînement ou le port
du collier à bœuf;
- les autorités belges pratiquent le commerce, en gros et en détail,
d’esclaves noirs, achetés, vendus et volés, de tous âges et des deux sexes.
De cette «période léopoldienne», il n’est pas
resté grand-chose de «positif», sinon l’arrivée de la langue française dans le
pays en même temps que les colons belges et un modèle d’administration
autoritaire, dont les ennemis de
Léopold II s’évertuèrent à affirmer que les
méthodes employées étaient inhumaines. Les jugements portés sur la période
léopoldienne sont cependant contestés, car s’il est établi qu’il y eut des abus
c’est néanmoins à l’époque léopoldienne que prit fin le marché aux esclaves dans
le nord du Congo. Les Belges de l’État indépendant du Congo n'ont jamais
favorisé l'apprentissage du français par les «indigènes», qui restèrent à
l’écart de l’Administration très embryonnaire de l’époque. Tous les manuels
d’histoire coloniale présentèrent par la suite
Léopold II comme un «grand bienfaiteur des
peuples noirs». Ils mirent en fait en exergue la fin de l’esclavage arabe qui
sévissait au Congo.
Le 5 juin 1890, une convention entre l'État belge et Léopold II faisait en
sorte que la Belgique consentait à l'État indépendant du Congo un prêt de 25
millions de francs. En contrepartie de cette aide, la Belgique recevait une
option qui lui permettait, au bout de dix ans, d'annexer le territoire du Congo.
En 1901, le Parlement belge chargea une commission, formée de députés
appartenant à tous les partis, de préparer un projet de loi sur «le gouvernement
des possessions coloniales de la Belgique». Les campagnes déclenchées contre le
système instauré au Congo par le roi Léopold II contribuèrent à précipiter les
événements et, le 3 décembre 1907, le projet de loi était déposé au Parlement.
Ce projet consacrait la cession à la Belgique de «la souveraineté des
territoires composant l'État Indépendant avec tous les droits et obligations qui
y sont attachés». Après de laborieuses négociations, le Parlement votait le 20
août 1908, la loi réalisant l'annexion du Congo. Le 15 novembre de la même
année, l'État indépendant du Congo cessait d'exister pour devenir «le Congo
Belge».
9.2 Le Congo belge
|
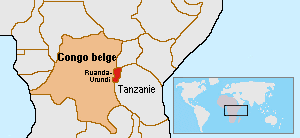 |
La Belgique fit officiellement du
Congo une colonie dont les éléments essentiels reposèrent sur l’Administration, les missions
chrétiennes et les compagnies capitalistes, sans parler de l’armée belge. La
Belgique venait d'hériter d'une colonie dont le territoire était 80 fois plus
vaste que le sien. Les provinces de la colonie étaient l'Équateur, la
Province-Orientale, le Kasaï, le Kivu, le Katanga et Léopoldville. La ville de
Léopoldville était la capitale administrative du Congo belge (voir
la carte). |
Le français et le flamand (en
réalité, le néerlandais) furent les deux langues officielles de la
colonie. À l'exemple de la Belgique, il y a même eu des projets de partage du
Congo belge en une «zone francophone» et une «zone flamande». Le domaine de
l’enseignement relevant des missions catholiques et protestantes, les religieux
et les administrateurs ne voulurent guère favoriser l'apprentissage du français
ou du néerlandais par les «indigènes». En 1929, une brochure du gouvernement
colonial précisait même que la «langue indigène enseignée» dans les écoles
primaires était l'une des quatre langues nationales (swahili, kikongo, lingala
et tshiluba), dans le but avoué de «ne pas déraciner les indigènes». Le rôle de
ces langues semble même avoir été prépondérant par rapport au français et au
flamand (néerlandais), notamment dans les domaines de l'éducation et des
communications destinées à la population. Les deux langues officielles de la
colonie n’étaient pas accessibles pour la plupart des Congolais. Les enseignants
expliquaient aux petits Congolais que leur langue était «une créature de Dieu»
et qu’à ce titre elle devait être respectée. Outre le fait que les colonisateurs
souhaitaient de la sorte ne pas déraciner des populations en faisant eux-mêmes
l’effort de s’adapter aux langues locales, il y avait chez un certain nombre de
missionnaires une volonté de respecter le «patrimoine culturel» des langues
indigènes. Les missionnaires estimaient que, pour enseigner aux Congolais la
manière de devenir de bons chrétiens, il relevait de leur responsabilité de
parler la langue des Noirs à convertir; ce n'était pas aux Noirs à s’adapter à
la langue des missionnaires.
Dans la foulée de la domination du français
dans l’administration en Belgique, seul le français restait la langue de
l'Administration coloniale ainsi que des écoles secondaires. Or, étant donné que
le français n’était pratiquement pas accessible aux Congolais, la colonisation
belge ne suscita pas l’émergence d’élites administratives et politiques locales,
sauf tout à la fin de la période coloniale. Il faut préciser que, même en
Belgique, les masses agricoles et ouvrières ne poursuivaient leurs études
secondaires au-delà de l’âge de 14 ans (enseignement obligatoire) que très
exceptionnellement avant la Seconde Guerre mondiale. Les seules études que
pouvaient poursuivre les jeunes dans les milieux agricoles étaient celles
nécessaires pour devenir prêtre. La colonie congolaise fut calquée sur le même
modèle; la coexistence entre les Blancs et les Noirs ressemblaient à une sorte
d’apartheid, celle-ci étant tempérée quelque peu par la présence des missions
chrétiennes.
Après 1919, la grande majorité des Flamands souhaitèrent
que le néerlandais fût utilisé réellement dans l’administration,
la justice, l'armée, l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que dans les universités.
Ce fut le «Programme minimum flamand». De
là, le second «compromis» entre Wallons et Flamands: tracer une frontière
linguistique à partir d’une question posée aux habitants sur leurs pratiques
linguistiques lors des recensements décennaux. Dès lors, la lutte entamée prit
de plus en plus la forme de deux unilinguismes. Contrairement à ce qu'on peut
penser, c'est le Sud wallon qui s'opposait au bilinguisme, car la Flandre
pratiquait déjà le bilinguisme depuis l'indépendance, tandis que la Wallonie se
contentait du français. À ce moment, il aurait été possible d'étendre le
bilinguisme à l'ensemble du pays, mais ce n'est pas ce qui s'est produit.
10.1 Les régions
linguistiques
|
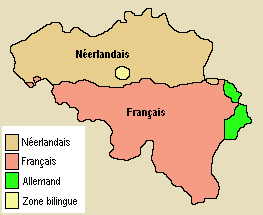 |
La première loi linguistique de
l'après-guerre fut la loi du 31 juillet 1921. Cette loi s'appliquait à toute la
Belgique pour la première fois. Elle mettait en principe les deux langues sur
pied d’égalité, tout en restant soucieuse de protéger les minorités francophones
établies en Flandre. Elle réglementait aussi l'usage des langues dans
l'administration communale, provinciale, ainsi que dans l'administration
centrale de l'État. Elle reconnaissait l'unilinguisme régional en créant trois
régions linguistiques, alors que le frontière linguistique n'était pas encore
fixée:
1) une
partie flamande au nord (où le français pouvait encore être utilisé à
certaines conditions);
2)
une partie
française au sud (sans néerlandais, malgré la présence importante des
Flamands, mais très dispersée et jamais jusqu’à composer une minorité
significative en un endroit déterminé);
3) une
partie bilingue (Bruxelles), alors qu’il existait dans
l’agglomération bruxelloise des situations diverses de majorités d’une commune à
l’autre.
|
L'article 3 de la
loi du 31 juillet 1921
énonçait:
|
Article 3
Dans les communes dont la majorité des habitants parle le plus
fréquemment, d'après le dernier recensement décennal, une langue
différente de celle du groupe linguistique auquel l'article 1er les
rattache, le conseil communal décide du choix de la langue pour ses
services extérieurs et pour la correspondance. Toutes les
administrations publiques soumises à la présente loi se conforment à
ce choix, quant à la largue de service et pour la correspondance
administrative. |
Mais il ne s’agissait pas encore d’un véritable système de protection des
minorités locales.
L'arrêté royal du 27 janvier 1922, en
application de cette loi, précisait que les dossiers relevant de la Flandre
seraient dorénavant traités en néerlandais, et ceux relevant de la Wallonie en
français par les administrations centrales de l'État. Dans les localités où il
existait un bilinguisme de fait, les conseils municipaux pouvaient opter pour le
français. Non seulement les communes bilingues de la Flandre deviendront
francophones dans les faits, mais les communes flamandes de Wallonie le
deviendront également.
Mais il y avait des exceptions: le bilinguisme était obligatoire dans certains
services dans les deux régions. En général, il s'agissait des communes où 20 %
des citoyens en faisaient la demande. Ces exceptions déplurent aux Flamands, car
toutes les communes bilingues, tant en Flandre qu'en Wallonie, optèrent
exclusivement pour le français. La loi permettait ainsi aux francophones de
«gruger», selon les Flamands, le territoire flamand tous les dix ans.
Quant au bilinguisme de Bruxelles,
il constituait une «victoire» pour les
francophones, car ce statut donnait la possibilité, toujours selon les Flamands, «de grignoter» encore du
terrain à leurs dépens, alors qu'ils étaient devenus minoritaires. La
loi du 31 juillet 1921 devait
servir à protéger les francophones, alors qu’aujourd’hui elle avantage les
néerlandophones. Selon cette loi, la frontière linguistique devait évoluer à
partir d’une consultation populaire lors des recensements décennaux. Par la
suite, l'université de Gand devint exclusivement néerlandophone.
Les
pratiques linguistiques en vigueur dans l'ensemble de la Belgique démotivèrent
les militants nationalistes flamands. Beaucoup ne crurent plus en l'État belge, comme en
fait foi cette charte de 1922 intitulée «Dix commandements du nationalisme flamand»
(Tien
bevelen van het Vlaamse nationalismus) :
|
Tien
bevelen van het Vlaamse nationalismus
1. Gij zult geloven in enn
Vaderland: Vlaanderen.
2. Gij zult alle Vlaamsche
nationalisten als broeders beschouwen.
3. Gij zult Vlaanderen's
zonen uit kerker en ballingschap helpen.
4. Gij zult alle Belgische
partijpolitiek laten varen.
5. Gij zult Uw Volk
waarschuwen tegen slechte herders, die met de belgische verdrukker
samewerken.
6. Gij zult alle
Belgicisten, ook de Vlaamsche, als vijanden van Vlaanderen beschowen.
7. Gij zult ter bevridijng
van Uw vaderland alle doeltreffende hup aannemen.
8. Gij zult met at Uw
krachten Vlaanderen's politieke zelfstandigheid bewerken.
9. Gij zult het
Grootnederlansche streven bevorderen met woord en daad.
10. Gij zult België
verzaken met al zijn pomperijen. |
Dix commandements
du nationalisme flamand
1. Tu croiras en une patrie:
la Flandre.
2. Tu
considéreras tous les nationalistes flamands comme des frères.
3. Tu aideras les fils de
la Flandre à sortir de prison et d'exil.
4. Tu ne t'occuperas point
de la politique partisane belge.
5. Tu mettras ton peuple en
garde contre les mauvais bergers qui collaborent avec l'oppresseur belge.
6. Tu considèreras comme
ennemis tous les belgicistes, y compris les Flamands.
7. Tu accepteras toute aide
qui contribuera à la libération de ta patrie.
8. Tu travailleras de
toutes tes forces à la réalisation de l'indépendance de la Flandre.
9. Tu poursuivras l'idée
pan-néerlandaise tant avec la parole qu'avec l'action.
10. Tu renonceras à la
Belgique et ses pompes. |
Puis la
Loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative
déclara bilingue la ville de Bruxelles,
enclavée en territoire flamand. À la demande des Flamands, la loi traça une
«frontière linguistique» et créait en même temps trois régions linguistiques:
«la région de langue néerlandaise», «la région de langue française» et «la
région bilingue composée des communes de l’agglomération bruxelloise». La loi
belge de 1932 ne traçait pas définitivement la «frontière linguistique»
(contrairement à la loi
du 8 novembre 1962), mais
permettait d'adapter le droit en fonction de l'évolution des événements ou des
changements démographiques.
Un
recensement décennal était prévu avec un côté aspect linguistique. Si une
minorité d'une commune atteignait 30 % de la population, la commune entrait dans
le régime du «bilinguisme externe» et devenait une commune «à facilités
linguistiques». De plus, si la majorité des habitants déclarait, lors du
recensement, parler l'autre langue que celle de la région, la commune devait
changer de régime linguistique, ce qui revenait à déplacer la «frontière
linguistique». La loi prévoyait des exceptions à l'égard des «minorités
protégées» dans les communes à population mixte, lesquelles étaient nombreuses
le long de la frontière linguistique. On organisa un «bilinguisme externe» pour
les avis et communications au public.
De plus, la
loi du 28 juin 1932 permettait d'utiliser la langue
employée par les habitants ainsi que la traduction de documents à tout citoyen
intéressé. Il s'agissait ainsi des premières «facilités» avant la lettre, bien
que le terme n'était pas utilisé. Par cette même loi, le français et le
néerlandais devinrent les deux langues co-officielles de l'État belge. La
loi prescrivait l’unilinguisme extérieur (annonces, communications, etc.) en
Flandre et en Wallonie, et le bilinguisme extérieur dans l’agglomération
bruxelloise et dans toutes les communes des deux côtés de la frontière
linguistique (statut de «bilinguisme externe»). Quand la majorité se déclarait
d’une langue particulière, la commune devrait être administrée désormais dans
cette langue (l’unilinguisme interne), et les annonces et communications dans la
langue en question (l’unilinguisme externe). C'était alors la loi du bon sens. De plus, il n'existait aucun moyen de contrôle,
ni de sanctions en cas de non-observance des dispositions de la loi. Enfin, la
loi du 28 juin 1932 prévoyait de
délimiter les trois régions linguistiques, tous les dix ans, sur la base
du recensement linguistique.
- Les langues d'enseignement
Peu après l'adoption de la loi du 28 juin
1932, la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de
l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen portait sur l'enseignement prévoyait le
maintien des «classes de transmutation» à l'intention des minorités de l'autre
langue. C'est pourquoi il y eut des classes françaises dans les communes
néerlandaises à Vilvorde (Vilvoorde),
Halle (Hal), Leeuw-Saint-Pierre (Sint-Pieters-Leeuw), Crainhem, Rhode-Saint-Genèse
(Sint-Genesius-Rode), Grand-Bigard
(Groot-Bijgaarden), Wemmel et
Tervuren.
|
Article 1er
La langue de l'enseignement dans les écoles gardiennes et les écoles
primaires communales, adoptées et adoptables, est le flamand dans la
région flamande du pays, le français dans la région wallonne et
l'allemand dans les communes d'expression allemande.
Article 2
Les enfants dont la langue maternelle ou usuelle n'est pas la langue
régionale ont le droit de recevoir l'enseignement dans leur langue
maternelle. Toutefois, les communes et les directions d'écoles
adoptées ou adoptables demeurent juges de la réalité de ce besoin
linguistique et de l'opportunité d'y donner satisfaction. Il ne sera
pas tenu compte des enfants dont les parents ne possèdent pas la
nationalité belge.
Article 8
Dans les établissements régis par la loi organique de l'enseignement
moyen, la langue de l'enseignement est le flamand, le français ou
l'allemand, suivant que les établissement sont situés respectivement
dans la région flamande, dans la région wallonne ou dans une
localité d'expression allemande.
Article 12
Dans les établissements situés dans l'agglomération bruxelloise et
les communes bilingues de la frontière linguistique, la langue de
l'enseignement est la langue maternelle ou usuelle des élèves.
Article 14
La langue de l'enseignement dans les classes primaires (sections
préparatoires) annexées aux écoles moyennes est le flamand dans la
région flamandes du pays, le français dans la région wallonne et
l'allemand dans les communes d'expression allemande. |
Par ailleurs, alors que la loi du 14 juillet 1932 prescrivait le
néerlandais comme langue officielle de la Flandre et le français comme langue
officielle de la Wallonie, elle autorisait l'enseignement de l'allemand dans la région d'Eupen et de Saint-Vith (région
germanophone). La
loi de 1932 eut pour effet de poursuivre la francisation de Bruxelles, alors que
la Flandre se néerlandisait. Quant aux établissements d'enseignement libres, ils
échappaient au régime en vigueur de sorte qu'un enseignement primaire
francophone pouvait toujours être dispensé en Flandre. On aura intérêt à lire
deux affiches
publiées en 1932 par
la Ligue contre la flamandisation de Bruxelles
en cliquant ICI,
s.v.p.
- Les langues en matière de justice
Plus tard, la
Loi du 15 juin1935 sur
l'emploi des langues en matière judiciaire
garantit l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment aux
néerlandophones afin qu'ils puissent se défendre dans leur langue :
|
Article 1er
Devant les juridictions civiles et commerciales de première
instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans
les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les
arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, toute la
procédure en matière contentieuse est faite en français. [L. 23
septembre 1985, art. 1er
(vig. voy. L. 23 septembre 1985, art. 59 s., infra)].
Article 2
Devant les juridictions civiles et commerciales de première
instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans
les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toute la
procédure est faite en néerlandais. [L. 23 septembre 1985, art. 2 (vig.
voy. L. 23 septembre 1985, art. 59 s., infra)].
Article 2bis
Devant les juridictions civiles et commerciales de première
instance, et le tribunal du travail dont le siège est établi dans
l'arrondissement d'Eupen, toute la procédure en matière contentieuse
est faite en allemand. [L. 23 septembre 1985, art. 3 (vig. voy. L.
23 septembre 1985, art. 59 s., infra)]. |
Malheureusement, toutes ces nouvelles mesures déclenchèrent de vivres
polémiques, surtout parce que, les traductions des avis communaux n'étant pas
interdites, elles ne s'appliquaient qu'en Flandre. Les Flamands exigèrent donc
la suppression de ces traductions. Le gouvernement dut constamment interpeller
les communes durant plus d'une décennie afin de faire respecter l'unilinguisme
régional, ce qui démontrait que la loi était peu respectée, surtout en Wallonie. Ces
diverses lois linguistiques finirent par donner satisfaction aux Flamands, mais les
francophones de Flandre et les Flamands de Wallonie furent tous laissés-pour-compte.
Si la loi n’était pas respectée dans beaucoup
de communes, c’était le plus souvent dans le sens d’une offre possible à l’autre
communauté, rarement pour écraser une minorité. Ce non-respect atténuait en
quelque sorte la rigueur de la loi, mais exaspérait les flamingants qui
devinrent plus impatients.
- La seconde Flamenpolitik
En mai 1940, les troupes
allemandes nazies envahirent la Belgique. Pour des raisons de «communauté
culturelle», les Allemands pratiquèrent une politique de favoritisme qui allait
creuser davantage le fossé entre le nord et le sud du pays. En effet, les Allemands favorisèrent les
Flamands au détriment des Wallons francophones : ils considéraient les Flamands
comme un «peuple frère» germanique, à peine inférieur à la «race allemande». Le
14 juillet 1940, Adolf Hitler ordonna de «favoriser autant que possible les
Flamands, mais de n'accorder aucune faveur aux Wallons». C'était encore une
Flamenpolitik («politique des Flamands») déjà pratiquée lors de la Première Guerre mondiale.
|
 |
Sous l'administration du gouverneur militaire de la Belgique et
du nord de la France, le général de la Wehrmacht, Alexander von
Falkenhausen, le
Vlaams Nationaal Verbond (VNV), c'est-à-dire le Rassemblement national
flamand fondé par le leader flamand Jeroom Gustaaf De Clercq (dit "Staf De
Clercq"), fut chargé de faire régner l'ordre nouveau en Flandre.
Pro-nazi et
antisémite convaincu, De Clerq avait accueilli les Allemands à bras ouverts,
croyant que l'occupation lui donnerait l'occasion de créer un «grand État
flamand» indépendant réunissant la Flandre française, la Flandre belge et les
Pays-Bas, le tout sous la coupe allemande. Le VNV avait son drapeau et son
journal, De Nationaalsocialist. |
Le parti de De Clercq en
profita pour exprimer de façon radicale ses positions anti-belges et de rallier
le «culte du chef» et de l'autorité. Staf De Clercq considérait que la Flandre,
par son histoire et sa langue, faisait intégralement partie du «Reich de mille
ans». C'est pourquoi elle pouvait prétendre appartenir à la «race supérieure».
Il existait à cette époque un autre groupe, plus radical encore,
qui exigeait l'intégration pure et simple de la Flandre dans le Reich :
DeVlag, une organisation nationale-socialiste flamande fondée en 1936 par
Jef van de Wiele et Rolf Wilkening. Le nom de DeVlag est une contraction de
Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft.(mot à mot: «groupe de travail
germano-flamand»). De Vlag se lança dans une politique de collaboration sans
limites et tissa des liens de proximité avec les SS. Toutefois, au fil de la
guerre et des défaites allemandes, les partis extrémistes flamands allaient
perdre une grande partie de leur influence et de leurs membres.
De nombreux décrets furent signés contre la population juive de
Belgique: 25 000 juifs furent envoyés vers les camps d’extermination en
Allemagne. Durant l’occupation, quelque 43 000 non-juifs furent aussi déportés
dans les camps de concentration, où 13 000 trouvèrent la mort, alors que des
dizaines de milliers de résistants furent arrêtés, parmi lesquels des centaines
torturés et fusillés. Les prisonniers
de guerre flamands purent regagner leur foyer, tandis que les 65 000 prisonniers
wallons, associés aux francophones, demeurèrent dans les stalags, les camps de
prisonniers, jusqu'à la fin de la guerre. Adolf Hitler accorda une attention particulière aux
revendications flamandes et octroya à la langue flamande la protection la plus étendue.
La plupart des Flamands réagirent avec une certaine
froideur et une certaine méfiance devant les nazis; ils conservèrent leur
caractère «klein katholiek». En réalité, la bourgeoisie francophone se servit du
prétexte de la guerre pour tenter de se débarrasser définitivement du mouvement
flamand. La Seconde Guerre mondiale mit les réformes linguistiques sous le tapis
et offrit aux partisans du français l'occasion de développer une grande
contre-offensive. C'est pourquoi les conséquences de la collaboration furent
catastrophiques pour le mouvement flamand. La répression allait s'abattre
durement.
En 1944, la politique allemande se durcit davantage. Le général
von Falkenhausen, qui détestait Hitler et les nazis, fut remplacé le 19 juillet
par le Gauleiter nazi Josef Grohé. Celui-ci était l'ancien Gauleiter
de Cologne et d'Aix-la-Chapelle. En principe, le Gauleiter était une
sorte de «conseiller» auprès des autorités locales, mais il était en réalité le
gouverneur d'un Gau dont il avait la responsabilité. L'objectif des nazis
était de favoriser la division du pays en deux Gaue séparés.
Les Wallons développèrent un ressentiment non seulement envers les Allemands,
mais aussi envers les Flamands. Ils accusèrent tous les Flamands de
collaboration dans la mesure où la politique allemande correspondait aux
aspirations nationalistes flamands. Il est vrai que le VNV, devenu fasciste,
travailla activement aux côtés des nazis, mais certains Wallons ont aussi
collaboré avec l'occupant nazi. Ce n'était pas là un problème flamand, mais un
problème «belge» général.
- La «question royale»
|
 |
Un événement concernant la famille royale
allait profondément diviser la Belgique. En septembre 1941, le roi
Léopold III s'était marié en secret
avec Lilian Baels (devenue la princesse de Réthy) devant le cardinal Van Roey,
primat de Belgique, sans en informer l'occupant allemand. Pour le
souverain, le fait de contracter un mariage religieux avant un
mariage civil était dicté par un désir de discrétion, un acte
strictement privé, mais c'était en parfaite illégalité. Or, la Constitution belge prévoyait que le mariage civil
devait obligatoirement précéder toute cérémonie religieuse, ce qui rendait le
mariage royal inconstitutionnel. Pour la population, un roi prisonnier ne
pouvait convoler en justes noces dans des circonstances aussi
dramatiques. Le roi était présent en Belgique, isolé dans son
château de Laeken, loin de son peuple, pendant que le gouvernement
était en exil. En juin 1944, la déportation du roi avait été exigée
par l'occupant nazi; le souverain s'est retrouvé à Hirschstein, près
de Dresde en Allemagne.
Le 8 septembre 1944, le
gouvernement belge en exil rentra au pays, tandis que le prince Charles, frère
du roi, assumait la régence du pays. La famille royale fut libérée par les
Américains, entrés à Salzbourg, au début mai 1945, mais le gouvernement décida
que des dispositions constitutionnelles empêchaient le roi de régner en
Belgique.
|
Le gouvernement, formé du Parti libéral et du Parti social-chrétien, proposa
la tenue d'un référendum pour sortir de l'impasse, bien que ce mode de scrutin,
n'étant pas prévue dans la Constitution, ne soit pas légal en Belgique. Le
référendum s'est tenu le 12 mars 1950 avec le résultat que 57 % de la population
se déclarait favorable au retour du roi.
Toutefois, alors que les Flamands
étaient favorables dans une proportion de 72 %, les Wallons y étaient opposés à
58 %, ce qui scindait la Belgique en deux. Puis, en juin 1950, les élections
entraînèrent le Parti social-chrétien au pouvoir, lequel fit en sorte que le roi
puisse revenir en Belgique pour y régner. Aussitôt, un vaste mouvement de grève
fut déclenché en Wallonie, accompagnée d'attentats sur les voies de chemin de
fer et les centrales électriques. Pendant que des manifestations violentes
éclataient, des Wallons incitaient le peuple à la révolution et à
l'insurrection. Un gouvernement wallon provisoire fut même formé pour préparer
une éventuelle indépendance, avec l'appui apparent de la France.
Le 22 juillet 1950, Léopold III revint en Belgique, croyant que
sa présence allait calmer la population. Mais c'est tout le contraire qui s'est
produit. Des soulèvements éclatèrent dans tout le pays et les manifestations
devinrent de plus en plus violentes, opposant léopoldistes et anti-léopoldistes.
Le pays parut basculer dans la guerre civile. Depuis la
fondation de la Belgique en 1830, la monarchie avait toujours été perçue comme
un facteur d'unité et de stabilité pour le pays. Pour la première fois, elle
apparaissait comme un facteur de division et une cause de troubles à l'ordre
public. Le souverain voulut temporiser en nommant son fils aîné Baudouin
lieutenant général du royaume, mais rien n'y fit.
|
 |
Finalement, le
gouvernement belge conseilla au roi d'abdiquer en faveur de son fils Baudouin,
20 ans, dans l'espoir de calmer le jeu. Le 16 juillet 1951, le roi Léopold III signa son
abdication et, le lendemain, Baudouin lui succéda en tant que cinquième roi des
Belges. La «question royale» était close, mais elle avait profondément marqué le
pays.
Ainsi, l'avènement au trône de Baudouin se produisit dans une
période de crise politique et son long règne
allait devoir entériner tous les grands événements qui feront la
Belgique d'aujourd'hui: l'indépendance du Congo, le Pacte scolaire,
les crises linguistiques à répétition, la fédéralisation de la
Belgique et les années de rupture. Le
15 décembre 1960, Baudouin épousa doña Fabiola de Mora y
Aragón qui devient la «reine Fabiola». Le couple n'allait pas avoir
d'enfant; c'est donc son frère Albert qui lui succédera.
Dans le faits, la Belgique est restée un État unitaire jusque
dans les années 1970. Ce n’est qu’en 1976, soit après déjà
vingt-cinq ans de règne, que le roi Baudouin commença à parler
prudemment du fédéralisme. |
- Le recensement de 1947
En raison des dispositions contenues dans la
Loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière
administrative, notamment à l'article 6.4, des
conséquences étaient liées au recensement linguistique. En effet, llorsque 30 %
de la population déclarait qu’elles parlaient une autre langue que la langue
officielle de la commune, cette commune devait également desservir ces habitants
dans leur langue. Étant donné que la commune devait changer de régime
linguistique, cela revenait à déplacer la «frontière linguistique». On pourrait
dire que c'était là la loi du bon sens. Après le recensement linguistique de
1920, l'agglomération bruxelloise était passée de 15 à 17 communes.
À cause de la Seconde Guerre mondiale, le prochain recensement
linguistique ne devait être organisé qu’en 1947. Cette année-là, l'élaboration
du questionnaire prévu pour le recensement suscita la méfiance des Flamands. La
façon de formuler la question paraissait ambiguë. Il était demandé à chaque
citoyen quelle langue il parlait de la façon suivante: «Toujours ou dans la
plupart des cas». Dans de nombreuses municipalités, le recensement linguistique
aurait été influencé par les recenseurs linguistiques eux-mêmes. Le fait que le
recensement soit organisé peu de temps après la guerre, soit durant la
répression qui s'abattait sur les «collaborateurs» des nazis, aurait conduit un
grand nombre de citoyens à choisir le français plutôt que le néerlandais.
À la suite du recensement, les communes d'Evere, de Ganshoren et
de Berchem-Sainte-Agathe furent intégrées dans l’agglomération
bruxelloise, qui comptait dorénavant 19
communes. Les communes de Drogenbos, de Wemmel, de Kraainem et de Linkebeek
comptaient plus de 30 % de francophones. Dès que 50 % de la population déclarait
parler une autre langue, l'administration communale pouvait changer de langue
administrative et devenir bilingue, et ainsi la frontière linguistique se
déplaçait. Les résultats des recensements linguistiques avaient donc des
conséquences politiques et linguistiques importantes. En élargissant
l'agglomération de Bruxelles et en francisant systématiquement les communes
périphériques néerlandophones autour de la capitale, les francophones se
voyaient au fil des recensement agrandir «leur» territoire. Or, les Flamands
réagirent très mal, car chaque recensement linguistique pouvait se transformer
en «lutte linguistique». C'est alors qu'apparut l’image de Bruxelles qui faisait
«tache d’huile».
Dans ces conditions, le système prévu dans la
Loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière
administrative devenait peu favorable à la pacification
communautaire. En raison de cette controverse, le gouvernement ne publia les
résultats qu'en 1954. Les Flamands remirent en cause l'objectivité des
recensements, alors que la nouvelle annexion de trois communes périphériques
flamandes (Evere, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe) à l'agglomération
bruxelloise entraîna une mobilisation générale du Mouvement flamand. Plusieurs
associations flamandes, dont le Davidsfonds, le Vermeylenfonds et le
Willemsfonds, exigèrent la suppression des recensements linguistique et une
nouvelle délimitation de la frontière linguistique, tout en qualifiant de
«manipulation» ces recensements. Plus de 500 administrations communales
flamandes s'opposèrent à tout nouveau recensement linguistique. Devant les
tensions communautaires, le gouvernement belge reporta le recensement
linguistique de 1957 pour finalement les abolir. L'adoption de la
loi du 8 novembre 1962 allait modifié considérablement les lois précédentes de 1932
et de 1954. Dans toute cette histoire, les Wallons ont paru assez indifférents
face à ce conflit bruxellois, car ce sont les francophones de Bruxelles qui sont
montés aux barricades.
- La question scolaire
La question scolaire, appelée plus tard la «guerre scolaire», occupa toute la scène
politique des années 1950, donc dès le début du règne de Baudouin. Le conflit existait depuis longtemps et
découlait de l'existence parallèle de deux réseaux scolaires concurrents:
l'enseignement «libre» essentiellement catholique et l'enseignement laïc de
l'État belge. Les Wallons favorisaient l'enseignement catholique, les Flamands,
l'enseignement laïc. En 1958, le compromis du Pacte scolaire entraîna la
création de deux réseaux dans l'ensemble du pays. Le Pacte scolaire
consacra le caractère confessionnel ou non confessionnel des écoles en
définissant de nouvelles règles. Une loi de 1959 instaura le principe du
libre-choix des parents lors de l'inscription des enfants à l'école et imposa à
l'État d'assurer ce libre-choix pour tous en organisant un enseignement neutre
«là où le besoin s'en fait sentir». Dans les écoles officielles, un cours de
religion doit obligatoirement être organisé à côté du cours de morale. Au plan
financier, le Pacte établit le principe du subventionnement par l'État des
différentes formes d'enseignement reconnues, qu'elles soient publiques
(provinciales ou communales) ou privées (catholiques en général).
- La fin des colonies belges
En 1960, prenaient fin les clonies belges, soit le Congo belge
dont faisaient partie le Rwanda et le Burundi. Le 30 juin 1960, le
roi Baudouin assista aux cérémonies de
l'Indépendance. Pendant que le souverain glorifiait l'œuvre civilisatrice de la
Belgique au Congo belge et passait sous silence ses nombreuses dérives, le
premier ministre Patrice Lumumba prononçait un discours particulièrement
critique envers la Belgique. Voici un extrait du discours du roi Baudouin :
|
Discours du roi des Belges, Baudouin
L'indépendance du
Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du
roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et
continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure
dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je
n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique toute entière.
Pendant 80 ans la
Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils, d'abord
pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui
décimait ses populations, ensuite pour rapprocher les unes des
autres les ethnies qui jadis ennemies s'apprêtent à constituer
ensemble le plus grand des États indépendants d Afrique [...]
Lorsque Léopold II a
entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement,
il ne s'est pas présenté à vous en conquérant mais en civilisateur.
Le Congo, dès sa
fondation, a ouvert ses frontières au trafic international, sans que
jamais la Belgique y ait exerce un monopole institué dans son
intérêt exclusif. Le Congo a été doté de chemins de fer, de routes,
de lignes maritimes et aériennes qui, en mettant vos populations en
contact les unes avec les autres, ont favorisé leur unité et ont
élargi le pays aux dimensions du monde. [...]
Un nombre de plus en plus considérable de travailleurs qualifiés
appartenant à l'agriculture, à l'industrie, à l'artisanat, au
commerce, à l'administration font pénétrer dans toutes les classes
de la population émancipation individuelle qui constitue la
véritable base de toute civilisation. Nous sommes heureux d'avoir
ainsi donné au Congo malgré les plus grandes difficultés, les
éléments indispensables à l'armature d'un pays en marche sur la voie
du développement. [...] |
Et une partie de la réponse du premier ministre congolais,
Patrice Lumumba :
|
Discours du
premier ministre Patrice Emery Lumumba
[...] Cette lutte, qui fut de
larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus
profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une
lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous
était imposé par la force.
Ce que fut notre sort en 80 ans de
régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop
douloureuses encore pour que nous puissions le chasser de notre
mémoire. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de
salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de
nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme
des êtres chers.
Nous avons connu les ironies, les
insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir,
parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un Noir on
disait «tu», non certes comme à un ami, mais parce que le «vous»
honorable était réservé aux seuls Blancs ?
Nous avons connu que nos terres
furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne
faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu
que la loi était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un Blanc ou
d'un Noir : accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les
autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour
opinions politiques ou croyances religieuses ; exilés dans leur
propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même.
Nous avons connu qu'il y avait
dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des
paillotes croulantes pour les Noirs ; qu'un Noir n'était admis ni
dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits
«européens» ; qu'un Noir voyageait à même la coque des péniches, aux
pieds du Blanc dans sa cabine de luxe.
Qui oubliera enfin les fusillades dont périrent tant de nos frères,
les cachots dont furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus
se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation
? Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. [...] |
Évidemment, la Belgique s'est estimée insultée, tandis que le
fossé se creusait entre l'ancienne puissance coloniale et le nouveau pays. Au
lendemain de l'indépendance, les Européens furent forcés de quitter
l'Afrique. Des milliers de colons et de soldats belges revinrent en Belgique et
durent être reclassés. Ce sont les conséquences du retour des Belges au pays qui
eurent des répercussions par la suite.
En effet, afin de redresser les finances de l'État, le premier
ministre Gaston Eyskens fit adopter la loi du 14 février 1961, dite Loi
d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, ou
plus simplement par dérision la «Loi unique», une loi proposant un programme
d'austérité à la suite d'un endettement public important et de la perte du Congo
belge. Cette loi suscita des remous dans les rangs libéraux et sociaux
chrétiens; elle fut à l'origine de la grève générale de l'hiver 1960-1961,
laquelle dura quatre mois. La grève fut totale en Wallonie, alors qu'elle fut
peu suivie en Flandre. C'était là une autre scission entre francophones et
néerlandophones!
À la suite de cette période troublée, de nombreux Wallons
commencèrent à être favorables à un fédéralisme qui accorderait à la Wallonie
une pleine autonomie aux plans économique et social. Cette tendance au
fédéralisme se transmit aussi en Flandre. Cependant, alors que les
revendications de la Wallonie reposaient sur des motivations socio-économiques,
celles de la Flandre portait alors essentiellement sur des raisons culturelles.
10.2 La fameuse
«frontière linguistique»
|
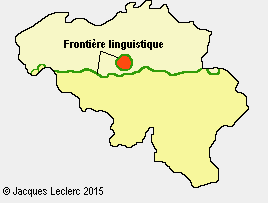 |
À partir des années 1960, la vie politique fut dominée
par le réveil des querelles communautaires entre Flamands et Wallons, ou entre
Flamands et francophones bruxellois. Le
compromis de la frontière linguistique évoluant au rythme des consultations
populaires décennales ne convenait plus aux Flamands qui voyaient les
francophones «agrandir» leur territoire de quelques kilomètres tous les dix ans.
De là, est venu leur objectif d’établir une
frontière linguistique
définitive (voir la carte).
Certains bourgmestres flamands (278, soit près du quart) avaient refusé de
distribuer les formulaires qui comprenaient des questions d'ordre linguistique,
car un tel formulaire avait révélé treize ans plus tôt la progression de la
«tache d’huile» francophone à partir de Bruxelles.
|
Devant le mouvement de contestation
flamande, la loi du 24 juillet 1961 (litt.: «Loi
du 24 juillet 1961 prescrivant l'exécution en 1961 des recensements généraux de
la population, de l'industrie et du commerce») entérinerait le «refus flamand» et
prescrirait à l'article 3 le recensement concernant l'emploi des langues
|
Loi du 24
juillet 1961
Article 3
Par dérogation aux dispositions de
la loi du 28 juin sur l'emploi des langues en matière
administrative, le recensement général de la population de 1961 ne
comporte aucune question relative à l'emploi des langues; les effets
du recensement effectué le 31 décembre 1947 sont prorogés jusqu'à ce
que qu'une loi y mette fin. |
En fait, cet article 3 énonçait que la loi qui organisait le
recensement décennal de la population, lequel aurait dû avoir lieu en 1961,
supprimait le recensement linguistique «jusqu'à ce que qu'une loi y mette fin».
En supprimant le volet linguistique du recensement général, la loi du
24 juillet 1961 a eu pour effet de «figer» la situation linguistique des
municipalités et des communes qui, sans cette loi, auraient pu adapter leur
régime linguistique en conformité avec les langues parlées par leurs habitants.
Selon certaines interprétations, cet article 3 de la loi de 1961 ne signifierait pas que les recensements
linguistiques soient interdits en Belgique. La loi ne ferait qu’interdire les
recensements linguistiques reliés au recensement général décennal. Cette
interprétation a toujours fait l'objet de controverses. Quoi qu'il en soit,
depuis la loi loi du 24 juillet 1961, il n'y a plus eu de données
officielles relatives à l'usage des langues en Belgique. De plus, l'article 20
de l'arrêté royal du 3 novembre 1961 (Moniteur belge du 18 novembre) a
même interdit aux communes d'effectuer un classement et un comptage des
bulletins de recensement en fonction de la langue employée; l'arrêté fixait
aussi la date précise du recensement général au 31 décembre 1961.
Le pays connut ensuite une autre période de revendications
flamandes jusqu'à ce qu’une loi traçât définitivement la frontière
linguistique en consacrant l'unilinguisme de la Flandre et celui de la Wallonie,
de même que le bilinguisme de la région de Bruxelles-Capitale. La
loi du 8
novembre 1962, qui entrait en vigueur le 1er
septembre 1963, fixait définitivement la frontière linguistique entre la
Flandre et la Wallonie. La date est historique, car elle consacrait
l'existence d'une séparation intangible au sein d'un même pays.
Cette loi, conçue dans un État unitaire, annonce le long cheminement
fers le fédéralisme.
À la suite du rapport Harmel, 24 communes flamandes (23 250
habitants) ont été détachées de leur province wallonne et rattachées à une
province flamande ou à un arrondissement flamand dans la province du Brabant. De
plus, 25 communes wallonnes (87 450 habitants) qui faisaient partie d’une
province flamande ont été transférées à une province wallonne ou à un
arrondissement wallon dans la province du Brabant.
La loi de 1962 prévoyait aussi des «accommodements» pour les
Flamands et les Wallons résidant dans les communes mixtes appelées familièrement «communes à facilités»,
offrant une cohabitation bilingue dans ces communes de part et d'autre de la
frontière linguistique.
En
raison des problèmes reliés à la mauvaise crédibilité des recensements, ce
ne sont pas ceux de 1930 et de 1947
(sans valeur scientifique
parce qu’ils généraient des conséquences administratives, ce qui faussait le
jeu, mais les recensements précédents ne l’étaient guère plus)
qui ont
déterminé les communes à facilités, mais les études menées sur le terrain
par le Centre Harmel: selon que la majorité s’était déclarée de langue
néerlandaise ou française, la commune faisait partie de la Flandre ou de la
Wallonie. En réalité, la fameuse «frontière
linguistique» fut fixée en deux
temps: une première fois en 1962 pour la Flandre et la Wallonie, une seconde
fois en 1963 pour délimiter la région bilingue de Bruxelles, placée comme un
«îlot» en Flandre, car seulement 3,5 km séparent Bruxelles de la Wallonie en
passant par la commune de Rhode-Saint-Genèse.
|
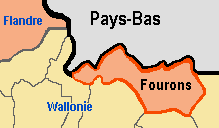 |
Dans la province de Liège, le cas des
Fourons (ou Voeren en
néerlandais), peuplés d'environ
5000 habitants, suscita des débats houleux au Parlement belge. Consultés par le
Conseil provincial de Liège, les habitant des Fourons se déclarèrent majoritairement en
faveur de leur maintien dans la région de langue française avec des facilités
pour les néerlandophones. Pendant que 15 000 Wallons manifestaient à Liège, plus
de 50 000 Flamands défilaient à Bruxelles.
Le Parlement trancha avec une majorité de 130
voix, mais seulement 20 Wallons et 13 Bruxellois s'étaient prononcés pour le
transfert à la province flamande du Limbourg.
|
|
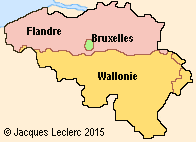 |
Ces décisions parurent contestables pour les francophones
qui remirent en question la valeur scientifique des études, notamment dans les
six communes
des Fourons. Évidemment, par la suite, il y eut des tractations et des
manœuvres politiques. Pour les Flamands,
l'établissement de la frontière linguistique de 1962 constituait une
avancée importante: l'agglomération bruxelloise était clairement définie
et limitée à 19 communes. Mais, pour les Flamands, la frontière
linguistique consolidait les «conquêtes» francophones, notamment dans
l'agglomération bruxelloise. En
bout de ligne, la Belgique se trouvait dotée de deux zones
officiellement unilingues: la Flandre néerlandaise au nord et la Wallonie
francophone au sud. Et à ce sujet, les Flamands et les Wallons étaient
d'accord! |
10.3 Les communes «à facilités» de 1962
Soulignons que les textes juridiques belges qualifient toujours de
communes
à régime linguistique spécial, ce que les citoyens ordinaires appellent
généralement des communes à facilités. Ces communes dites «à
facilités» — juridiquement non reconnues en tant que communes bilingues —
auraient été prévues pour faciliter l’intégration des francophones en
Flandre et des Flamands en Wallonie. La loi du 8 novembre 1962 prévoyait cinq
catégories de communes qui pourraient déroger à la règle de l’unilinguisme
territorial (avec un minimum de 30 % de minorités) sans acquérir pour
autant le statut de communes bilingues (sauf à Bruxelles). Les chiffres
entre parenthèses indiquent le nombre de communes avant la fusion de 1978:
|
Communes
de langue |
Facilités
pour : |
Nombre |
Communes |
2000 |
|
Néerlandaise |
francophones |
12
(17) |
Bever (Biévène)
Drogenbos
Herstappe
Kraainem (Crainhem)
Linkebeek
Mesen (Messines)
Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse)
Ronse (Renaix)
Spiere-Helkijn
(Espierre-Helchin)
Voeren (Fourons)
Wemmel
Wezembeek-Oppem
|
1 980
4 693
85
12 692
4 752
964
17 998
23 849
1 858
4 315
13 932
13 622
|
|
Française |
néerlandophones |
4
(13)
|
Comines (Komen)
Enghien (Edingen)
Flobecq (Vloesberg)
Mouscron (Moeskroen)
|
17 564
10 863
3 194
52 492
|
|
Française |
germanophones |
2
(6)
|
Malmedy (Malmünd)
Waimes (Weismes)
|
11 149
6 503
|
|
Allemande |
francophones |
9
(25)
|
Amel (Amblève)
Büllingen (Bulange)
Bütgenbach (Butgenbach)
Burg-Reuland
Eupen
Kelmis (la Calamine)
Lontzen
Raeren
Sankt-Vith (Saint-Vith)
|
5 069
5 287
5 550
3 787
17 516
10 121
5 010
9 550
8 941
|
|
Française |
néerlandophones
et germanophones
|
3
(9)
|
Baelen (Balen)
Plombières (Bleiberg)
Welkenraedt (Welkenraat)
|
3 852
9 361
8 801
|
Évidemment, cette sorte d'accommodement suscita un conflit idéologique entre
la conception des francophones et celle des néerlandophones en ce qui concerne
la notion des mots «nation» et «peuple». Pour les néerlandophones, la nation
est délimitée par le territoire où est parlée une langue donnée. Par exemple, en
France, c'est le français; en Allemagne, c'est l'allemand; en Italie; c'est
l'italien, etc. Pour les francophones de Belgique, la langue du citoyen est
celle que doivent utiliser les administrations, peu importe où ils résident sur
le territoire. Autrement dit, les néerlandophones privilégient les droits
territoriaux, les francophones les droits personnels. Or, les droits
territoriaux sont plus sécurisants pour une minorité, alors que les droits
personnels sont moins contraignants pour une majorité. Il était donc normal que
les droits territoriaux prévalent en Flandre et que les droits personnels soient
préférés par les francophones.
Au plan géographique, il est possible de résumer les communes à facilités en trois
types:
1) Les
six communes de la périphérie bruxelloise:
Kraainem/Crainhem; Drogenbos; Linkebeek; Sint-Genesius-Rode / Rhode-Saint-Genèse;
Wemmel; Wezembeek-Oppem.
2) Les
dix communes de la «frontière linguistique»
dont six en Flandre avec facilités en français (Mesen /
Messines; Spiere-Helkijn / Espierres-Helchin; Ronse / Renaix; Bever / Biévène;
Herstappe; Voeren / Fourons) et quatre en Wallonie avec facilités en néerlandais
(Comines / Komen; Mouscron / Moeskroen; Flobecq / Vloesberg; Enghien /
Edingen).
3) Les
communes malmédiennes avec facilités
limitées en allemand.
- La rapport Harmel de 1958
|
 |
Pierre Harmel (1911-2009) était un député
social-chrétien à la Chambre des représentants. Il a fondé en 1947
un «centre de recherche pour la solution nationale des problèmes
sociaux et juridiques dans les régions wallonne et flamande». Ce
centre était formé de 23 membres néerlandophones et de 22 membres
francophones; il portait le nom de son initiateur, Pierre Harmel,
qui deviendra premier ministre du 28 juillet 1965 au 19 mars 1966.
Le Centre Harmel a anticipé dans
les années 1950 la nécessité d'une réforme de l'État.
Le rapport Harmel fut déposé le 25 avril 1958 au
Parlement belge avant d'être publié. Le rapport allait servir de base pour les négociations sur les lois
linguistiques de 1962-1963, ainsi que pour la révision de la Constitution de
1970. Le rapport de Pierre Harmel était bilingue: à droite le texte français, à gauche le
texte néerlandais, les deux versions ayant la même valeur juridique.
|
Les
conclusions de la «section politique» (le Centre était divisé en trois sections
qui traitaient des problèmes spécifiques: une «section politique», une «section culturelle» et une
«section économique») furent les suivantes:
|
1) Il existe au sein de la nation belge deux communautés culturelles et
linguistiques: la communauté wallonne et la communauté flamande;
2)
Ces deux communautés sont homogènes et ce caractère doit être
respecté. Les Flamands qui s’établissent en Wallonie, et les Wallons qui s’établissent
en Flandre doivent s’adapter au milieu;
3) Par voie de conséquence, tout organisme public ou institutionnel privé
remplissant une mission d’intérêt public, doit être, en principe,
français en Wallonie, et néerlandais en Flandre;
4)
L’agglomération bruxelloise doit être le bien commun de la
communauté wallonne et de la communauté flamande. Wallons et Flamands
doivent y jouir de droits culturels égaux. Leur individualité doit y être
respectée et les moyens doivent leur être donnés de la maintenir et de la
développer. (Chapitre III, F – c, § I, p. 266).
|
Les conclusions de la «section culturelle» (Chapitre I, p. 309) sont les
suivantes:
|
1) Les principes ont fait l’objet d’un accord unanime de ses membres et
peuvent se résumer comme suit:
2) Il existe en Belgique deux communautés culturelles : la communauté
wallonne et la communauté flamande;
3) La première est de langue française, la seconde de langue
néerlandaise;
4) Les deux communautés doivent être homogènes : en aucun cas, l’État
ne saurait encourager la constitution ou le maintien de minorités
linguistiques dans l’une ou l’autre communauté;
5) Il n’existe pas de communauté culturelle bruxelloise;
6) Il existe cependant une entité bruxelloise, bien commun des deux
communautés culturelles, dans laquelle Wallons et Flamands doivent pouvoir
conserver leurs caractères propres.
|
Il était clair que les deux grandes régions linguistiques
devaient demeurer homogènes, sans le maintien de «minorités linguistiques». Ces principes sont repris à la page suivante (p. 310):
|
1) La communauté wallonne et la communauté flamande doivent être
homogènes. Les Flamands qui s’établissent en Wallonie et les Wallons qui
s’établissent en Flandre doivent être résorbés par le milieu. L’élément
personnel et ainsi sacrifié au profit de l’élément territorial;
2) Par voie de conséquence, tout l’appareil culturel doit être
français en Wallonie et néerlandais en Flandre;
3) La communauté wallonne et la communauté flamande doivent conserver
les enfants nés respectivement en Wallonie et en Flandre et émigrés à
Bruxelles, de même que ceux qui sont nés à Bruxelles de parents
originaires de Wallonie et de Flandre. Dans la capitale, l’élément
personnel doit l’emporter sur l’élément territorial.
|
Les auteurs du rapport Harmel espéraient probablement que les minorités s’assimileraient et que les problèmes se
résoudraient d’eux-mêmes après plusieurs années, mais les faits allaient
démontrer que ce n'était guère le cas. Les conclusions du rapport ne furent pas
reprises intégralement dans les lois de 1962 et de 1963. Pendant que les
néerlandophones restaient convaincus que les «communes à facilités» étaient
temporaires et destinées à disparaître progressivement en raison de
l'assimilation des minorités, les francophones, pour leur part, croyaient que
ces «facilités» étaient définitives et qu'elles leur accordaient des droits
linguistiques permanents et immuables. Cette interprétation divergente allait constituer plus tard une
source de nouveaux conflits, notamment dans la région de Bruxelles-Capitale.
- Le compromis de Val-Duchesse (1963)
En définitive, le refus des recensements linguistiques fut un déclencheur du
réveil flamand qui amenait le «compromis de Val-Duchesse», le château où eurent
lieu les négociations entre Flamands et francophones concernant les «facilités».
|
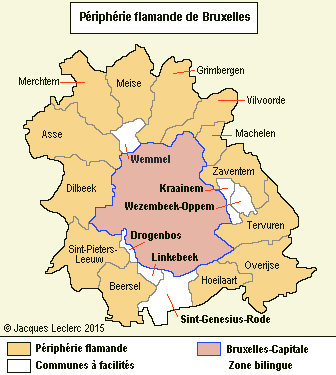 |
Le 5 juillet 1963, une délégation de
politiciens se réunissait au château de Val-Duchesse afin de trouver
une solution à une autre crise communautaire, dont la problématique
de la périphérie bruxelloise. La minorité francophone, qui s'était
installée dans cette zone frontière entre l'unilinguisme et le
bilinguisme, demandait un statut protégé.
Comme rien n'est simple en Belgique, trois grands
blocs s'opposaient. D'une part, les francophones radicaux prônaient
une zone bruxelloise bilingue aussi grande que possible; d'autre
part, les militants flamands exigeaient le maintien de la frontière
linguistique unilingue et une délimitation stricte de Bruxelles.
Enfin, les partisans de la Belgique proposaient un compromis qui
pouvaient réconcilier les principes de la territorialité et des
droits linguistiques personnels.
Le compromis finalement conclu prévoyait
l’introduction d’un «régime de facilités linguistiques» dans six
communes de la zone périphérique du Brabant flamand : Drogenbos,
Kraainem (Crainhem), Linkebeek,
Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse), Wemmel et Wezembeek-Oppem.
Au total, l'agglomération de Bruxelles comptait 19 communes
flamandes situées autour de la Périphérie flamande. Les six
«communes périphériques» à facilités font partie de ce groupe de
communes. |
Dans les faits, cela signifiait que les francophones de ces communes
unilingues néerlandophones avaient le droit d’utiliser leur langue dans le
domaine administratif. De plus, les francophones avaient droit à un enseignement
maternel et primaire en français, bien que la direction et le personnel de ces
écoles étaient tenus d'utiliser le néerlandais dans leur administration. Il est
important de noter que la plupart des dérogations devaient intervenir à la
demande expresse des administrés, et non pas des administrateurs. De plus, les
droits linguistiques octroyés aux résidants francophones étaient alors
considérés comme temporaires; c'était une mesure d'exception destinée à
faciliter leur intégration définitive. Cependant, francophones et
néerlandophones n'ont jamais interprété ces mesures de la même façon. Pour les
uns, ces mesures constituaient des droits permanents; pour les autres, des
exceptions temporaires.
Ce fameux «compromis» allait
jeter les bases d'une réforme de l'État belge à deux et à trois composantes. Du côté des Flamands, il fallait se
résigner à ce que les francophones de la périphérie bruxelloise puissent
demeurer officiellement des francophones ayant le droit de ne pas parler le
néerlandais. Chez les francophones, il leur fallait vivre avec les conséquences
d'un compromis qui les rabaissait au statut de minorité en territoire flamand.
Le compromis signifiait pour les Flamands que les francophones de Flandre
obtenaient un statut officiel (temporaire); pour les francophones, le compromis
entraînait la néerlandisation totale de la Flandre et au carcan du bilinguisme
imposé à Bruxelles. Au final, néerlandophones et francophones n'ont jamais
véritablement accepté de vivre avec les conséquences du «compromis». De fait, Il
est encore possible aujourd'hui pour des francophones de vivre dans des communes
néerlandaises à facilités, sans jamais apprendre le néerlandais et sans montrer
le moindre intérêt à le faire.
Le compromis conclu à Val-Duchesse s’est traduit par la loi
du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative. Cette loi
venait venait compléter la
Loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative.
Ces deux lois linguistiques ont été harmonisées par l’arrêté
royal du 18 juillet 1966.
|
Résumé de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière
administrative
Dans des affaires
administratives:
La loi du 2 août 1963 énonçait que,
dans les communes à facilités, les relations entre l'administration
communale et les citoyens doivent se dérouler en néerlandais ou en
français, selon le souhait du citoyen concerné. Les avis et autres
documents de la commune doivent être rédigés dans les deux langues,
la priorité étant accordée au néerlandais. Les formulaires, actes,
permis et autres documents administratifs doivent être disponibles
dans les deux langues ou être rédigés en français ou en néerlandais,
selon le choix du citoyen. Le régime des facilités s'applique
uniquement aux communications entre l'autorité communale et les
administrés à titre individuel, et non pas aux administrateurs
communaux. En d'autres termes, les conseils communaux et les
collèges des échevins dans les six communes à facilités ne peuvent
se dérouler qu'en néerlandais.
Voir à ce sujet les articles 23 à 30 de
l'arrêté royal du 18 juillet
1966.
Dans l'enseignement:
L'enseignement dans les communes à
facilités doit se faire en néerlandais, mais il est possible
d'organiser un enseignement en français uniquement pour
l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Ces écoles
maternelles et fondamentales sont organisées par la Communauté
flamande à la demande d'au moins 16 parents francophones habitant
dans la commune concernée. |
D'après l'arrêté royal du 18 juillet
1966, il y avait des dispositions particulières aux services locaux
établis à Drogenbos, à Kraainem, à Linkebeek et à Wemmel (art. 28),
ainsi que d'autres dispositions particulières à Rhode-Saint-Genèse et à
Wezembeek-Oppem (art. 30 et 31).
- L'Université catholique de Louvain
|
 |
En 1963, l'endiguement de la langue française, tant souhaité par les Flamands,
semblait acquis, mais le conflit linguistique a rebondi en 1968 à propos de
l'Université catholique de Louvain, demeurée bilingue et non encore
néerlandisée. De violentes manifestations exigèrent le départ des
francophones aux cris de Walen buiten («Wallons dehors») et de Leuven
Vlaams («Louvain aux Flamands»). Dans les années 1970, les
Québécois, eux, criaient «le Québec aux Québécois».
|
Rappelons qu’au
cours de ces années tumultueuses des étudiants francophones invitaient à
Louvain un ancien premier ministre (1950), le Wallon Jean Duvieusart (1900-1977), qui défendait dans
ses discours le statut bilingue de Louvain et osait déclarer: «Un Wallon qui
apprend le flamand est un Wallon dénaturé.» Ces mêmes étudiants chantaient «la
Marseillaise» sur le balcon de l’hôtel de
ville de Louvain; des professeurs francophones demandaient la fondation des
écoles secondaires en français à Louvain. Pour les Flamands, il s’agissait là de
véritables provocations, et ce, très peu de temps après la fixation de la
frontière linguistique.
Finalement, l’Université de Louvain fut coupée en deux
et sa composante française déménagea dans la province du Brabant wallon: ce fut
la création de l'Université de Louvain-la-Neuve. Cette séparation fut très
durement ressentie par les francophones et cet épisode marqua le début de la fin
des partis nationaux. La bière Stella Artois qui se brassait auparavant à
Louvain est aujourd'hui brassée à Leuven.
-
Fermeture des écoles francophones en Flandre
La loi du 2 août 1962 sur
l’enseignement fit fermer les écoles francophones qui existaient encore dans la
région de langue néerlandaise; la loi énonçait aussi que, dorénavant, seuls les
enfants dont les parents étaient domiciliés dans les «communes à facilités»
pouvaient s'inscrire dans les écoles francophones de ces communes. Insatisfaits
de cette loi estimée discriminatoire ainsi que des fermetures d’écoles, des
parents francophones de Flandre introduisirent un recours contre cette loi
devant la Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg.
Dans son arrêt du 23 juillet 1968, la Cour débouta les
plaignants, car il n’y avait pas eu de violation des droits de l’homme du seul
fait que la loi obligeait une école francophone à fermer ses portes en région
unilingue flamande. Le clivage entre les deux communautés gagna ensuite les
formations politiques traditionnelles qui éclatèrent.
Devant tant de haine
linguistique, certains se demandent ce que signifie en définitive l’expression
pourtant répandue dans le monde de «compromis à la belge». Cette expression
signifie simplement que, dans les zones de conflits ethniques, linguistiques ou
religieux, il est toujours possible de rechercher des solutions parfois très
compliquées, voire difficilement applicables, mais qui évitent les bains de
sang. En fait, s'il a coulé du sang dans les Fourons, jamais la Belgique
n’a eu à déplorer un seul mort à cause des querelles linguistiques.
Sous la pression tant des
Flamands que des Wallons, l'idée s'imposa qu'il fallait modifier de façon
fondamentale les structures politiques de la Belgique. Toutefois, il a fallu
attendre les réformes constitutionnelles de 1970-1971 et celles de 1980 pour
transformer la Belgique en un État communautaire et régionalisé, puis celles
du 1er janvier 1989 et du 15 février 1994
pour en faire un État fédéral.
Au
cours de cette période, les Flamands durent batailler ferme pour obtenir la
communautarisation du pays. De leur côté, les Wallons durent faire de même
pour obtenir la régionalisation économique et les Bruxellois durent
batailler de leur côté pour être reconnus par la Flandre comme une «Région»
à part entière. Dans l’ensemble des partis politiques, les partisans du
maintien d’un État unitaire firent face à ceux qui voulaient plus de pouvoir
pour les entités communautaires et régionales.
Comme rien n'est simple dans ce pays, les Belges ne
pouvaient pas se contenter d'un système fédéral, par exemple tel qu'il
existe en Allemagne ou au Canada; la difficulté provient que les frontières
linguistiques ne recouvrent pas les mêmes réalités géographiques.
L'originalité et la complexité du fédéralisme belge reposent sur un double
système de régions et de communautés linguistiques. La Belgique compte trois
régions géographiques (Flandre, Wallonie et Bruxelles), ainsi que trois
communautés qui se superposent aux régions: la Communauté flamande, la
Communauté française et la Communauté germanophone.
11.1 Communautés et régions
|
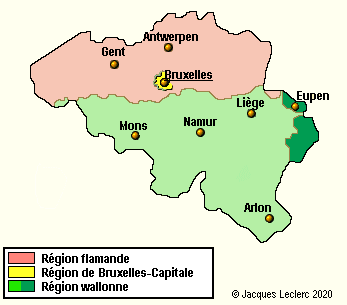 |
En 1970, le Parlement fédéral marquait son accord sur le texte de la
Constitution révisée. On établit d’abord les quatre régions
linguistiques (Titre I, article 3bis), ensuite les trois communautés
culturelles (Titre III) et, pour finir, les trois régions (chapitre IIIter).
La Constitution révisée déterminait aussi les compétences des Communautés
linguistiques (section III, article 59, § 2 et 3).
La Belgique a donc été partagée en
trois communautés (française, flamande et allemande) et trois régions
(la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise).
L’année 1980 a
vu la définition des compétences régionales (aménagement du territoire,
logement, politique économique, etc.). En 1988-1989, l'enseignement a été
communautarisé. En 1993-1994, on a élargi les compétences (agriculture,
commerce extérieur, programmes sociaux, etc.) et accru les moyens financiers
des gouvernements et parlements (communautaires et régionaux); et les
conseillers régionaux ont été élus au suffrage universel. |
Depuis les accords
de Lambermont (votés le 7 juin 2001), les moyens financiers des
Régions et Communautés ont été élargis une fois de plus (surtout les
Communautés ont été les principaux bénéficiaires); l’État fédéral a
transféré encore quelques-unes de ses compétences, notamment les compétences résiduelles
relatives à l’agriculture, l’organisation et le contrôle sur les communes
et provinces et le commerce extérieur. De plus, les Régions peuvent
désormais disposer de certains moyens financiers d’une façon plus libre (en
vertu de l’«autonomie fiscale»). Donc, avec la législation de 2000-2001, la
Belgique a connu la cinquième phase de la réforme de l’État. Il est
probable que dans l’avenir l’État belge connaîtra d’autres réformes.
Déjà, dans certains milieux wallons, on aimerait bien que la Communauté
française disparaisse au profit de la Wallonie; certains membres du
gouvernement wallon considèrent comme anormal le fait de financer à 80 % des
projets de la Communauté française et d'être constamment ignorés de la part
de ce même gouvernement communautaire. Après 25 ans de réformes constitutionnelles, on peut affirmer que la Belgique
a davantage changé qu’aucun autre pays occidental, démocratique et industriel.
11.2 La séparation territoriale
|
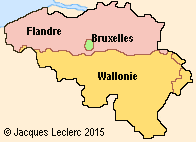 |
Le principe de la séparation territoriale des langues est maintenant scellé
par la partition du pays en quatre zones ou régions linguistiques. La Belgique
compte aujourd’hui trois langues officielles: le néerlandais, le français,
l'allemand.
Le pays comprend également, rappelons-le, trois communautés (la
Communauté française, la Communauté néerlandaise et la Communauté
germanophone) et trois régions (la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale). |
Pour enrayer le mouvement, qui menaçait
d'extinction la minorité bruxelloise néerlandophone et conduisait à une fusion
géographique du Grand-Bruxelles avec la Wallonie, les Flamands ont obtenu, d’une
part, que l'agglomération bruxelloise, limitée à 19 communes, reste
officiellement bilingue, d’autre part, que les communes ceinturant
l'agglomération demeurent flamandes (dans six d'entre elles, la population de
langue française dispose de «facilités»). Or, les nationalistes flamands
voudraient bien que Bruxelles revienne à la Flandre, mais beaucoup de Bruxellois
francophones s'y opposent farouchement; même la plupart des Bruxellois flamands
s’y opposent. Dans les années quatre-vingt, le président du FDF (Front
démocratique des francophones, parti francophone bruxellois), André Lagasse,
développa l’idée d’un «corridor francophone» (Kraainem, Wezembeek-Oppem et
Rhode-Saint-Genèse) qui devrait fusionner l’agglomération bruxelloise avec la
Wallonie. Depuis lors, l’idée a commencé à se répandre, mais on devine les
conflits en perspective!
Mais les ténors de la
politique belge considèrent cette idée comme farfelue.
Cela dit, il convient de distinguer deux types de
«régions»:
1) les quatre régions linguistiques
(la région de langue française, la région de langue néerlandaise,
la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue
allemande), qui correspondent à des frontières linguistiques;
2) les trois gouvernements
régionaux s'occupant d'affaires régionales: la Région flamande, la
Région bruxelloise et la Région wallonne.
Quant aux provinces et aux communes, elles ne disposent d'aucune juridiction en matière de langues, si ce
n'est par les écoles. Cependant, les autorités provinciales doivent appliquer
les lois linguistiques prescrites par la législation belge, ainsi que les
décrets de leur communauté et région respectives. Au
plan juridique, une commune peut faire tout ce qui ne lui est pas interdit, mais
elle est contrôlée par les autorités de tutelle, telles que la
Communauté, la Région et la province.
Entre la Constitution de 1831 et celle de 1993, le statut
des langues s'est vu radicalement modifier en Belgique. La liberté linguistique
individuelle a fait place à une obligation collective! D'un État unitaire, la
Belgique est devenue un État fédéral.
Au matin du 1er août 1993, la Belgique
apprenait le décès du roi Baudouin (d'un arrêt cardiaque), alors qu'il se
trouvait dans sa propriété de Motril en Espagne avec la reine Fabiola. C'était
dix jours plus tard, après avoir inauguré les cérémonies du 21 Juillet, jour de
la Fête nationale. L'annonce publique de la mort de Baudouin provoqua une vague
d'émotion populaire en Belgique qui connut un sursaut inattendu d'unité
nationale. Mais l''année 1993 ne se résume pas seulement à la
disparition de roi Baudouin, mais aussi à celle d'une certaine conception de la
Belgique. De la crise liée à la «question royale» jusqu'à l'instauration du
fédéralisme, Baudouin a accompagné plus de quatre décennies d'évolutions
politiques, sociales, nationales et internationales.
11.3 L'arrondissement judiciaire de Bruxelles
L'arrondissement judiciaire de Bruxelles a été créé lors de l'adoption de la Loi sur
l'organisation judiciaire du 18 juin 1869. À cette époque, l'arrondissement
comprenait les communes suivantes: Assche, Bruxelles 1er
canton, Bruxelles 2e canton, Hal, Ixelles,
Lennick-Saint-Quentin, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Vilvorde et
Wolverthem. L'arrondissement fut ensuite désigné comme l'«arrondissement judiciaire de
Bruxelles-Halle-Vilvorde» (en néerlandais:
Brussel-Hal-Vilvoorde).
C'était le seul
arrondissement judiciaire de
la Belgique, qui se prolongeait sur deux
régions : d'une part, la
Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, la
Région flamande dans la
province du Brabant.
|
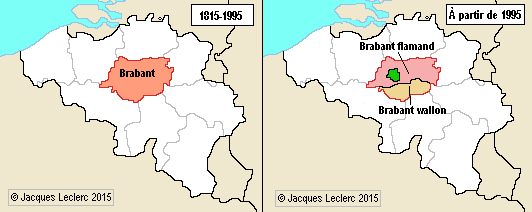 |
En 1989, les partis politiques flamands
ont exigé la scission de la province du Brabant qui existait
depuis 1815.
En 1995, l'ancienne
province du Brabant disparut pour faire place à deux nouvelles provinces: le
Brabant flamand au nord et le Brabant wallon au sud.
Pour les francophones, il s'agissait
d'un autre «plan flamand» destiné à encercler Bruxelles et à étouffer
les francophones de la périphérie. Pour les Flamands, il fallait
éviter la fameuse «tache d'encre» francophone qui s'étend à Bruxelles.
|
|
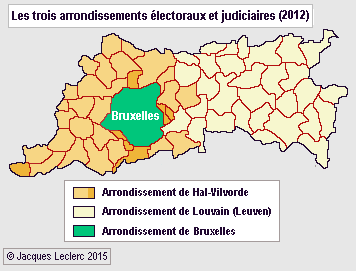 |
Finalement, la
Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles
(loi du 19 juillet 2012) redécoupait la défunte province du Brabant en trois arrondissements
électoraux: l'arrondissement du Brabant wallon et l'arrondissent du Brabant flamand, dans
leurs
limites territoriales conformes à celles des deux provinces, ainsi que
l'arrondissement de
Bruxelles, limité au territoire des 19 communes qui en font partie.
Dans
l'arrondissement du Brabant flamand, les électeurs des six communes à facilités
linguistiques (Drogenbos, Kraainem ou Crainhem, Linkebeek,
Sint-Genesius-Rode
(Rhode-Saint-Genèse),
Wemmel et Wezembeek-Oppem) sont désormais réunis dans un même «canton électoral»;
ces électeurs
pourront voter soit pour une liste de la circonscription de Bruxelles, soit pour
une liste du Brabant flamand. |
La loi du 1er
décembre 2013 (Loi
portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire
en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire), en
particulier les articles 109-118, faisait disparaître les 27 arrondissements
judiciaires pour n'en compter plus que douze; tous les tribunaux
de première instance et les tribunaux de police sont incorporés dans l'un de ces
douze arrondissements (voir la
carte de l'arrondissement judiciaire). Les arrondissements judiciaires coïncident désormais avec les
frontières des provinces, avec des arrondissements distincts pour Bruxelles et
Eupen, ainsi que Louvain et Nivelles (devenu «Brabant wallon».
|
1. Flandre occidentale (Bruges
- Courtrai - Furnes - Ypres)
2. Flandre orientale (Gand - Termonde - Audenarde)
3. Anvers (Anvers - Turnhout - Malines)
4. Limbourg (Hasselt - Tongres)
5. Brabant wallon
6. Hainaut (Mons - Tournai - Charleroi) |
7. Namur (Namur - Dinant)
8. Luxembourg (Marche – Neufchâteau – Arlon)
9. Bruxelles
10. Louvain
11. Liège (Liège - Verviers - Huy)
12. Eupen |
Toutefois, à l'intérieur de l'arrondissement de Bruxelles,
appelé aussi «arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde», il faut
distinguer le «parquet bilingue» à Bruxelles et le «parquet de BHV».
Le parquet bilingue est dirigé par un procureur
francophone bilingue, assisté d'un adjoint néerlandophone, alors que le parquet
de Hal-Vilvorde, également bilingue, est dirigé par un procureur néerlandophone,
assisté d'un adjoint francophone. Les justiciables francophones de Hal-Vilvorde
peuvent s'y défendre dans leur langue auprès de magistrats francophones
bilingues détachés du «parquet de Bruxelles». L’usage du français en justice,
lié à l’appréciation du juge, est garanti.
Dans les communes à facilités, les droits
électoraux sont reconnus pour l’élection de la Chambre des représentants et du
Parlement européen; il est possible de voter pour des listes de Bruxelles ou du
Brabant flamand (Hal-Vilvorde et Louvain) où des francophones peuvent continuer
à se présenter. Les Bruxellois ne pourront plus voter pour les listes de
Hal-Vilvorde. L'ensemble des droits linguistiques ne pourront être remis
en cause que par un vote à majorité spéciale du Parlement fédéral.
Si d'aventure la Flandre devait devenir
indépendante, la frontière de l'État flamand serait
dorénavant «bétonnée» et plus difficilement contestable.
C'est là l'objectif des nationalistes flamands qui, de toute
façon, veulent «l'euthanasie de la Belgique».On peut
consulter à ce sujet les lois suivantes:
- 2012 :
Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
- 2013 :
Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code
judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire
;
- 2014:
Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de
Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et
l'arrondissement du Hainaut (loi du 28 mars 2014);
- 2014:
Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires en
vue de leur mise en concordance avec la réforme des arrondissements
judiciaires (arrêté du
26 mars 2014).
11.4 Plus rien comme avant
Le successeur de Baudouin,
Albert II, a prêté serment devant les Chambres réunies, le
9 août
1993, en néerlandais, en français et en allemand. Avec le nouveau règne qui
commençait, Albert II et les Belges étaient conscients que rien ne serait plus jamais comme avant.
|
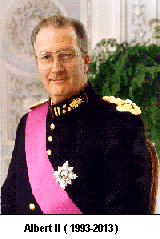 |
D'un
point de vue historique, la famille royale de Belgique est
francophone, comme
le reste de la noblesse et de la bourgeoisie, mais elle doit assumer
le rôle d'arbitre et être linguistiquement «asexuée». Elle doit s'efforcer,
au nom de ses obligations constitutionnelles, de refléter le
caractère bilingue, sinon trilingue du pays, tant dans ses
manifestations officielles que dans l'apprentissage des langues chez
les princes. Ainsi, Albert II commençait toujours ses discours
adressés à toute la Belgique en néerlandais, pour continuer ensuite
en français, puis en allemand.
Pour un certain nombre de
Flamands, la
famille royale constituerait un obstacle majeur à leurs objectifs,
cette famille étant non seulement perçue comme francophone et
francophile, mais aussi anti-flamande.
Beaucoup de Flamands reprochaient à la reine Paola, l'épouse
d'Albert II d'origine italienne, de parler très mal le néerlandais,
sans compter les princes,
Philippe (devenu roi des
Belges) et Laurent, incapables de soutenir une conversation
«décontractée» en néerlandais. Cette
mauvaise connaissance
généralisée du néerlandais de la part des membres de la famille
royale était considérée comme «une véritable honte» aux yeux
des
extrémistes
Flamands. De son côté, la presse belge semble s'affranchir de
l'attitude réservée qui était la sienne sous le règne de Baudouin. |
Le 21 juillet 2013, Philippe (duc
de Brabant) est devenu le nouveau roi des Belges, juste après l'abdication de
son père Albert II à 79 ans. Il a déclaré en
néerlandais d'abord, puis en français et en allemand, les trois langues
nationales : «Je jure d’observer la
Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale
et l’intégrité du territoire.»
|
[...] La
richesse de notre pays et de notre système institutionnel réside
notamment dans le fait que nous faisons de notre diversité une
force. Nous trouvons chaque fois l’équilibre entre unité et
diversité. La force de la Belgique est justement de donner un sens à
notre diversité. La nouvelle réforme de l'État réalise un transfert
de compétences important aux entités fédérées. Cela rapprochera les
citoyens de la prise de décisions. Cela permettra de mieux
rencontrer les défis de l'avenir. La force de la Belgique réside
également dans ses entités fédérées. J’entends entretenir des
contacts constructifs avec leurs responsables. Je suis convaincu que
la coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions
s’opérera au plus grand bénéfice de nos citoyens et de nos
entreprises. [...] Vive la Belgique ! Leve België ! Es lebe Belgien. |
|
 |
Cependant, certains Flamands ne semblent pas avoir apprécié l'intronisation
du roi Philippe. Le chef du parti indépendantiste flamand (le Nieuw-Vlaamse
Alliantie) et bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, a décliné l’invitation aux
cérémonies, et plusieurs élus de ce parti républicain n'ont pas applaudi le roi
après sa prestation de serment. Cependant, contrairement aux deux prestations de serment
précédentes, celle de son oncle Baudouin en 1951 et celle de son père Albert en
1993, personne n'a cette fois-ci crié, par provocation: «Vive la République!»
Face aux défis
auxquels la Belgique est confrontée par le succès grandissant des
nationalistes flamands, ouvertement antimonarchistes et
séparatistes, la question est de savoir si Philippe se
montre à la hauteur pour naviguer dans ces eaux troubles. S'il ne réussit pas à se faire accepter par les Flamands, on se
demande quel rôle ce roi pourrait-il jouer dans un pays en
crise permanente. Le roi des Belges pourrait bien devenir le roi des
francophones belges. |
En Flandre, on considère que le roi n'est plus que
le représentant d’une dynastie francophone qui ignore totalement les réalités flamandes.
Il n'en demeure pas moins que le roi Philippe
s'exprime aisément en néerlandais avec un accent français assez prononcé; bien
qu'il parle très rarement en allemand, il prononce ses discours annuels (pour la
Fête nationale et à Noël) dans les trois langues officielles. Les enfants du roi
Philippe et de la reine Mathilde sont bilingues. Si le français est employé
comme langue d'usage à la maison, tous les enfants du roi sont scolarisés
jusqu’à 16 ans, au moins, dans des écoles néerlandophones. Ils peuvent tous
s’exprimer régulièrement en anglais. En dépit de tous leurs efforts à l'égard de
la langue néerlandaise, les membres élargie de la famille royale belge sont
encore jugés sévèrement en Flandre pour leur relative difficulté à s'exprimer en
néerlandais. En ce sens, cette
monarchie paraît légitime dans la mesure où elle représenterait la majorité de
la population de ce pays.
Pour le Conseil de
l'Europe, la Belgique constitue un cas insoluble en ce qui a trait à
la protection des minorités.
Le
modèle belge apparaît comme un cas presque unique où les deux
grandes langues officielles de l'État sont en pratique interdites
dans près de la moitié du territoire national.
La Belgique demeure l'un des rares États européens à ne pas avoir
ratifié ni la Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales
ni la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires.
Compte tenu de la
complexité des structures fédérales de la Belgique, ce n'est pas
demain que ce pays va adopter l'un de ces deux traités européens sur
la protection des minorités nationales. En effet, pour adopter
ces traités sur les minorités, il faudrait qu'ils soient ratifiés
par les sept assemblées législatives compétentes avant de pouvoir
entrer en vigueur, ce qui implique la Chambre des représentants, le
Sénat, le Conseil flamand, le Conseil de la Communauté française, le
Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Pour adopter un tel traité, il faudrait aussi que les deux grandes
communautés s'entendent. Or, la
majorité flamande ne veut reconnaître qu'une seule minorité
nationale «belge»: les germanophones. Pour les Flamands, les
francophones constituent une majorité dans leur territoire. Quant
aux francophones, ils insistent pour que les minorités francophones de Flandre
bénéficient de ce même statut de «minorité nationale», quitte à
accorder ce statut aux néerlandophones de Wallonie. Mais les
politiciens flamands craignent que des francophones de Flandre,
notamment dans la périphérie bruxelloise, utilisent ces traités
européens pour poursuivre les autorités flamandes pour non-respect
des droits des minorités.
En conséquence, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
attire l'attention sur une improbable ratification par le Royaume de
Belgique et par ses assemblées législatives compétentes, puisque
toute ratification d'un traité supposerait une protection tant au
niveau national (l'État fédéral) que régional (la Flandre et la
Wallonie). À la demande de la Commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, la Commission européenne pour la démocratie
par le droit («Commission de Venise») a étudié la question de savoir
à quels groupes la Convention-cadre, par exemple, pourrait
s'appliquer en Belgique. La Commission est arrivée à la conclusion
suivante :
|
Au
niveau régional, eu égard à la répartition des
compétences entre les diverses régions et communautés et
à la division territoriale du pays, la Commission
considère que les francophones de la région de langue
néerlandaise et de la région de langue allemande peuvent
être considérés comme une minorité au sens de la
Convention-cadre de même, d’ailleurs, que les
néerlandophones et les germanophones de la région de
langue française. |
Suivent les deux projets de résolutions suivants
(nos 16 et 17):
|
17. L'Assemblée
souscrit pleinement à l'analyse, au raisonnement et aux
conclusions de la Commission de Venise. En se fondant
sur la définition des mots "minorités nationales"
contenue dans la
Recommandation 1201
(1993), citée ci-dessus, l'Assemblée parvient à la même
conclusion. Alors que, par exemple, les francophones de
Belgique peuvent ne pas avoir besoin de la protection de
la Convention-cadre au niveau de l'État, en raison de
leur position codominante à ce niveau (et à ce niveau
seulement), ils ont besoin de cette protection dans
l'ensemble de la Flandre. L'existence de liens anciens,
solides et durables unissant les francophones à la
Belgique, et donc aussi à la Flandre, ne peut être mise
en doute, pas plus que l'existence de liens solides et
durables unissant les néerlandophones à la Belgique, et
donc aussi à la Wallonie.
18.
L'Assemblée estime donc que les groupes suivants sont à
considérer comme des minorités en Belgique dans le
contexte de la convention-cadre: au niveau de l'Etat, la
communauté germanophone; au niveau régional, les
francophones vivant dans la région de langue
néerlandaise et dans la région de langue allemande, et
les néerlandophones et les germanophones vivant dans la
région de langue française. |
Dans sa Recommandation 1492 (2001)
sur les droits des minorités nationales, l'Assemblée du Conseil de
l'Europe s'est élevée contre «la négation de l’existence de
minorités et des droits des minorités dans plusieurs États membres
du Conseil de l'Europe, et contre le fait que beaucoup de minorités
en Europe ne se soient pas vu garantir un niveau de protection
suffisant». L'Assemblée a fait figurer la Belgique parmi les pays
qui «ont des minorités significatives qui doivent être protégées et
dont les droits ne sont pas officiellement reconnus».
Autrement dit, il paraîtrait inacceptable que des néerlandophones
de Wallonie et des francophones de Flandre ne soient pas protégés
dans leur langue et leur culture. Selon le Conseil de l'Europe,
toute résolution des «querelles linguistiques» en Belgique ne
pourrait se résoudre que si toutes les parties concernées faisaient
preuve «de bonne volonté, d’ouverture, de tolérance, de pragmatisme
et de souplesse pour promouvoir une cohabitation paisible des
différents groupes linguistiques», et s’abstenaient d’utiliser ces
conflits à des fins politiques et si, par surcroît, les décisions
des tribunaux étaient respectées. Ce n'est certes pas pour demain la
veille quand on constate à quel degré d'intolérance en est arrivée
la Belgique!
L'histoire de la Belgique ne se termine pas
ici. La partition n'a pas encore eu lieu et il n'est pas certain qu'elle se
concrétisera. Pour le moment, on a affaire à deux communautés qui ne se parlent
plus et se méfient l'une de l'autre. L'avenir de l'État belge semble reposer
entre les mains des Flamands, parce que ce sont eux qui ne voient pas de réelle
solution à la réforme d'un État «porteur d'avenir». Une boutade,
fort connue en Belgique, caractérise assez bien les «querelles communautaires»
vieilles de quinze siècles, qui ne dorment jamais que d’un œil, même si elles
ont pris un tour plus aigu depuis la création de l'État belge en 1830:
«En Belgique, la situation est désespérée, mais pas
grave.»
Les
motifs les plus importants susceptibles d'entraîner la fin de l'État belge
actuel semblent d'abord d'ordre économique, puis culturel. Les Flamands
affirment ne plus ne vouloir «allaiter» indéfiniment la Wallonie qui
s'accroche aux structures fédérales pour «bénéficier du dynamisme
flamand». La parité des postes au sein de l'État fédéral ne leur convient
plus, car la situation actuelle priverait les Flamands de la moitié de leurs
diplômés compétents pour perpétuer un système auquel beaucoup ne croient
plus, par simple compassion solidaire envers les francophones. Les Flamands
affirment avoir compris qu'une petite communauté linguistique ne peut survivre
qu'en disposant d'un État la protégeant. D'après certains Flamands, les
politiciens auraient retenu la leçon du Québec
qui, semble-t-il, a «perdu son référendum sur l'indépendance» en raison de la réticence des
allophones et des immigrés récents; ils ne veulent pas qu'une pareille situation leur
arrive. Pour eux, il importe au plus tôt de
constituer au cœur de l'Europe un État unilingue néerlandophone, car dans dix
ans il sera trop tard.
Bref, c'est une conception de l'État belge
qui différencie néerlandophones et francophones: les premiers veulent un État fédéral
réduit à sa plus simple expression; les seconds, un État fort, capable de
diminuer les «exagérations» des nationalistes flamands. Encore là, il faut
distinguer Wallons et francophones bruxellois: les Wallons iraient probablement
jusqu'à dépecer leur État fédéral comme les Flamands, mais les francophones
bruxellois tiennent mordicus à leur État fédéral
sur lequel ils exercent un énorme pouvoir.
Mais le plus important obstacle à la
désagrégation de l'État belge pourrait bien être Bruxelles-Capitale, une
ville qui suscite la convoitise de la part des deux grandes communautés. Il est hors de
question pour les francophones que les Flamands «absorbent Bruxelles», comme il
est absolument hors de question pour les Flamands que les francophones
«grignotent» la moindre parcelle du territoire flamand, notamment les six
communes à facilités de la région périphérique. Les Flamands
ne veulent pas «lâcher» Bruxelles.
En cas de désagrégation de l’État belge, le
sort de Bruxelles se posera inévitablement. Les nationalistes flamands rêvent
d’une mise sous tutelle, d’une «co-responsabilité» entre les deux communautés,
une sorte de protectorat ou de bi-communautarisation assurée par les deux
grandes régions qui deviendraient des États. Les Wallons et les Bruxellois
considèrent cette formule aussi «onbespreekbaar» (non négociable) que les
Flamands considèrent comme «onbespreekbaar» l’élargissement des limites de
Bruxelles aux communes à facilités. L’idée d’un district européen doté de plus
de pouvoirs que «Washington DC» leur conviendrait, mais les Flamands n’en
veulent pas, car cela leur enlèverait tout pouvoir à Bruxelles, ce qu’ils
n’accepteront jamais. Au plan économique, un obstacle non négligeable au
démantèlement de la Belgique viendrait aussi de la dette publique
colossale de l'État fédéral, qui s'élève à quelque 334 milliards d'euros
(97 % du PIB), sans compter que cette dette risque de s'alourdir en raison de la
hausse prévisible des taux d'intérêts qui seraient appliqués aux nouveaux États
pour la financer?
Quant aux partisans du maintien du fédéralisme, ils estiment qu’il n’y a pas d’autre solution et ne croient
pas à la dislocation du pays, ce qui n’arrangerait finalement personne à cause
de Bruxelles. D'ailleurs, la spécialiste universitaire belge, Astrid von Busekist,
ne croit pas que la Belgique soit prête à se saborder (janvier 1998):
|
Je ne connais pas de pays où
les hommes politiques sont mieux protégés de leurs propres excès.
Lorsqu’ils franchissent les limites et invoquent l’éclatement du pays, ils
se heurtent à des impossibilités pratiques. Au point qu’on serait tenté
d’y voir moins une intention qu’une stratégie en perspective des
négociations intercommunautaires. À cette réserve près que le ton se
durcit et que, de part et d’autre, personne n’est prêt à calmer le jeu.
Mais comment le séparatisme serait-il possible sans une violence à
laquelle les Belges ne sont pas prêts ? Cela étant, la Flandre peut vivre
sans la Belgique romane et, en Wallonie, les «rattachistes» partisans d’un
«retour à la France» ne sont qu’une poignée. |
Le problème, c'est que le fédéralisme
belge semble n'avoir rien résolu. Le seul point qui a
fait l'unanimité entre Flamands et francophones ces
dernières années, ce fut l'interdiction de la burqa en avril 2010.
Pour de nombreux citoyens belges «ordinaires», en dépit
d'un différend linguistique qui nourrit l'amertume des
deux parties antagonistes, les néerlandophones et les
francophones, les problèmes relèveraient avant out de
simples querelles politiciennes. Selon un sondage publié
par le quotidien La Libre Belgique en 2010, le
scénario de la scission serait rejeté par 57 % de
Belges, contre 14 % qui y seraient favorables. Même en
Flandre, où le sentiment autonomiste est plus profond,
seules 15 % des personnes interrogées se prononcent en
faveur de l'éclatement du pays. Par ailleurs, le sort de
Bruxelles semble être l'un des freins majeurs au
«divorce des Belges». En effet, la capitale est habitée
à plus de 85 % par des francophones, mais elle est
géographiquement enclavée en Flandre, rendant
hypothétique l'existence d'un État francophone
Wallonie-Bruxelles, qu'il soit indépendant ou rattaché à
la France.
La
Flandre n'est donc pas prête à laisser Bruxelles,
poumon économique du pays, aux seuls francophones.

En
jetant un regard sur l'histoire de la Belgique, il faut bien constater que les compromis belges n’ont pas réussi à garantir
la stabilité à l’État fédéral, car les scénarios de sécession semblent de
plus en plus d’actualité. Jusqu’à maintenant, c’est la dynamique de la
fragmentation qui a eu préséance, les deux grandes communautés ayant «dépecé» leur État à
leurs profits. Au lieu
de privilégier un fédéralisme de collaboration, la
Belgique s'est plutôt dirigée vers un fédéralisme de confrontation.
Pour le moment, c'est Bruxelles qui empêche
la séparation de
facto,
puisque la Flandre ne veut pas y renoncer et qu’elle ne saurait rayer de la
carte près d’un million de francophones qui y habitent, ou les expulser, alors
qu’il s’agit de la capitale de l’Europe. Le jour où les Flamands accepteraient de
«perdre» Bruxelles, c'en serait fait de la Belgique. Quoi qu'il en soit, le
«plat pays» doit accepter de vivre encore de longues années d'enlisement
politique, puisque personne ne parvient à surmonter les conflits linguistiques qui, ailleurs,
seraient perçus comme bien mineurs. Rappelons cet adage en
Belgique, qui résume bien la complexité derrière l’histoire qui a façonné ce
pays: «Si vous avez compris quelque chose à la Belgique, c'est qu'on vous l'a
mal expliquée.»
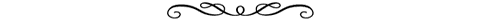
DOCUMENT DE CONSULTATION:
On peut consulter un texte rédigé par quatre députés flamands portant
sur l'Histoire
de la Belgique d'un point de vue
flamand.
Voir
Proposition flamande de résolution
relative au démembrement de l'État belge
en vue d'accorder l'indépendance au
peuple flamand et au peuple wallon souverains.
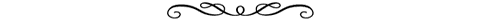
Dernière mise à jour:
13 juil. 2025
Belgique (accès)